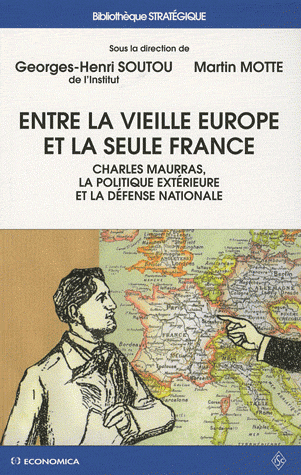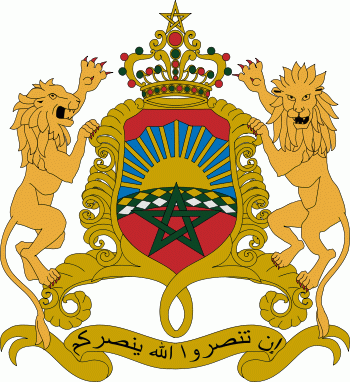18 avril 2010
S'il était encore vivant, Charles Maurras serait-il
souverainiste ?
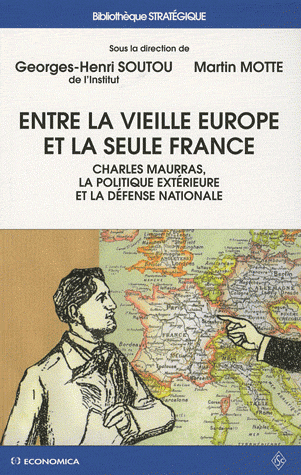
La géopolitique de Maurras a fait l'objet d'un ouvrage publié
en novembre dernier (1). Nous en avons lu le chapitre consacré
à la critique du fédéralisme européen, espérant y trouver moult
éléments susceptibles de nourrir notre critique du souverainisme.
Peut-être attendions-nous des auteurs qu'ils fassent parler les
morts... Or, prévient d'emblée Christophe Réveillard, « on ne
trouve chez Maurras que peu d'analyses approfondies des nouvelles
communautés européennes [...], entre autres raisons parce qu'il
disparaît en 1952 ».
Durant l'entre-deux-guerres, plus particulièrement,
« Maurras dénonce essentiellement l'irréalisme du fédéralisme
européen ». Ce faisant, aurait-il jugé négligeables les
considérations économiques et politiques à l'origine de la
CECA, attribuant sa création à la seule idéologie, bien qu'il pense
« que derrière les discours lénifiants, prévaut le réalisme
des puissances » ? À vrai dire, nous nous demandons
si la question a vraiment préoccupé Christophe Réveillard, tant il
semble enclin à réduire les politiques aux postures qui les
accompagnent. En témoigne, à nos yeux, la facilité avec laquelle il
affirme que « la période gaulliste correspond [...] au
développement d'une autre conception de l'Europe » –
« selon laquelle la Communauté doit être une confédération
d'États se donnant un pouvoir commun auquel chacun délègue (et non
abandonne) un part de souveraineté ».
Tandis que les "pères fondateurs" de l'Europe seraient aux
antipodes du Martégal, l'élaboration du plan Fouchet – demeuré sans
lendemain... – et la négociation du compromis de Luxembourg – beaucoup
de bruit pour rien ! – placeraient De Gaulle dans sa droite
filiation : « Ineluctabilité de la division de
l'Europe en entités nationales distinctes, nécessité pour la France de
refonder son organisation interne autour d'un fédérateur légitime,
critique au nom du "Politique d'abord !" de l'européisme comme
principe de dépolitisation des rapports étatiques, défense d'une
diplomatie française fondée sur la recherche de l'équilibre des
alliances et l'indépendance nationale, ce qui exclut le projet d'une
communauté permanente de nations fondée sur la contrainte, le constat
est rapidement fait : les certitudes de Charles Maurras en
matière européenne furent également celles de Charles De
Gaulle. »
Cela nous semble d'autant plus "léger" que
M. Réveillard passe sous silence les ambiguïtés d'un concept
au cœur de la réflexion sur la construction européenne. Ainsi n'est-il
pas loin d'ériger implicitement Maurras en défenseur de la
« souveraineté nationale » (2), bien que
celui-ci en ait fermement récusé le principe, lui opposant
« la souveraineté du salut public, ou du bien
public, ou du bien général ».
« Ce que Maurras reproche le plus aux différentes
tentatives d'unification européenne », c'est, paraît-il,
« l'absence de ce qui pour lui devrait relever de
l'évidence : la recherche de l'accroissement de
puissance ». Recherche dont nous doutons, pour notre part,
qu'elle soit le fait des souverainistes... Cela dit, peut-être
trouverons-nous matière à nous interroger sur les conséquences du
multilatéralisme en parcourant les autres chapitres d'une étude censée
présenter, plus généralement, les thèses de Maurras « sur les
relations internationales et les problèmes de défense », et
même exposer les débats que suscita leur réception au sein de l'Action
française.
(1) Sous la direction de Georges-Henri Soutou et Martin
Motte : Entre la vieille Europe et la seule France
- Charles Maurras, la politique extérieure et la défense nationale ;
Économica, Bibliothèque stratégique, 23 novembre 2009,
432 pages, 39 euros
(2) « Face à la critique des souverainetés
nationales, assimilées aux causes principales des guerres, Maurras
affirme que c'est au au contraire le déni de puissance nationale, par
décadence intérieure et/ou par impérialisme de puissances extérieures,
qui est facteur de déséquilibre et de guerre. »
Publié dans Europe, Histoire, Livres | Pas de commentaires
15 avril 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Bruxelles recèle une manne financière convoitée par
l'outre-mer français. Au-delà, les relations des territoires
ultra-marins avec l'Europe sont à l'image de celles entretenues avec la
métropole, selon qu'ils souhaitent resserrer ou assouplir les liens
politiques les attachant à Paris.

L'appartenance des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
« à la famille européenne » doit être mieux
considérée, affirme l'Assemblée nationale. Dans une résolution adoptée
le 26 mars, la chambre basse « souligne la nécessité
de remédier à l'érosion des préférences commerciales dont bénéficient
les PTOM » ; elle demande que l'UE tienne compte de
leurs intérêts « dans la définition et la conduite de sa
politique commerciale », et invite le gouvernement à
préserver, plus particulièrement, ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Deux statuts européens
Les départements d'outre-mer (DOM) sont intégrés à la
Communauté européenne depuis son origine ; selon la
terminologie introduite par le traité de Maastricht, ils constituent
des « régions ultra-périphériques » (RUP) de l'Union.
Les « pays et territoires d'outre-mer » bénéficient,
quant à eux, d'un régime d'association. Certains sont devenus
indépendants à la faveur de la décolonisation, formant, dans le jargon
européen, les « États ACP » (Afrique, Caraïbes et
Pacifique). « Historiquement, la catégorie des PTOM a donc un
caractère "résiduel" », observent Mme Annick Girardin
et Hervé Gaymard, auteurs d'un rapport d'information enregistré le
10 février à la présidence de l'Assemblée. Parmi les PTOM
figurent Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques
françaises, Wallis-et-Futuna. Les RUP européennes correspondent, plus
au moins, aux départements d'outre-mer français, et les PTOM aux
collectivités d'outre-mer. « Cependant, le changement de
statut d'une collectivité en droit interne n'a pas de conséquence
automatique sur son statut au regard du droit communautaire »,
soulignent les députés.
Les produits originaires des PTOM entrent librement sur le
territoire européen. En revanche, les exportations communautaires
peuvent être soumises à des droits de douane perçus par les PTOM,
« qui répondent aux nécessités de leur développement et aux
besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour
but d'alimenter leur budget ». Alimenté par les États membres
de l'UE, sans dépendre stricto sensu du budget de
l'Union, le Fonds européen de développement (FED) bénéficie à la fois
aux PTOM et aux pays ACP. La France en est aujourd'hui le deuxième
contributeur (19,5 %) derrière l'Allemagne (20,5 %).
Pour la période 2008-2013, 286 millions d'euros sont alloués
aux PTOM, sur un total de 22,7 milliards (soit
1,25 %). « Les montants sont modestes »,
commentent les rapporteurs. À titre de comparaison, les sept régions
ultra-périphériques bénéficient de 7,8 milliards d'euros de
fonds communautaires pour la période 2007-2013.
Mayotte veut s'intégrer à l'Europe
« En tant que PTOM, Mayotte bénéficie depuis 1976 de
l'action cruciale de l'Europe au service de son
développement », soutient le sénateur Soibahadine Ibrahim
Ramadani. L'investissement labellisé par Bruxelles aurait permis de
financer l'électrification rurale, le reboisement, la construction de
la station d'épuration des eaux usées, la protection du lagon...
Pourtant, entre 2000 et 2007, alors que la dotation avoisinait les
25 millions d'euros, seul un peu plus d'un million aurait été
consommé. « Cette situation n'est en rien exclusive à
Mayotte », poursuit M. Ibrahim Ramadani,
« puisque les DOM étant eux-mêmes des RUP, recevant les fonds
structurels, ne consomment en moyenne que 40 à 50 % des
crédits alloués ». En cause : « la
complexité des procédures » et « un manque crucial de
personnel qualifié dans la gestion et l'exécution des crédits
européens ».
Malgré tout, l'enveloppe destinée à Mayotte apparaît
« quelque peu "dérisoire" » aux yeux du sénateur, qui
la compare à celles octroyées aux régions ultra-périphériques –
telles la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
L'île aux Parfums convoite leur statut européen, qui lui ouvrirait une
nouvelle manne financière. Il appartient aux responsables nationaux
d'agir pour que Mayotte bénéficie des fonds structurels de la période
2014-2020. « Mais l'Europe, c'est plus qu'une chance pour
Mayotte », conclut Soibahadine Ibrahim Ramadani. Ce serait
même « vital » : « Le statut de
DOM-ROM garantit notre ancrage dans la République. Le statut de RUP de
l'UE consolidera à jamais la position des Mahorais et écartera
définitivement toute crainte liée aux revendications territoriales d'un
pays étranger et sera une force pour endiguer devant la communauté
internationale les condamnations injustes et injustifiées liées à la
présence légitime de la France à Mayotte. »
Émancipation
À l'inverse, après s'être détachée de la Guadeloupe pour
devenir en 2007 une collectivité d'outre-mer française,
Saint-Barthélémy a demandé à passer du statut de région
ultra-périphérique à celui de pays et territoire. Forte d'un PIB par
habitant supérieur à 75 % du PIB moyen de l'Union européenne,
l'île ne peut prétendre au bénéfice des fonds structurels. En tant que
RUP, elle n'en reste pas moins soumise au droit communautaire, dont la
transposition serait « génératrice de normes souvent
exorbitantes et d'application contraignante », selon le
sénateur Michel Magras. « Du point de vue des relations
commerciales avec les États-Unis, d'où proviennent une grande part des
biens de consommation, le respect strict des normes constitue un
handicap », affirme-t-il. En outre, le nouveau code des
douanes communautaires pourrait menacer le "droit de quai".
« Sa remise en cause équivaudrait à supprimer l'élément
principal de l'autonomie budgétaire de la collectivité »,
avertit M. Magras. Or, le risque planant sur sa perception
serait dissipé par l'accession au statut de PTOM. En résumé,
« Saint-Barthélemy souhaite trouver dans le régime
d'association les facultés d'adaptation de la réglementation que le
statut de [collectivité d'outre-mer] permet en droit
français ».
Quelles perspectives ?
Adoptée en 2001, l'actuelle décision d'association expirera le
31 décembre 2013. À l'avenir, selon les conclusions du Conseil
du 22 décembre 2009, « les relations entre l'UE et
les PTOM ne devraient plus être polarisées, comme c'est le cas
actuellement, sur la réduction de la pauvreté, mais se muer en un
partenariat [...] qui favorisera le développement durable des PTOM et
mettra à profit leur potentiel et leurs atouts, tout en contribuant à
promouvoir les valeurs et les normes de l'UE dans le reste du
monde ». « Le discours sur le renforcement de la
compétitivité, c'est le refrain à la mode », commente
Jean-Claude Fruteau. Le député de la Réunion juge « illusoire
de croire que les seuls mots de "partenariat réciproque et renforcement
de la compétitivité" permettront aux PTOM de combler définitivement
leurs retards et de résoudre les difficultés structurelles en
présence ». De son point de vue, « la question de
fond est de savoir quelle sera la compétitivité des PTOM face à la
concurrence mondiale si on les "lâche" après les avoir assistés pendant
longtemps ».
« Les objectifs environnementaux [...] sont plus que
louables », poursuit M. Fruteau.
« Cependant, à l'heure actuelle, la valorisation et la
sauvegarde de la biodiversité ne peuvent constituer à elles seules un
levier suffisant... » Son collègue Michel Buillard
se montre plus optimiste : « Le développement des
énergies renouvelables permettrait à la Polynésie française d'être un
laboratoire d'expérimentation dans le Pacifique dans un domaine de
technologie de pointe et à forte valeur ajoutée tel que l'énergie
thermique des mers, l'énergie houlomotrice, l'éolien ou le
photovoltaïque. »
« Cette évolution devrait mettre fin au parallélisme
existant avec le régime des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique », soutient l'Assemblée nationale, qui envisage la
création d'un fonds spécifique. La chambre basse souhaite un
rapprochement entre le régime des PTOM et celui des régions
ultra-périphériques. M. Buillard propose de
« substituer au critère du PNB celui de
vulnérabilité ». En outre, la Polynésie réclame une
participation accrue à la prise de décision.
Saint-Pierre-et-Miquelon
De fait, Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait faire les frais de
la relative indifférence de Bruxelles. Des produits de la pêche en
provenance du Canada y sont transformés, après paiement des droits de
douane de la collectivité, et sont ensuite réexportés vers l'Union
européenne en franchise de droits de douane. Or, des discussions avec
Ottawa pourraient aboutir à une libéralisation totale des échanges. Le
cas échéant, il n'y aurait plus d'intérêt pour le Canada à faire
transiter ses produits par Saint-Pierre-et-Miquelon. « Ce
risque n'a pas été identifié au moment de l'adoption du mandat de
négociation de l'accord », déplorent Mme Annick
Girardin et Hervé Gaymard. « À présent que les négociations
ont commencé, les intérêts de Saint-Pierre-et-Miquelon [...] doivent
impérativement être pris en compte par la Commission ».
Mais « la question des accords commerciaux dépasse
très largement le sujet des PTOM » selon l'ancien ministre de
l'Agriculture. « Nous trouvons là, comme ailleurs, une des
grandes faiblesses européennes », a-t-il expliqué devant la
commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale :
« l'absence de cohérence entre des politiques en tuyaux
d'orgue. Ainsi les discussions sur le cycle de Doha se
poursuivent-elles en parfait cloisonnement à l'égard des débats sur
l'avenir de la PAC ou des progrès des politiques européennes d'aides au
développement. Or, tous ces enjeux sont intrinsèquement liés, et ce
maillage organique n'est nulle part aussi spectaculaire que dans les
PTOM. » Peut-être la mise en place, en décembre dernier, d'un
"pôle outre-mer" au sein de la représentation permanente de la France à
Bruxelles contribuera-t-elle à changer la donne.
Publié dans Europe, Outre-mer | Pas de commentaires
1 avril 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Union européenne s'achemine vers la mise en œuvre d'une
première coopération renforcée.

On recenserait chaque année près de 300 000 mariages
internationaux dans l'Union européenne. En cas de divorce, la variété
des législations nationales entraine « des complications sur
le plan juridique et des frais élevés, rendant plus difficile le
prononcé des divorces à l'amiable », selon les observations de
la Commission européenne. Celle-ci a proposé un règlement en vertu
duquel les couples contrôleraient davantage leur séparation, et les
juridictions disposeraient d'une méthode commune pour déterminer le
pays dont la loi s'applique lorsque les couples ne peuvent pas
s'accorder sur ce point. « L'objectif est d'alléger la charge
pesant sur les enfants et de protéger les conjoints les plus
vulnérables » explique-t-on à Bruxelles.
La Commission répond à la demande de dix États membres, dont
la France, qui doivent désormais obtenir l'approbation du Conseil et du
Parlement européen pour mettre en œuvre une "coopération renforcée" –
la première depuis l'introduction de ce mécanisme par le traité
d'Amsterdam entré en vigueur en 1999.
En février dernier, la France et l'Allemagne avaient déjà
signé une convention créant un régime matrimonial commun (Coulisses
de Bruxelles, 01/03/2010). Par ailleurs, un projet de
directive vise à établir un ordre de protection européenne, qui
permettrait à un État membre d'étendre des mesures d'éloignement au
territoire de ses partenaires. Un nouveau signe de l'immixtion
croissante de l'Union dans la justice et les affaires intérieures (JAI).
Publié dans Europe | Pas de commentaires
1 avril 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelques mots sur la réunion des chefs d'État ou de
gouvernement de l'UE les 25 et 26 mars.

Stratégie sans surprise
Réuni à Bruxelles les 25 et 26 mars, le Conseil
européen des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE a approuvé les
principaux éléments d'une nouvelle stratégie pour l'emploi et la
croissance : porter à 75 % le taux d'emploi des
femmes et des hommes âgés de vingt à soixante-quatre ans, investir
3 % du PIB en recherche et développement, réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux
niveaux de 1990, améliorer l'éducation et réduire le taux de décrochage
scolaire, favoriser l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté...
Des objectifs somme toute très généraux , qui seront certes précisés
d'ici l'été.
Selon les conclusions du Conseil européen, « la
Commission présentera prochainement un rapport sur d'éventuelles
sources novatrices de financement, comme un prélèvement mondial sur les
transactions financières ». En outre, « la stratégie
comprendra une dimension extérieure forte afin de garantir que les
instruments et les politiques de l'UE seront mis en œuvre pour
promouvoir nos intérêts [...] par la participation, à l'échelle
mondiale, à des marchés ouverts et où les conditions de concurrence
sont équitables ». D'aucuns y verront un écho aux propos de
Nicolas Sarkozy jugeant « invraisemblable que l'Europe
interdise le soutien aux industries exportatrices », alors que
« ses concurrents asiatiques déploient des financements
massifs »...
« Si certains objectifs sont inscrits dans les textes
législatifs de l'UE, les autres ne le sont pas et n'impliquent pas de
partage de l'effort », observent les chefs d'État ou de
gouvernement ; « ils constituent un but commun à
atteindre par une combinaison d'actions entreprises à l'échelon
national et à celui de l'UE ». Commentant la stratégie
précédente, Yves Bertoncini s'était interrogé « sur la
nécessité pour l'UE de retenir comme une priorité politique majeure une
stratégie pour laquelle ses moyens d'action directs sont
limités » (Dictionnaire critique de l'Union
européenne, Armand Colin). La question demeure pertinente,
malgré l'annonce d'une implication accrue du Conseil européen et celle
d'un meilleur suivi. « Un dialogue étroit » entre les
États membres et la Commission permettra, paraît-il,
« d'améliorer la qualité de la surveillance et de favoriser
l'échange de bonnes pratiques » ; « il
pourrait notamment prendre la forme de réunions entre des experts de la
Commission et des États membres ». Une vraie
révolution !
Service minimum en Euroland
Craignant une asphyxie de son pays sous la pression des
marchés, le Premier ministre grec Georges Papandréou avait sollicité un
« large soutien politique » qui lui permettrait de
financer sa dette « à des taux raisonnables ».
Le 25 mars , en marge du Conseil européen, les chefs d'État et
de gouvernement des seize pays de la zone euro sont convenus de
contribuer à des prêts bilatéraux coordonnés. Cela en
« dernier recours », avec une implication
« substantielle » du Fonds monétaire international.
« Il a fallu travailler dur » pour parvenir
à cet accord, a reconnu le président de la République. À l'approche des
élections en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le chancelier allemand
craignait vraisemblablement de froisser son opinion publique, exaspérée
par les déboires de la Grèce, lesquels contrastent avec la rigueur
pratiquée outre-Rhin. La déclaration de l'Eurogroupe annonce d'ailleurs
une surveillance renforcée des risques économiques et budgétaires.
« La question des sanctions est clairement posée », a
souligné Nicolas Sarkozy.
De fait, l'accord arraché à Angela Merkel ne fait aucun
mystère de ses réticences. Prenant le risque de tester les marchés
lundi dernier, Athènes a toutefois bénéficié d'un accueil relativement
favorable après avoir lancé un emprunt de 5 milliards d'euros
sur sept ans. Affaire à suivre.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
1 avril 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Innovation majeure du traité de Lisbonne, la création du
Service européen pour l'Action extérieure se prépare sur fond de
rivalités institutionnelles. Le Parlement européen entend bien
conforter ses prérogatives...

Le Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires
étrangères et la Politique de sécurité continue de faire jaser. Selon
Jean Quatremer, Mme Catherine Ashton aurait refusé une
rencontre le 18 avril avec les ambassadeurs du Conseil de
Sécurité des Nations unies, « tout simplement parce que ce
jour-là est un dimanche et que la baronne passe tous ses week-ends à
Londres, là où résident son mari et ses enfants » (Coulisses
de Bruxelles, 18/03/2010).
Architecture du SEAE
Les critiques sont d'une autre nature depuis qu'elle a révélé
son projet d'architecture du futur Service européen pour l'Action
extérieure (SEAE) – « un bureau autonome de l'UE, séparé de la
Commission et du secrétariat général du Conseil, avec la capacité
juridique nécessaire pour accomplir ses tâches et atteindre ses
objectifs ».
Il serait dirigé par un secrétaire général placé sous
l'autorité du Haut Représentant, prenant « toutes les mesures
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du SEAE ».
L'administration centrale serait organisée en directions générales
comprenant des bureaux géographiques ou thématiques. Les organes de
gestion de crises, civils et militaires, dépendraient directement du
Haut Représentant.
Du côté des gouvernements, on reconnaît à demi-mot la
difficulté des négociations en cours : « La
présidence espagnole est déterminée à ne pas ménager ses efforts pour
parvenir à un accord », précise un communiqué du secrétariat
général du Conseil. À travers le transfert au SEAE (suivant un principe
de neutralité budgétaire) de services rattachés jusqu'alors tantôt au
Conseil des ministres, tantôt à la Commission, l'équilibre
institutionnel pourrait se trouver modifié. Or, le Parlement européen
entend bien tirer la couverture à lui.
Un projet inacceptable
Ce projet d'architecture, qui ne devrait pas dépayser les
diplomates français, est jugé « inacceptable » par
une majorité de députés. Fustigeant tout particulièrement l'ampleur des
pouvoirs conférés au secrétaire général – un fonctionnaire –,
ils réclament « un service autonome lié à la Commission aux
niveaux administratif, organisationnel et budgétaire » qui
serait « responsable devant le Parlement aux niveaux politique
et budgétaire ».
Forte de sa mainmise sur le budget européen, l'assemblée n'a
pas caché sa volonté d'« intensifier la pression sur les
autres institutions de l'UE ». Elle l'a réaffirmée le
10 mars, en votant, par 633 voix contre 13 (Le Point,
10/03/2010), une résolution « sur la transparence et l'état
d'avancement des négociations ACTA » (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement). Mandatée par les gouvernements, la Commission
participe à la négociation d'un accord multilatéral censé renforcer la
protection des droits de propriété intellectuelle. Or, les parties sont
convenus d'une clause de confidentialité. Les députés le tolèrent
d'autant moins que les fuites nourrisent moult inquiétudes quant au
contenu de l'accord. « Les douanes pourraient fouiller
lecteurs MP3, téléphones et ordinateurs portables de tout citoyen
suspecté d'avoir téléchargé illégalement un quelconque
fichier », prévient Bruno Gollnisch.
Le souverainisme piégé ?
La résolution adoptée condamne une telle perspective, invitant
par ailleurs la Commission et le Conseil « à assurer l'accès
des citoyens et des organes parlementaires aux documents et aux
synthèses relatifs à la négociation de l'ACTA ». Le Parlement
« attend de la Commission qu'elle présente des propositions
avant le prochain cycle de négociations qui se tiendra en
Nouvelle-Zélande en avril 2010, qu'elle exige que la question de la
transparence soit inscrite à l'ordre du jour de cette réunion et
qu'elle communique au Parlement le résultat du cycle de négociations
immédiatement après sa conclusion ». Enfin, le texte
« souligne que, s'il n'est pas informé immédiatement et
intégralement à tous les stades des négociations, le Parlement se
réserve le droit de prendre les mesures appropriées, y compris
d'intenter une action auprès de la Cour de justice afin de défendre ses
prérogatives ».
Le cas échéant, si la Cour donnait raison au Parlement,
l'Europe serait-elle contrainte de trahir la confiance de ses
partenaires internationaux ? S'exprimant au nom du groupe
"Europe, libertés, démocratie" où siège Philippe de Villiers, le
Britannique Derek Roland Clark n'a pas manifesté davantage de réserve
que le porte-parole du Front national dans son explication de vote en
faveur de la résolution. Le souverainisme révèle ici son
ambiguïté : en effet, à travers l'exigence de transparence,
c'est, en définitive, l'influence des gouvernements sur le
fonctionnement de l'Union qui nous semble contestée.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
19 mars 2010
Quelques jours après la tenue de sa 3000e session
ordinaire, présentons brièvement cette institution tantôt dénommée
Conseil de l'UE, Conseil des ministres ou plus simplement Conseil, qui
ne doit pas être confondue avec le Conseil européen – réunissant les
chefs d'État ou de gouvernement –, ni avec le Conseil de
l'Europe – indépendant de l'Union.

Le Conseil a tenu sa 3000e session ordinaire le lundi
8 mars 2010. « La numérotation actuelle des sessions
du Conseil remonte à l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1967,
du traité de fusion, qui instituait un conseil unique et une commission
unique », rappelle-t-il dans
un communiqué. « Auparavant, quelque 460 sessions du
Conseil spécial de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA), à partir de 1952, et des Conseils de la Communauté économique
européenne (CEE) et de la Communauté européenne de l'énergie atomique
(CEEA), à partir de 1958, avaient déjà eu lieu. »
« Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement
européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des
fonctions de définition des politiques, notamment dans le domaine des
affaires étrangères, ainsi que des fonctions de coordination, notamment
dans le domaine économique. [...] Il est composé d'un représentant de chaque État membre au
niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre
qu'il représente et à exercer le droit de vote. »
Le Conseil siège aujourd'hui en dix formations
différentes : affaires générales ; affaires
étrangères ; affaires économiques et financières
(ECOFIN) ; justice et affaires intérieures (JAI) ;
agriculture et pêche ; emploi, politique sociale, santé et
consommateurs ; compétitivité (marché intérieur, industrie et
recherche) ; transports, télécommunications et
énergie ; environnement ; éducation, jeunesse et
culture. « En règle générale, les ministres des Affaires
générales, des Affaires étrangères, des Affaires économiques et
financières ainsi que de l'Agriculture se réunissent chaque mois. Les
autres formations du Conseil se réunissent d'une à trois fois par
semestre. » On compterait actuellement entre soixante-dix et
soixante-quinze sessions chaque année.
À l'exception de celle des Affaires étrangères, confiée au
Haut Représentant, la présidence des formations du Conseil est assurée
par les représentants des États membres selon un système de rotation
semestrielle. « Le comité des représentants permanents
(Coreper) des gouvernements des États membres est responsable de la
préparation des travaux du Conseil. Les travaux de ce comité sont
eux-mêmes préparés par plus de 150 comités et groupes de
travail composés de délégués des États membres. [...] Les sessions du
Conseil se tiennent à Bruxelles, sauf aux mois d'avril, de juin et
d'octobre, où elles ont lieu à Luxembourg. Toutefois, le Conseil s'est
également réuni à d'autres endroits, en particulier à Genève, dans le
cadre des négociations de l'OMC. »
« Le Conseil est assisté d'un secrétariat général
[qui] emploie environ 3 500 fonctionnaires. [...] Le Conseil a
son siège à Bruxelles, depuis 1995 dans le bâtiment Justus Lipsius,
situé dans le quartier européen, sur le rond-point Schuman. Auparavant,
le Conseil avait successivement occupé le bâtiment Ravenstein, au
centre de Bruxelles puis, de 1971 à 1995, le bâtiment
Charlemagne. »
Publié dans Europe | Pas de commentaires
18 mars 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Tandis que la Francophonie fête son quarantième anniversaire,
alors que ses adhérents ont renforcé leur poids dans l'UE, le français
perd du terrain en Europe depuis les derniers élargissements. Qu'en
est-il, désormais, de son usage dans les institutions de
l'Union ?

Samedi 20 mars sera célébrée la journée
internationale de la Francophonie, quarante ans après la signature du
traité à l'origine de l'organisation éponyme (l'OIF). Plusieurs
centaines d'événements sont annoncés sur le Vieux-Continent pour fêter
cet anniversaire. Outre la France, l'Union européenne compte quatorze
États membres appartenant à l'OIF : cinq membres à part
entière avec la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, le Luxembourg et la
Roumanie ; un membre associé, Chypre ; et huit pays
observateurs, l'Autriche, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.
Paradoxe
À la faveur des derniers élargissements, les ressortissants de
la francophonie institutionnelle ont accru leur présence dans l'Union.
Une chance pour la langue de Molière ? Loin s'en faut. The
more languages, the more english ! « La
logique est en effet implacable, commente Astrid von Busekist.
L'anglais possède la plus grande centralité (la proportion de locuteurs
multilingues compétents en anglais en tant que langue seconde), bien
qu'il ne possède pas la plus grande prévalence (la proportion de natifs
d'une langue, soit les locuteurs des [...] langues
européennes). » (Dictionnaire critique de l'Union
européenne, Armand Colin)
« L'année 2009 a confirmé la tendance observée depuis
plusieurs années au sein de l'UE », souligne le rapport au
Parlement sur l'emploi de la langue française diffusé par la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF).
« Sous l'effet de l'élargissement de 2004, on assiste à un
renforcement des positions de l'anglais et à une érosion parallèle de
celles de notre langue et, plus encore, des autres langues. »
On relève quelques nuances selon les institutions, voire les
rotations de la présidence semestrielle. « La part du français
est logiquement plus élevée au cours des présidences francophones.
Cependant, même lorsque cette langue est le français, il arrive que le
projet rédigé par le secrétariat général du Conseil (SGC) soit en
anglais, ce qui révèle un affaiblissement de la capacité de rédaction
des fonctionnaires du SGC dans notre langue. En matière
d'interprétation en revanche, les règles en vigueur font toute sa place
au français et demeurent appliquées très strictement. » Selon
le sénateur Jacques Legendre, auteur d'un rapport déposé le
11 mars 2009, « un bilinguisme traditionnel
anglais-français » caractériserait les réunions des groupes de
travail sur la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
Sera-t-il remis en cause par la nomination d'une Britannique au poste
de Haut Représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de
sécurité ? La langue de Shakespeare est en tout cas la seule
qui lui soit familière.
Un déclin flagrant
Conformément à son "manuel des procédures opérationnelles", la
Commission s'appuie sur trois langues de travail. Selon la DGLFLF,
« l'examen des documents traduits au cours de cinq dernières
années montre que les élargissements et le passage consécutif de onze à
vingt-trois langues officielles ont été suivis à la fois d'une
accélération du recours à l'anglais et d'un recul sensible du français
et de l'allemand ». Entre 1996 et 2008, la proportion de
documents rédigés initialement en français est passée de 38 à
11,9 %, tandis que l'anglais progressait de 45,7 à
73,55 %.
Dans la salle de presse du Berlaymont (le siège de la
Commission), le français aurait jadis régné sans partage. Dorénavant,
il serait utilisé à parts égales avec l'anglais, rapporte la DGLFLF. Le
président de la Commission, José Manuel Durao Barroso, aurait pourtant
confié que lorsqu'il pratiquait la langue de Molière devant la presse,
« cela créait des remous dans la salle » (Coulisses
de Bruxelles, 18/01/2010). Notre confrère Jean Quatremer,
correspondant de Libération à Bruxelles, a d'ailleurs tiré la sonnette
d'alarme à plusieurs reprises.
Le déclin est moindre au Parlement européen, dont le tiers du
budget est consacré aux dépenses de traduction et d'interprétation.
« L'obligation d'interprétation est systématiquement respectée
pour le français », affirme la DGLFLF. Un seul manquement
aurait été signalé en 2009, « au sein d'une commission, dû à
la configuration technique de la salle et à l'absence attendue de
députés français ». Pour autant, poursuit la Délégation,
« l'approche plus flexible adoptée concernant les documents et
réunions préparatoires contribue à renforcer le rôle de l'anglais [...]
comme la langue de travail des contacts informels. [...] Par ailleurs,
la possibilité de disposer d'une version en français des amendements
aux projets de textes dépend du temps dont disposent les services de
traduction. »
Jacques Legendre rappelle « l'importance des usages
linguistiques à l'occasion de réunions informelles, que ce soit entre
ministres ou encore lors d'interruptions de séance au cours desquelles
les délégués des États membres ont l'opportunité de se concerter sur
leurs positions ». À cet égard, le français serait
« sensiblement plus présent [...], en particulier lorsqu'il
s'agit de se consulter entre délégués de pays de langue latine ou de
pays associés à l'espace francophone ».
Dans ce contexte, la Cour de justice ferait presque figure
d'ilot préservé. Traditionnellement, la langue de Molière y est
employée pour délibérer. « Cette situation n'est pas
nécessairement neutre en termes d'effets sur la
jurisprudence » remarque le parlementaire, « la Cour
étant en effet susceptible d'être plus sensible à la tradition du droit
romano-germanique qu'à la tradition juridique anglo-saxonne, inspirée
de la Common law. Le français dispose ainsi d'une position privilégiée
au sein d'une institution de quelque 1 800 agents. »
« La langue ne se résume pas, en effet, à un simple
instrument de communication », martèle le parlementaire.
« Elle est également le vecteur d'expression de cultures
politiques, juridiques et économiques spécifiques aux pays dont elle
est la langue naturelle. [...] À l'évidence, la prédominance d'une
langue, notamment dans le cadre de négociations diplomatiques,
constitue un levier d'influence majeur. »
Une âme québecoise
Nos politiques en ont-ils conscience ? Le cas
échéant, ils devraient compter avec de fortes pressions en faveur du
"tout anglais". « La traduction des documents officiels coûte
65 millions d'euros par an et par État membre », a estimé
Astrid von Busekist. « Pour huit des vingt langues
[vingt-trois désormais...], le coût de la traduction dépasse
25 euros par citoyen et [il] atteint 980 euros pour chaque
citoyen maltais. »
Jean-Pierre Raffarin s'est rendu à Bruxelles le
14 janvier, où il a rencontré les présidents du Conseil
européen, de la Commission et du Parlement. En qualité de "représentant
personnel du président de la République, il entendait défendre auprès
d'eux l'usage du français dans les institutions européennes.
« Le français ne recule que lorsque l'offre de français est
insuffisante », a proclamé l'ancien Premier ministre.
« Quand, dans une ville du monde, on ouvre une école
française, les capacités d'accueil sont immédiatement saturées. Quand
dans une institution on fragilise le français, ce sont les valeurs du
pluralisme et de l'humanisme qui sont étouffées. » Et de
lancer : « Pour le combat du français et de la
francophonie, j'ai l'âme résistante, l'âme
québécoise ! »
Le secrétariat général aux Affaires européennes signalerait
systématiquement les entorses faites au multilinguisme institutionnel
en rédigeant une protestation destinée à l'organisme pris en défaut. En
règle générale, si l'on en croit la DGLFLF, « ces initiatives
portent leurs fruits s'agissant de la publication d'annonces de
recrutement spécifiant que les candidats doivent obligatoirement être
de langue maternelle anglaise et de la publication d'appels d'offres en
anglais, d'autant plus que, dans ce dernier cas, le Commission a
l'obligation de les publier au Journal officiel de l'Union européenne.
À titre d'exemple, le secrétariat général aux affaires européennes est
intervenu, après avoir été saisi par le Centre national de la recherche
scientifique, dans le cas d'appels d'offres exigeant une réponse [...]
en anglais. »
Formons, formons !
Astrid von Busekist voudrait imposer la combinaison de
l'anglais, du français et de l'allemand « car c'est celle qui exclut le
moins : 19 % seulement des citoyens de l'Union des
quinze ne possèdent aucune de ces trois langues et ce taux s'élève à
26 % dans l'UE des vingt-cinq ». En soutenant un tel
projet, la France s'attirerait toutefois les foudres de moult
partenaires. Tout particulièrement l'Espagne, l'Italie, le Portugal,
les Pays-Bas et la Pologne, précise M. Legendre. Lequel
« invite les pouvoirs publics français à la plus grande
prudence dans leurs démarches en faveur du seul français [...], en
soulignant notamment la nécessité de ménager la susceptibilité d'autres
langues sensiblement négligées dans le processus décisionnel européen.
Il s'agit d'envisager la promotion de la diversité linguistique dans sa
globalité et de ne pas se limiter à un combat vain et naïf fondé sur un
antagonisme systématique entre le français et l'anglais. »
La priorité doit être accordée à la formation, notamment en
direction des fonctionnaires étrangers. La mise en œuvre d'un "plan
pluriannuel d'action pour le français en Europe" avec la Communauté
française de Belgique, le Luxembourg et l'OIF s'inscrit dans cette
démarche. Le budget de ce programme s'est élevé à 2,3 millions
d'euros en 2008. Ne négligeons pas non plus la formation de nos
compatriotes aux langues étrangères : anticipant de prochains
départs en retraite, la Commission européenne s'était inquiétée, le
23 septembre dernier, d'une pénurie sérieuse d'interprètes de
langue française pour les cinq à dix ans qui viennent...
Publié dans Europe, Francophonie | Pas de commentaires
18 mars 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelques mots sur le premier sommet UE-Maroc.
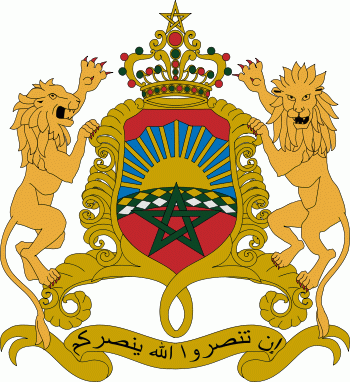
Grenade a accueilli les 6 et 7 mars le premier sommet
UE-Maroc. En marge de la réunion, Madrid n'avait pas manqué d'agiter
son étendard féministe, ouvrant un séminaire traitant des
« questions liées au genre [sic] au niveau local au Maroc et
en Espagne ».
Selon la déclaration conjointe adoptée à son issue,
« le sommet couronne une intense période d'accélération dans
les relations UE-Maroc, initiée par l'entrée en vigueur de l'Accord
d'association en mars 2000, renforcée par la mise en place du Plan
d'action, dans le cadre de la Politique européenne de voisinage, en
juillet 2005 et par l'adoption du document conjoint sur le Statut
avancé lors du Conseil d'association d'octobre 2008 ».
Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mettre en
place, à terme, un espace économique commun. Cela implique, entre
autres, « le rapprochement du cadre législatif du Maroc à
l'acquis communautaire » et « la conclusion d'un
Accord de libre échange global et approfondi ». Une approche
« globale et équilibrée » des migrations, incluant
« une coopération pour le retour et la réadmission des
migrants en situation irrégulière », devrait en outre
constituer « un élément fondamental » du partenariat
entre l'UE et le Maroc.
Lequel aurait déjà réalisé un effort de réformes majeur, selon
Angel Lossada, le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères.
L'UE y répondrait en faisant de Rabat le plus grand bénéficiaire d'aide
du programme de voisinage. L'objectif serait de « partager, à
l'avenir, tout sauf les institutions ».
Publié dans Europe | 1 Commentaire
18 mars 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelques nouvelles sur le SEAE et la défense européenne.

Les quolibets cesseraient-ils de pleuvoir ? Le
Gymnich de Cordoue (réunion informelle des ministres des Affaires
étrangères), les 5 et 6 mars, a donné lieu à quelques signes
de soutien à Mme Catherine Ashton, Haut Représentant de
l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de
sécurité. Auparavant, celle-ci avait rencontré à Paris Hervé Morin –
lequel avait raillé publiquement son absence à la réunion informelle
des ministres de la Défense... Sans doute l'heure n'est-elle plus à
l'échange de phrases assassines, tandis que s'intensifient
vraisemblablement les négociations censées définir l'architecture du
Service européen pour l'Action extérieure (SEAE).
Diplomatie féministe
Un projet doit être présenté par Mme Ashton d'ici la
fin du mois d'avril. S'exprimant devant le Parlement européen le
mercredi 10 mars, le Haut Représentant a prétendu se
distinguer des sceptiques et autres réfractaires qui
« préfèrent minimiser les pertes apparentes plutôt que de
maximiser les gains collectifs ». La Britannique a annoncé,
par ailleurs, que le SEAE serait représentatif de l'Union quant à la
géographie et... l'égalité des sexes. « C'est la seule façon
acceptable de procéder », a-t-elle même affirmé.
Le 4 mars, le ministre britannique des Affaires
étrangères, David Miliband, et son homologue suédois, Carl Bildt,
avaient publié « une lettre ouverte exprimant leurs
inquiétudes face à certaines querelles interinstitutionnelles
évidentes », selon le résumé d'Euractiv (08/03/2010).
Bien que le traité de Lisbonne ait été signé le 13 décembre
2007, on ignore encore quelles responsabilités seront retirées à la
Commission. Les deux ministres estiment « qu'une
nouvelle culture pourrait être l'aspect le plus difficile à développer
pour le SEAE ». Un enjeu souligné par notre confrère Nicolas
Gros-Verheyde : « Entre civils et militaires, entre
fonctionnaires de la Commission – soumis à une forte hiérarchie et
davantage orientés vers la gestion de programme – et ceux du Conseil
– plus petite organisation, habituée à une hiérarchie courte
et plus politique, sans compter les diplomates nationaux, il y a aussi
un abîme et des cultures fort différentes qu'il va falloir marier, avec
harmonie. » (Bruxelles 2,
05/03/2010)
Flotte aérienne militaire
Pour seconder le Haut Représentant, la France aurait présenté
au poste de secrétaire général la candidature de Pierre Vimont, actuel
ambassadeur à Washington, ancien directeur de cabinet de Michel Barnier
puis de Philippe Douste-Blazy lors de leur passage au quai d'Orsay.
Signalons enfin la création imminente d'un commandement
européen du transport aérien (EATC pour European Airlift Transport
Command) entre la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.
Selon les explications du ministère de la Défense, « il aura
pour mission de coordonner l'emploi des avions de transport militaires
des quatre nations membres, afin d'harmoniser leur planification. Cette
organisation permettra d'optimiser la rationalisation des coûts pour
l'acheminement du personnel et du fret par voie aérienne militaire.
[...] Lorsqu'une des nations membres dispose d'une capacité de
transport disponible, elle la propose aux autres nations. À l'inverse,
si elle est confrontée à un besoin urgent, elle peut solliciter les
moyens des partenaires. » C'est un pas significatif vers la
mutualisation des moyens militaires, dont la crise rend la tentation
d'autant plus pressante.
Publié dans Défense, Europe | Pas de commentaires
8 mars 2010
Le Conseil prétend éradiquer la violence à l'égard des femmes
dans l'Union européenne. Aperçu de ses conclusions.

En ce lundi 8 mars, décrété journée internationale de
la femme par l'Organisation des Nations unies, le Conseil a adopté des
conclusions « concernant l'éradication de la violence à
l'égard des femmes dans l'Union européenne ». Ce
document de sept pages s'inscrit dans la continuité de
l'abondante littérature consacrée à l'égalité hommes-femmes par les
institutions européennes, dont les ministres énumèrent moult références.
On relève quelques orientations concrètes :
« promouvoir l'introduction d'un numéro de téléphone commun et
gratuit [...] pour fournir des informations précises et actualisées et
une assistance aux femmes victimes de la violence » ;
« renforcer la protection des femmes victimes de la violence
lorsqu'elles exercent leur droit à la libre circulation au sein de
l'Union européenne » (des négociations sont en
cours) ; « prendre les premières mesures en vue de la
création d'un observatoire européen de la violence envers les femmes,
en s'appuyant sur les structures institutionnelles
existantes » (tel l'Institut européen pour l'égalité entre les
hommes et les femmes, fraîchement installé à Vilnius, en Lituanie).
Études et statistiques insuffisantes
« On ne dispose toujours pas de données à jour,
fiables, précises et comparables, tant au niveau national qu'au niveau
de l'UE », déplore le Conseil, « et le phénomène de
la violence à l'égard des femmes n'a toujours pas fait l'objet d'une
étude approfondie au niveau de l'UE, ce qui limite la perception que
l'on peut avoir de son ampleur véritable et empêche le développement de
stratégies et de mesures au niveau national ainsi qu'une réaction
efficace au niveau de l'UE ». En outre, il
serait « essentiel d'aborder sur un plan
international l'échange de connaissances, de méthodes et de meilleures
pratiques au sein de l'UE et avec des pays tiers ayant une certaine
expérience de la lutte contre les pratiques traditionnelles
préjudiciables (telles que les mutilations génitales féminines) et
contre la traite des êtres humains ».
Selon les ministres, « la lutte contre la violence à
l'égard des femmes passe par une participation active des hommes,
permettant de remettre en cause les idées reçues et les rôles dévolus
aux hommes et aux femmes afin de promouvoir des relations basées sur le
respect, l'égalité et les valeurs démocratiques ». Aussi
invitent-ils la Commission et les États membres à « réaliser
des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation pour
lutter contre des normes culturelles discriminatoires et venir à bout
des stéréotypes sexistes très répandus et de la stigmatisation sociale
qui légitiment et perpétuent la violence à l'égard des
femmes ».
Manifestement, le Conseil exclut l'hypothèse selon laquelle la
violence masculine serait le « corollaire tragique et
inexcusable » de la « dévaluation de la
virilité » – thèse qui serait vraisemblablement celle
Mme Claude Habib. « Face à la multiplication des
viols, au développement des violences conjugales, à la perte du respect
dû aux femmes par des hommes déboussolés, qui semblent répondre par la
brutalité ou le mépris à l'agression symbolique du féminisme, elle veut
croire à un sursaut de cette générosité virile qui est au fond
l'essence de la galanterie », rapporte
Stéphane Blanchonnet. « Retrouver les voies de
l'apaisement, de l'amour et de la confiance entre les hommes et les
femmes, c'est d'abord cesser de dénier aux hommes leur rôle de
protecteurs naturels, rôle qu'ils souhaitent jouer spontanément à
l'égard de leur compagne mais qui est constamment moqué, tourné en
dérision, ringardisé (comme tout ce qui rappelle les différences, les
inégalités, les traditions) dans le discours médiatique, la fiction
télévisuelle ou la publicité. » Ainsi que dans les arcanes
européens.
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaires