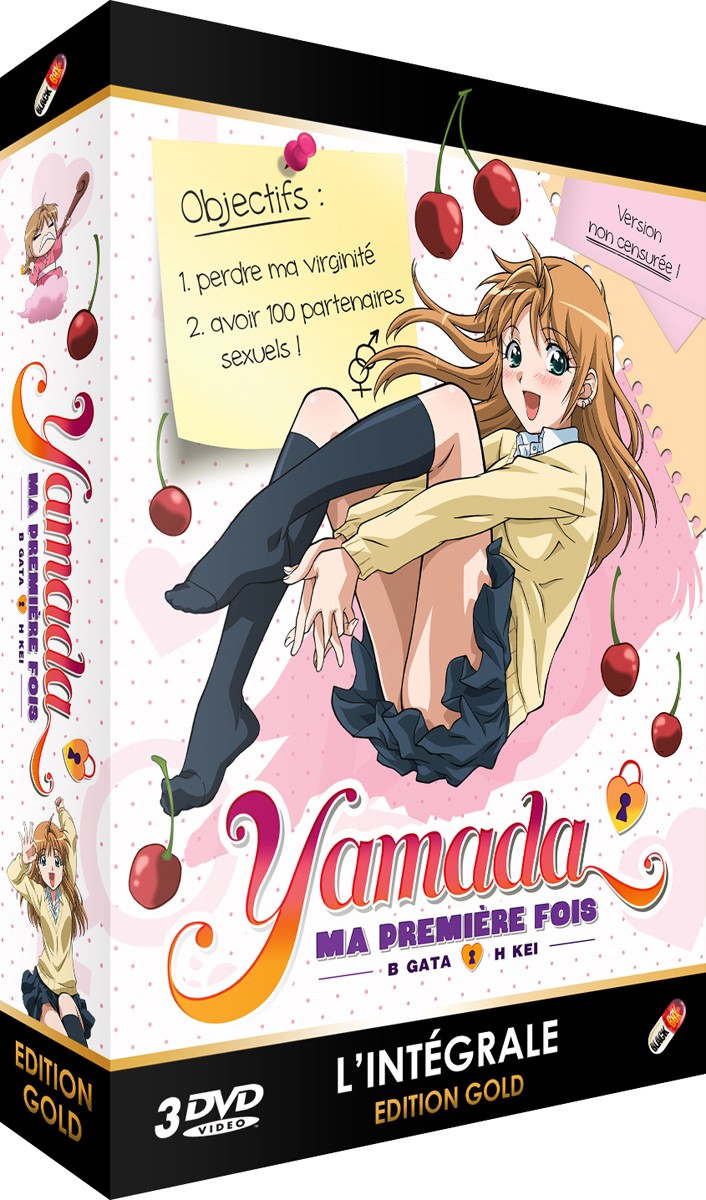17 décembre 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
La première réunion d'un "comité de pilotage sur la stratégie
d'influence par le droit" s'est tenue le 3 décembre 2014.

Avocats, notaires, experts comptables et autres juristes
seront bientôt conviés à s'y associer, a
annoncé le Quai d'Orsay. Dans
un avis adopté en septembre, le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) avait appelé à mieux coordonner les acteurs
concernés. Selon son rapporteur, David Gordon-Krief, « l'enjeu
pour la France est de mettre en avant les atouts de l'adoption de notre
système de droit continental sur différents
segments » : partenariats publics-privés, propriété,
protection des données personnelles... À cet égard, précise-t-il,
« le CESE juge essentiel d'accorder une meilleure place à
l'assistance juridique dans les programmes d'aides au
développement ». À titre d'exemple, déplore-t-il,
« le nombre d'experts juridiques français mobilisés au plan
international est passé de 2 463 en 2001 à 574 en
2014 ».
Paradoxe français
Schématiquement, explique-t-il, « la jurisprudence
est la source naturelle du droit dans les systèmes issus de la Common
Law [...], alors qu'elle est, du moins d'un point de vue
conceptuel, une source "secondaire" du système continental ».
Sécurité, fiabilité et prévisibilité caractériseraient le droit
continental. Cela étant, bien qu'il s'inscrive dans cette tradition, le
droit français ne serait « pas exempt de défauts »,
au point qu'il serait « devenu moins stable que celui des pays
de la Common Law » – un paradoxe. La
compétitivité de l'économie nationale s'en trouve dégradée, à l'heure
où « certains justiciables, singulièrement les firmes
multinationales, sont [...] en situation de choisir le régime juridique
qui gouvernera leur activité ».
En outre, soutient le CESE, « au travers de la
diffusion d'éléments de son corpus juridique, la France porte un
certain nombre de valeurs et au-delà une certaine vision du monde et de
la globalisation ». De fait, le "colbertisme" et ses velléités
régulatrices s'accommodent mieux du droit continental. Mais si les
libéraux s'en méfient, tous ne le condamnent pas :
« un droit codifié ne favorise pas nécessairement
l'intervention de l'État&;nsbp», écrit
ainsi Philippe Fabry sur Contrepoints ;
selon lui, « dans la France d'Ancien Régime, ce fut même le
contraire ».
Publié dans Droit, Idées | Pas de commentaires
10 décembre 2014
Entre autres dispositions, le projet de loi « pour la
croissance et l'activité », présenté aujourd'hui, mercredi
10 décembre 2014, en conseil des ministres, prévoit d'assouplir
les règles restreignant le travail dominical. Au grand dam des
conservateurs, dont tous les arguments ne sont pas recevables – c'est
le moins que l'on puisse dire !

Pourquoi nos compatriotes désargentés se risqueraient-ils à
faire le dimanche des achats qu'ils ne pourraient pas s'autoriser les
autres jours, se demandent-ils naïvement. Esquissons un raisonnement
par l'absurde : si cette question était pertinente, les distributeurs
n'auraient-ils pas intérêt à ce que leurs magasins soient ouverts
chaque semaine non pas un jour de plus, mais un jour de
moins ? À chiffre d'affaires équivalent, cela réduirait leurs
frais, au bénéfice de leurs marges ! Manifestement, telle
n'est pas leur revendication. Pourquoi n'en est-il pas ainsi ?
Tout simplement parce que l'économie n'est pas un jeu à somme nulle.
Les travailleurs du dimanche bénéficient d'une rémunération
inévitablement réinjectée dans le circuit économique, que ce soit par
la consommation ou l'épargne. Et si leur employeur consent à les
rétribuer, c'est, précisément, parce qu'ils participent à une "création
de richesse" – en l'occurrence, la mise à disposition de produits ou
services. De quoi susciter une hypothétique inflation, mais aussi
ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de consommation :
certains ménages optimiseront leurs achats, feront des économies ici
pour dépenser davantage ailleurs...
Cela au détriment de leur vie familiale ? Peut-être,
mais pas forcément. À vrai dire, l'inverse est tout à fait
envisageable : les heures de travail étant réparties sur une
plage élargie, il n'est pas impossible que la prise en compte des
attentes des uns et des autres s'en trouve facilitée. Concrètement,
peut-être deux conjoints auront-ils d'autant plus de chances de
bénéficier d'un jour de repos commun, quand l'un d'entre eux travaille déjà dans la restauration, par exemple (nous l'avons observé dans notre
entourage) ; et peut-être une mère de famille
abandonnera-t-elle volontiers ses enfants quelques heures chaque week-end,
si cela lui permet de les embrasser chaque soir avant qu'ils ne
s'endorment, ou, mieux encore, d'aller les chercher tous les jours à la
l'école...
Il y a comme un déni du réel dans l'affirmation que le travail
dominical saperait nécessairement la vie des familles. Ainsi qu'une
certaine forme d'intolérance, les uns voulant imposer aux autres le
partage de leurs propres habitudes. Mais peut-être effleure-t-on ici le
principal enjeu du débat : y aurait-il un quelconque intérêt à
ce que non pas tous les membres d'une même famille, mais la plupart des
citoyens d'une nation tout entière, partagent un jour de repos
commun ? Nous serions curieux d'entendre les arguments avancés
en faveur de cette thèse, sans cacher que notre attachement croissant
aux libertés rend leur sacrifice de plus en plus difficilement
justifiable à nos yeux.
Publié dans Économie et Industrie, Société | Pas de commentaires
10 décembre 2014
Selon la présidente du FN, la police devrait prendre exemple
sur les héros des séries télévisées américaines. Cela promet...

L'affaire a déjà fait grand bruit. L'usage de la torture
est-il « excusable » dans certaines
circonstances ? Interrogée ce matin, mercredi
10 décembre 2014, par Jean-Jacques Bourdin, sur le plateau de BFM TV,
Marine Le Pen a répondu sans ambiguïté :
« il peut y avoir des cas », a-t-elle déclaré,
« quand une bombe – tic, tac ; tic, tac ;
tic, tac – doit exploser dans une heure ou dans deux heures, et
accessoirement peut faire deux cents ou trois cents victimes civiles,
où il est utile de faire parler la personne pour savoir où est la
bombe », et cela « avec les moyens qu'on
peut » – autrement dit, sous la torture si nécessaire.
Ce faisant, Marine Le Pen ne se contente pas de transgresse un
tabou éthique. De sa part, d'ailleurs, cela n'est qu'à moitié
surprenant : ne marche-t-elle pas dans les pas de son
père ? D'un point de vue politique, peut-être y a-t-il plus
grave. En effet, le scénario invoqué par la présidente du FN s'inspire
directement des fictions produites outre-Atlantiques, à commencer par 24 heures
chrono, dont le héros damné est appelé à mettre la morale au
placard pour déjouer un attentat imminent. C'est un comble :
Marine Le Pen a beau relayer servilement la propagande de
Moscou, son esprit n'en est pas moins perverti par le soft
power américain !
Or, tout cela, c'est à la télévision. Dans la "vraie vie",
nous doutons qu'aucun agent de la DGSI n'ait jamais été confronté à
pareil scénario. Et si certains l'avaient été, sans doute ne se
seraient-ils pas mépris quant à la portée de leur action :
couper les doigts d'un suspect contribuerait sans doute à le faire
parler, mais vraisemblablement pour lui faire dire n'importe quoi.
En vérité, Jack Bauer n'existe pas, et c'est tant mieux comme ça. On
s'étonnera néanmoins qu'un personnage prétendant présider aux destinées
de l'État puisse s'imaginer le contraire. Selon son père, Marine
Le Pen serait pourtant « du gabarit de
Mme Merkel ou de Mme Thatcher ». Au moins le
Menhir n-a-t-il pas perdu son humour.
Publié dans Politique | Pas de commentaires
3 décembre 2014
Une fois n'est pas coutume, nous nous risquons à faire la
promotion d'une série animée. Cela nous change des considérations trop
terre à terre sur la politique, l'économie et la défense !
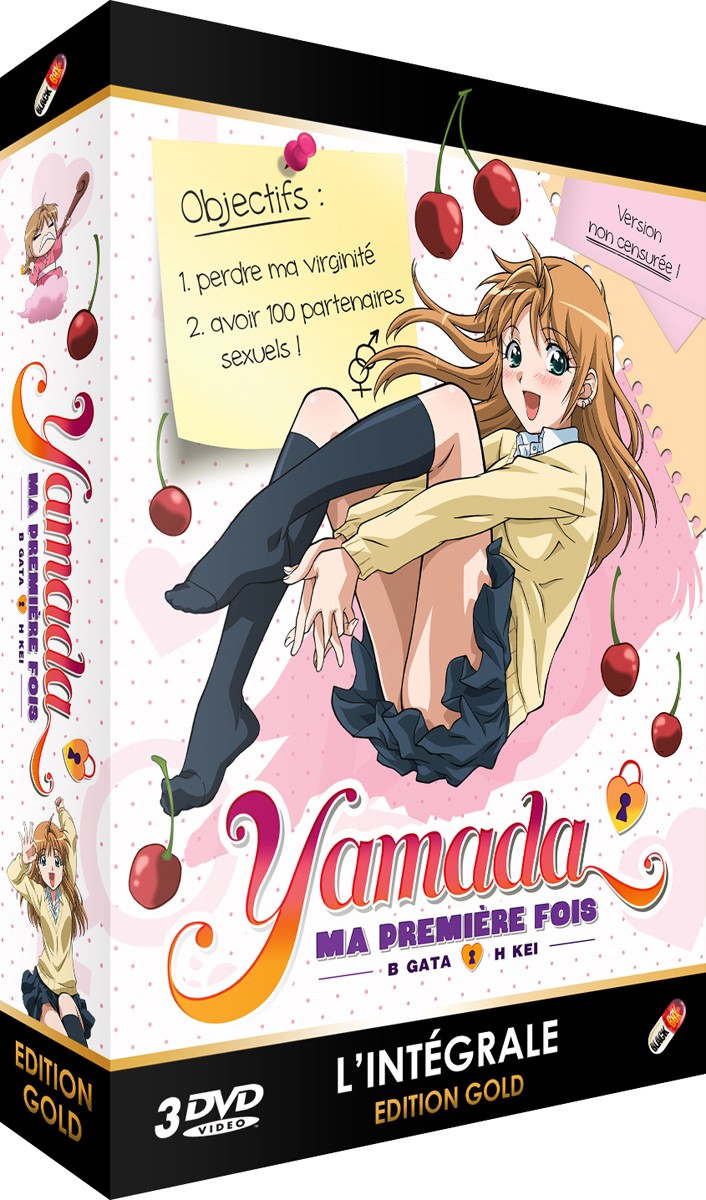
Le titre s'avère intraduisible, aussi comprenons-nous le
choix des éditeurs, lesquels y ont renoncé en France comme
aux États-Unis. Littéralement,
"B Gata H kei" signifierait "Type B Style H"
– autrement dit, "blondasse obsédée" ? Plus ou moins, quoique
le synopsis ne donne qu'un aperçu assez réducteur de la série, et que
le "fan service" (les petites culottes et autres images coquines) y
soit distillé à doses modérées.
Alors qu'elle entre au lycée avec le projet de collectionner
au plus vite une centaine d'amants, Yamada tarde à conclure avec le
tout premier. Elle jète son dévolu sur un camarade de classe, le timide
Kosuda, déstabilisé par ses assauts indélicats et sa relative
versatilité. De fait, le tempérament licencieux de l'héroïne dissimule
à peine sa sensibilité, sa détermination étant indissociable d'une
incomparable ingénuité (dont la VO rend vraisemblablement beaucoup
mieux compte que le doublage français, auquel nous ne nous sommes pas
frotté). À vrai dire, cette gamine se révèle terriblement touchante –
on en tomberait presque amoureux !
Aussi avons-nous découvert avec un réel plaisir les douze épisodes
de cette anime, adapté d'un manga qui semble
encore inédit en France : c'est drôle, léger, pas forcément
inoubliable, mais plein de fraîcheur !
Terminons par une parenthèse plus sérieuse (on ne se refait pas) : alors
que l'action se déroule souvent au lycée, le seul élément touchant
explicitement au contenu des cours porte sur l'histoire de France, et
plus précisément sur Henri IV, dont les élèves apprennent
qu'il fut le premier Bourbon ; quant au déclin démographique
de l'Archipel, l'inénarrable Yamada envisage d'y remédier par une
proposition pour le moins iconoclaste, dont on ne comprend toutefois la
teneur qu'en sachant quel statut occupe la honte dans la culture
japonaise...
Publié dans Non classé | Pas de commentaires
3 décembre 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
Chef de file de "l'Europe spatiale", la France a su jouer la
carte multilatérale au bénéfice du lanceur Ariane, dont la sixième
génération vient d'être mise en chantier.

Enthousiasmé par la « merveilleuse
aventure » de la sonde Rosetta, notre confrère Bruno Dive
s'est demandé dans Sud Ouest « quelle
meilleure réponse » pouvait être apportée « à tous
les professionnels de l'euroscepticisme ». C'est oublier que
ceux-ci dirigent leurs attaques surtout contre Bruxelles, qui ne
dispose explicitement d'une compétence en matière spatiale que depuis
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre
2009. De fait, à l'exception notable de Galileo (l'alternative
européenne au GPS américain), les programmes spatiaux menés à l'échelle
du Vieux-Continent le sont sous l'égide non pas de l'Union européenne
(UE), mais de l'Agence spatiale européenne (ESA), qui s'en distingue
par son caractère intergouvernemental. « Jusqu'à
présent », souligne Guilhem Penent, dans
un ouvrage consacré à l'Europe spatiale (1),
celle-ci « a toujours été considérée comme le moyen de
concrétiser une ambition nationale » ; ni l'ESA, ni
les États membres ne s'en sont jamais cachés » :
« le mode de financement, la pratique du "juste retour"
géographique, la structure même de l'organisation, sont d'ailleurs
suffisamment explicites pour rendre inutile et déplacée une telle
pudeur ».
Un pari gagnant
Cela étant, peut-être Paris verrait-il d'un bon œil
l'intégration de l'ESA à l'UE. Ce faisant, sans doute espérerait-il
tirer à lui la couverture du budget communautaire, au bénéfice de ses
propres investissements : « avec 30 euros
par an et par habitant dédiés au spatial civil », rappelle
Guilhem Penent, « la France a dans ce secteur le deuxième
budget au monde, derrière les États-Unis (46 euros), mais
devant l'Allemagne (16 euros) et le Royaume-Uni
(6 euros) ». Quoi qu'il en soit, sous une forme ou
sous une autre, l'Europe demeurera le cadre structurant (mais non
exclusif, comme en témoigne, par exemple, la coopération avec l'Inde)
de la politique spatiale de la France, étant entendu que « le
coût et la complexité inhérents à la technique spatiale sont tels
qu'aucune nation européenne ne saurait développer une capacité spatiale
autonome et compétitive sur ses fonds propres ». Dans le cas
présent, la carte européenne nous apparaît d'autant plus pertinente que
Paris est parvenu à la jouer tout en assurant la maîtrise d'œuvre du
programme Ariane, dont « la percée [...] sur le marché mondial
des lancements est très certainement le signe extérieur de réussite le
plus spectaculaire de l'Europe spatiale ».
La menace SpaceX
Fiabilité, disponibilité et adaptabilité ont garanti, jusqu'à
présent, le succès commercial du lanceur européen. Mais qu'en sera-t-il
demain ? Ariane ne se prête plus très bien à la mise en orbite
des satellites institutionnels, devenus trop légers pour rentabiliser
l'emploi d'un lanceur aussi puissant. Quant aux satellites commerciaux,
leur poids diminue à mesure qu'ils adoptent une propulsion électrique.
Parallèlement, la concurrence s'intensifie. Ses assauts les plus
virulents émanent d'un nouveau venu, SpaceX. Créée en 2002 par
l'entrepreneur américain Elon Musk, par ailleurs cofondateur de Paypal
et Tesla Motors, cette société développe un lanceur dont le premier
étage devrait être réutilisé d'un tir à l'autre dès l'année prochaine –
une première ! Aussi les clients d'Arianespace pressent-ils
Paris et ses partenaires de se mettre à la page. Eutelsat s'est d'ores
et déjà porté candidat pour prendre part au premier lancement
d'Ariane 6, dont l'avenir a été tracé mardi dernier,
2 décembre, à l'issue de la conférence ministérielle des États
membres de l'ESA. « Alors qu'Ariane 5 a été conçue
pour être un moteur de développement pour l'Europe spatiale [...],
Ariane 6, envisagée pour 2021-2022, vise au contraire à
minimiser les coûts de développement, la durée de
développement, et les coûts d'exploitation », explique Guilhem
Penent. Cependant, Paris doit compter avec les réticences de Berlin,
qui privilégie le développement d'Ariane 5 ME (midlife
evolution), une version modernisée du lanceur actuel.
Frilosité allemande
Il est vrai que la négociation semblait mal engagée :
la France « se contente de poursuivre sur sa lancée en
proposant plus ou moins unilatéralement une nouvelle version du lanceur
Ariane », déplore Guilhem Penent : « de fait
la configuration Ariane 6 de type PPH, deux étages à poudre et
un étage à hydrogène et oxygène liquides, a été retenue sans que le
reste des Européens apparaissent véritablement sollicités ».
Selon notre confrère Alain Ruello, « les doutes de Berlin ne
sont pas illégitimes ». « Avec un premier tir prévu
en 2020 », souligne-t-il dans Les Échos,
« le projet Ariane 6 tel qu'il se dessine revient à
tirer un trait sur Ariane 5 ME [...] car les budgets
ne permettent pas de tout faire dans un laps de temps aussi rapproché.
Mais l'histoire des grands projets montre qu'ils sont souvent sujets à
retard, et donc à surcoûts. »
Cela dit, « si l'Allemagne soutient contre vents et
marées un tel programme », remarque Guilhem Penent, dans
une note publiée par l'Ifri (Institut français des relations
internationales) (2), « c'est non seulement parce qu'il lui
paraît le meilleur scénario face à la concurrence américaine, mais
c'est aussi parce que ce lanceur est le plus favorable à son
industrie ». À cela s'ajoutent des divergences plus
fondamentales. En effet, « l'Allemagne n'a [...] jamais caché
qu'elle n'accordait pas la même importance à l'objectif
d'autonomie ». Berlin a même souscrit aux services de SpaceX
pour lancer ses satellites d'observation radar – une
trahison ! Autrement dit, « alors que l'Allemagne
privilégie les aspects technologiques et industriels, la France propose
une approche à la fois plus globale [...] et plus politique du
spatial ». Sans doute cela explique-t-il également son
immixtion, encore trop timide cependant, dans l'analyse autonome des
menaces pesant sur les satellites en orbite, devenues critiques avec la
multiplication des débris spatiaux. « Fait remarquable, la
première collision jamais répertoriée a d'ailleurs affecté un satellite
militaire français », rappelle Guilhem Penent. C'était en
1986. Preuve que la France fait toujours figure de pionnier, fût-ce à
son corps défendant !
1 – Guilhem Penent, L'Europe spatiale, le déclin ou
le sursaut, Argos, 190 pages, 15 euros.
2 – Guilhem Penent, Ariane 6 – Les Défis
de l'accès à l'espace en Europe, Actuelles de l'Ifri,
novembre 2014.
Publié dans Espace | Pas de commentaires
19 novembre 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
Chantre de la mondialisation, Jacques Attali n'en est pas
moins un promoteur de la francophonie. Certaines de ses mises en garde
méritent notre attention, afin que la France utilise au mieux ses
atouts.

Lors du sommet de Dakar (29 et 30 novembre 2014)
devrait être présentée une "stratégie économique pour la Francophonie".
S'agira-t-il d'un premier pas vers la création d'une "Union économique
francophone" ? Tel est l'espoir de Jacques Attali, revendiqué
en conclusion d'un rapport remis fin août au chef de l'État.
« Le potentiel économique de la francophonie est énorme et
insuffisamment exploité par la France », martèle l'ancien
conseiller du président Mitterrand.
« L'ensemble des pays francophones et francophiles
représentent 16 % du PIB mondial », souligne-t-il,
« avec un taux de croissance moyen de 7 %, et près de
14 % des réserves mondiales de ressources minières et
énergétiques ». Naturellement, « le partage par les
populations de plusieurs pays d'une même langue augmente leurs
échanges » – de 65 % environ, nous précise-t-il.
Est-il bien raisonnable de chiffrer pareil phénomène ? Quoi
qu'il en soit, s'inquiète Jacques Attali, « des circuits
économiques sont en train de se créer dans les pays francophiles et
francophones sans la France » : « c'est le
cas le secteur minier notamment (Canadiens en Afrique), ou dans
l'éducation supérieure (Québec) ». De fait, Paris serait tenté
« par un repli sur sa sphère nationale », que
traduirait « la baisse significative » de sa
contribution au budget de l'OIF, réduite d'un quart depuis 2010. C'est
un calcul de court terme, dénonce le rapporteur. Dans l'ensemble des
pays d'Afrique, prévient-il par ailleurs, « le déséquilibre
entre le nombre d'enfants à scolariser et le nombre d'enseignants va
s'accroître dans les prochaines années ». C'est pourquoi,
« faute d'un effort majeur, on pourrait assister [...] à un
recul de l'espace francophilophone ».
Le français dans l'entreprise
Dans les entreprises se ressentirait « un certain
manque de "patriotisme linguistique" ». À tel point que
« certaines compagnies françaises installées en Asie du
Sud-Est paradoxalement détournent les étudiants de ces pays de
l'apprentissage du français en exigeant la connaissance de l'anglais à
l'embauche ». Pourtant, « la culture d'une entreprise
mondiale d'origine française est plus facile à appréhender pour le
personnel local lorsqu'il maîtrise le français ». Renault
l'aurait constaté dans la foulée de sa fusion avec Nissan :
« L'usage généralisé de l'anglais comme langue de l'alliance
avec le groupe japonais s'est avéré être un handicap et a été à
l'origine d'un rendement réduit de part et d'autre. Renault a depuis
choisi de donner des bourses à des Japonais pour étudier le français en
France. » Quant à l'usage accru de l'anglais dans l'Hexagone,
« cela aurait des conséquences économiques
négatives », estime Jacques Attali ; selon lui,
« l'usage d'une langue étrangère au travail crée [...] un
déficit de productivité et de cohésion sociale ».
Alors que des entreprises françaises « choisissent de
contracter entre elles en anglais selon des modèles de contrats
anglo-saxons », les cabinets d'avocats français,
« malgré leur expertise reconnue », seraient
« très peu implantés à l'étranger en comparaison avec les
cabinets anglo-américains », dont l'influence est telle qu'ils
« structurent l'imagination des financiers ». Le
droit continental s'en trouve affaibli, ce dont pourrait pâtir le
développement de l'Afrique. Le droit anglo-saxon « étant
jurisprudentiel », explique Jacques Attali, « son bon
fonctionnement requiert l'existence d'une justice efficace et d'une
jurisprudence abondante, permettant aux avocats d'assurer une certaine
sécurité juridique aux entreprises ». Or, « en
l'absence de tels pré-requis, l'insécurité juridique pourrait
désinviter les entreprises à investir dans ces pays ».
Les frontières périmées ?
Afin d'accroître ces investissements, Jacques Attali propose,
sans surprise, de « favoriser la mobilité » des
travailleurs. « Le nombre d'expatriés français est plus faible
que le nombre d'expatriés britanniques ou allemands »,
regrette-t-il : « respectivement
2,5 millions, 3 millions et
4 millions ». Quant à l'immigration professionnelle,
elle est jugée « peu développée en France ».
Indifférent aux pressions de l'opinion, Jacques Attali vante même les
mérites des délocalisations. Selon lui, « l'externalisation
d'une partie de la chaîne de valeur française dans les pays du sud de
la Méditerranée pourrait être bénéfique, aussi bien aux entreprises
françaises qu'aux pays d'accueil ». En effet, « cette
stratégie permettrait aux entreprises françaises [...] d'améliorer leur
compétitivité, et répondrait aux forts besoins en croissance et en
emplois des économies nord-africaines ». Les implantations au
Maroc de Renault, Sanofi-Aventis et Accor seraient autant de réussites
illustrant le « caractère potentiellement
gagnant-gagnant » des « colocalisations ».
Dans son esprit, donc, la francophonie n'est pas une
alternative à la mondialisation. Au contraire. De son point de vue, «
la tendance de fond de l'économie mondiale est de périmer l'idée
d'espaces économiques construits autour de frontières étatiques et de
repenser les espaces d'échanges et de coopération autour de communautés
d'autres natures ». Quoique celles-ci demeurent promues au
bénéfice des États : « le Brésil se sert notamment de
la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) pour favoriser son
implantation dans des pays lusophones comme l'Angola ou le Mozambique
ainsi que sa pénétration de ces marchés », observe Jacques
Attali. Puisse la France en faire autant !
Publié dans Francophonie, Monde, Mondialisation | Pas de commentaires
19 novembre 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
Qu'est-ce que le genre ? Pourquoi cette notion
fait-elle débat ?

Telles sont les questions auxquelles prétend répondre ce livre
d'une centaine de pages. Dans l'esprit de ses auteurs, il s'agit de
remettre quelques pendules à l'heure : « il est faux
de laisser penser qu'il existerait une théorie du genre » –
autrement dit, « un corpus idéologique homogène » –,
explique Laure Berreni. Les "études de genre" n'en sont pas moins
inspirées par la conviction qu'il existerait « un rapport de
domination socialement construit des hommes sur les femmes ».
Manifestement, ces recherches se prêtent aux hypothèses les plus
hardies : « ce qui est particulièrement
frappant », dans les manuels controversés de SVT (sciences de
la vie et de la terre), remarque Laure Berreni, « c'est que la
naturalité de la dichotomie mâle-femelle n'est pas
ébranlée » ; quant à l'approche des masculinités de
Connell, rapporte Mathieu Trachman, elle soulignerait « le
caractère frictionnel d'une théorie qui partage l'humanité entre deux
groupes de sexe différent ».
Évoquant son caractère historiquement militant, Laure Berreni
soutient que « la recherche "féministe" n'est [...] pas moins
objective que la recherche mainstream »,
d'autant qu'« elle explicite ses présupposés politiques au
lieu de les masquer ». « En dénaturalisant la
différence des sexes », renchérit Éric Fassin, le "genre"
serait « désormais un outil scientifique, en même temps qu'une
arme politique, au service de la critique des normes ». Selon
lui, « il s'agit bien de savoir si cet ordre est fondé, une
fois pour toutes, par un principe transcendant ».
« Tel est in fine l'enjeu »,
conclut-il : « l'extension de la logique démocratique
au domaine sexuel ». Cette perspective est-elle censée nous
rassurer ? Selon Maurras, rappelons-le, « la
démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort ».
Sous la direction de Laure Bereni et Mathieu Trachman, Le
Genre – Théories et controverses, Presses universitaires de
France, 112 pages, 8,50 euros.
Publié dans Féminisme & Genre, Livres | Pas de commentaires
11 novembre 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
Un énième rapport « relatif à la lutte contre les
stéréotypes » a été remis au gouvernement.

S'exprimant au nom du Haut Conseil à l'égalité entre les
femmes et les hommes (HCEFH), ses auteurs promeuvent « la
budgétisation sensible à l'égalité femmes-hommes, et en particulier le
mécanisme d'"éga-conditionnalité" des financements publics »,
en vertu duquel ceux-ci seraient subordonnés « au respect de
l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les stéréotypes de
sexe ».
« Les biens et services publics financés doivent
bénéficier de manière égale aux femmes et aux hommes »,
soutiennent les rapporteurs, qui donnent en exemple la ville de
Toulouse, dont la municipalité « s'est donné pour objectif
d'opérer un rééquilibrage de l'attribution des subventions en faveur
des associations sportives de femmes ». Selon eux, une telle
démarche devrait inspirer l'ensemble des politiques publiques.
Naturellement, la priorité est donnée à l'École : « à
court terme », les collectivités locales finançant l'achat de
manuels scolaires devraient veiller à ce que ceux-ci assurent, entre
autres, « la valorisation des femmes dans l'histoire des
savoirs ». L'enjeu serait « de faire coexister un
moyen terme entre le respect du principe constitutionnel de la liberté
d'expression [...] et le principe constitutionnel du respect de la
dignité de la personne humaine ». Vraisemblablement aux dépens
du premier de ces principes. « Hormis le début de
caractérisation du sexisme ordinaire en droit du travail »,
déplorent les rapporteurs, « les propos, "blagues", ou
comportements sexistes, ne sont pas visés en tant que tels par le
droit ».
« La budgétisation sensible à l'égalité femmes-hommes
ne constitue en aucune manière une remise en question de
l'universalisme républicain », se défendent-ils. De leur point
de vue, « tant que l'égalité n'est pas atteinte, et que les
réalités des femmes et des hommes sont différentes et inégalitaires,
alors les politiques publiques ne peuvent être neutres ».
Quant aux inquiétudes soulevées par la poursuite d'une pareille utopie,
elles sont balayées avec mépris : la hantise « de
l'indifférenciation des sexes et du risque du déséquilibre psychique et
social » ne serait qu'une « ritournelle
historique ». Vraiment ?
Ayatollah – Dans les années
quatre-vingt, Yvette Roudy, ministre des Droits des femmes, avait
proposé une législation « antisexiste » ouvrant la
voie à de nouvelles poursuites pénales, comme le rappelle le Haut
Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEFH) dans le
rapport présenté ci-dessus. Adopté en conseil des ministres, ce projet
de loi avait « provoqué chez les médias une réaction unanime
d'une rare violence ». Si bien qu'il ne fut jamais inscrit à
l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. « Les journaux
comparèrent Yvette Roudy à l'ayatollah Khomeny », rapporte le
HCEFH. Preuve que les temps ont changé, nos confrères de Valeurs
actuelles se sont exposés aux pires suspicions pour avoir
fait de même avec Najat Vallaud-Belkacem... Depuis 2004, souligne
d'ailleurs le HCEFH, « l'intégralité des dispositions de ce
projet de loi figure dans notre législation ».
Publié dans Féminisme & Genre | Pas de commentaires
22 octobre 2014
« Qu'est-ce que le genre ? Pourquoi cette
notion fait-elle débat ? » Telles sont les questions
auxquelles prétend répondre, selon sa quatrième de couverture, un livre
d'une centaine de pages paru ce mois-ci (octobre 2014) aux Presses
universitaires de France (PUF).

Dans l'esprit de ses auteurs, il s'agit de remettre quelques
pendules à l'heure. « Il est faux de laisser penser qu'il
existerait une théorie du genre » – autrement dit,
« un corpus idéologique homogène » –,
explique Laure Berreni. « Ce qui relie entre elles les études
de genre », précise-t-elle, « c'est avant tout un
objet de recherche commun ». Parmi leurs « dimensions
analytiquement centrales » figureraient « l'adoption
d'une posture constructiviste », c'est-à-dire
« anti-essentialiste », mais aussi
« l'existence d’un rapport de pouvoir, d'une asymétrie, d'une
hiérarchie, entre les hommes et les femmes, le masculin et le
féminin ». Soutenant « l'idée d'un rapport de
domination socialement construit des hommes sur les femmes »,
Laure Berreni s'oppose à Mona Ouzouf ou Élisabeth Badineter, lesquelles
« défendaient l'exception française en matière de rapports
entre les sexes, selon elles marquée par une culture du "doux commerce
entre les sexes", et qui rendait soi-disant impossible, non seulement
linguistiquement mais aussi culturellement, l'importation des gender
studies prospérant dans les universités
américaines ».
Étonnamment, Anthony Favier « conteste l'idée d'une
réception seulement négative par le catholicisme des études féministes,
et de leur surgeon que constituent les études de genre ».
« Depuis l'été 2013 », nous dit-il, « le
champ des intellectuels mobilisés dans le catholicisme français pour
comprendre le genre change » ; « à la
première génération, marquée par l'intransigeance »
succéderaient « des intellectuels mieux outillés et plus
informés, qui abandonnent les outrances de
naguère » : « leurs écrits sophistiquent,
certes, la condamnation, mais concèdent qu'il existe un questionnement
pertinent en termes de genre ». Plus concrètement, une
distinction serait établie, y compris par les évêques français, entre
« études de genre universitaires appréciables d'un
côté » et « idéologie militante condamnable de
l'autre ».
Reste à démêler le bon grain de l'ivraie. Cela s'annonce
d'autant plus délicat qu'en la matière, la recherche universitaire
baigne dans la culture militante. Ce champ d'études « plonge
ses racines dans une longue tradition de recherches constituée dans le
sillage des mouvements féministes des années 1960 et 1970 »,
rappellent Laure Bereni et Mathieu Trachman. « Pour répondre
aux accusations de non-scientificité brandies par les adversaires des
études sur le genre, on peut puiser dans des travaux d'épistémologie
critique, féministes notamment », plaide Laure Berreni.
« Ces travaux ont dénoncé l'épistémologie scientiste, fondée
sur l'idée que les sujets de la connaissance sont capables de
s'abstraire du contexte social dans lequel ils s'inscrivent et des
rapports de pouvoir dans lesquels ils sont pris. Ils ont montré à quel
point la science "normale" est imprégnée de préjugés de genre et
contribue à reproduire l'ordre social inégalitaire. La recherche
"féministe" n'est donc pas moins objective que la recherche mainstream :
elle explicite ses présupposés politiques au lieu de les
masquer. » Ces travaux produiraient-ils leur propre
justification ? « En réalité », confirme
Éric Fassin « loin de contrevenir aux règles de la science,
les études de genre nous invitent à en expliciter les "point de vue" le
plus souvent implicites. » Quitte à contester les "vérités"
les mieux établies.
À cet égard, en dépit de la controverse suscitée par leur
publication, les quelques pages de trois manuels de SVT (sciences de la
vie et de la terre) inspirées par les "études de genre" s'avèrent bien
timides. « Ce qui est particulièrement frappant »,
remarque Laure Berreni, « puisqu'il s'agit de manuels de
biologie, c'est que la naturalité de la dichotomie mâle-femelle n'est
pas ébranlée ». « Dans le manuel Hachette, par
exemple, il est écrit que le "sexe biologique" est le "seul sexe bien
établi", et qu'il "nous identifie mâle ou femelle". D'une certaine
manière, ces manuels s'inscrivent dans un premier âge de la critique
féministe de la naturalité de la différence des sexes, qui considère la
vérité biologique du sexe (le fait qu'il y ait naturellement et
évidemment deux sexes et qu'on ne puisse pas être des deux ou d'aucun
des deux) comme un buttoir naturel. » Or, comme le rapporte
Michal Raz, présentant les travaux d'Anne Fausto-Sterling,
« l'existence des individus intersexués » aiderait
« à déconstruire cette frontière en révélant son arbitraire et
ses fondements sociaux et culturels ». De même, explique
Mathieu Trachman, « en mettant en avant les différences entre
hommes, l'approche des masculinités de Connell » soulignerait
« le caractère fictionnel d'une théorie qui partage
l'humanité entre deux groupes de sexe différent ».
En définitive, tel qu'il apparaît dépeint par ses promoteurs,
le "genre" se prête manifestement aux hypothèses les plus hardies. À
vrai dire, loin de dissiper notre méfiance à son égard, la lecture de
cet ouvrage l'a plutôt nourrie, quoi que l'humilité demeure de mise,
tant nous échappent les subtilités des débats universitaires.
« En dénaturalisant la différence des sexes »,
observe Éric Fassin, « ce concept est désormais un outil
scientifique, en même temps qu'une arme politique, au service de la
critique des normes ». Selon lui, « il s'agit bien de
savoir si cet ordre est fondé, une fois pour toutes, par un principe
transcendant – tel que Dieu, la Nature ou la Tradition – ou bien s'il
est défini de manière immanente – par "nous" qui habitons ce monde
aujourd'hui : les normes, les règles et les lois sont-elles
déterminées a priori ou négociées a posteriori ?
Tel est in fine l'enjeu : l'extension de la logique
démocratique au domaine sexuel. »
Avec quelles perspectives ? Les contributions réunies
ici font écho aux débats animant la communauté des chercheurs acquis au
"genre", mais elles ne nous ont pas semblé beaucoup ouvertes
au-delà. Or, quelles conséquences y aurait-il à verser dans le
"constructivisme sociétal" auquel nous invitent les "études de
genre" ? Telle est, plus ou moins confusément, la question qui
nous taraude, mais à laquelle ce petit livre n'apporte guère de réponse.
Sous la direction de Laure Bereni et Mathieu Trachman, Le
Genre – Théories et controverses, Presses universitaires de
France, collection "La Vie des idées", octobre 2014,
112 pages, 8,50 euros.
Ce petit livre réunit des contributions dont certaines sont
disponibles en
suivant ce lien vers La Vie des idées.
Publié dans Féminisme & Genre | Pas de commentaires
7 octobre 2014
Réaction amusée à la lecture d'un article du Courrier
international.

Un
million d'enfants seraient nés à la faveur des rencontres suscitées par
le programme Erasmus, en application duquel des universités
européennes échangent des étudiants depuis 1987. Quoique
ces chiffres soient sujets à caution, leur communication
apportait quelque fraîcheur à la morne machine administrative
européenne.
Cela nous a fait sourire, donc, mais tout le monde de l'a pas
entendu de cette oreille. Ainsi Yeni Safak a-t-il dénoncé « un
projet suscitant la dégénérescence et visant à créer une masse d'idiots
idolâtrant le sexe ». Erasmus, déplore-t-il, « c'est
un programme visant à fabriquer une génération de païens mondialisés
sans racines ».
M. Safak serait-il membre du Parti chrétien démocrate, de
Civitas ou d'une autre officine réactionnaire ? Oui et
non : c'est un journaliste turc, réputé proche de l'AKP, selon
le Courrier international.
Finalement, peut-être Alain Escada et Farida Belghoul ne se
sont-ils pas acoquinés sans raison ! 😉
Publié dans Obscurantisme, Société | Pas de commentaires