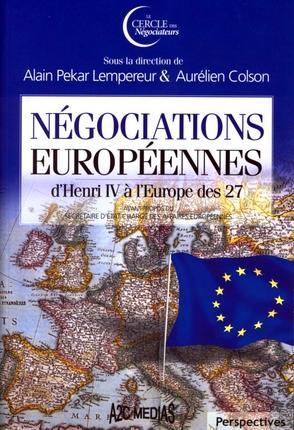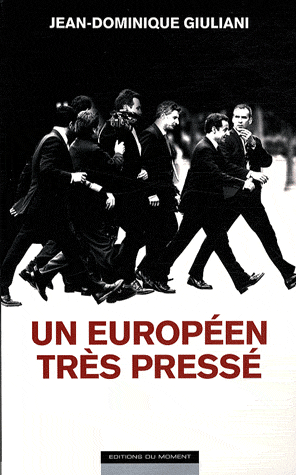4 septembre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
Aperçu d'un ouvrage traitant des négociations européennes d'Henri IV à l'Europe des Vingt-Sept.
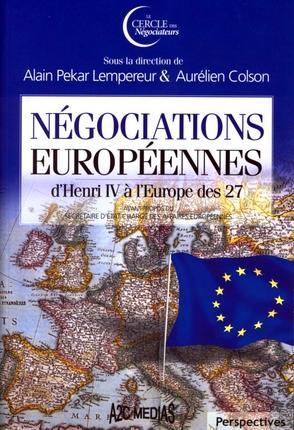
Comment les négociations internationales ont-elles été menées
en Europe depuis le XVIIe siècle ? La question a fait l'objet
d'un ouvrage collectif paru en avril dernier.
La première partie est historique. On y rencontre d'abord Jean
Hotman de Villiers, qui est, en 1603, le premier à disserter en
français sur La charge et la dignité de l'ambassadeur ; «
composé par un homme [...] dont la science et l'érudition sont
fortement imprégnées par l'esprit de la Renaissance et les références à
l'Antiquité, [ce traité] n'en est pas moins en prise directe avec son
temps », dont bien des aspects sont révolus : imaginerait-on qu'un
ambassadeur s'appauvrisse aujourd'hui au service de l'État ?
Vers 1640, le cardinal de Richelieu développe dans son
Testament politique « une conception éminemment nouvelle de la
négociation », qui devient permanente, « s'ordonnant [...] en vue de la
réalisation d'un dessein plus général, ce que l'on appellera la
politique étrangère... » En 1716, François de Callières s'intéresse à
l'éloquence dans La Manière de négocier avec les souverains ; son
existence témoigne d'« une capacité rare d'alterner vie active de
diplomate et vie contemplative du penseur ». Un article publié en 1770
dans l'encyclopédie d'Yverdon est reproduit intégralement ; Barthélémy
Fortuné de Félice y souligne le poids des passions et lance quelques
piques à l'encontre de Mazarin (dont les intrigues ne feraient pas
honneur à la diplomatie française selon lui).
En 1757, dans ses Principes des négociations, Gabriel Bonnot
de Mably conteste l'aptitude du système de l'équilibre à garantir la
paix ; il juge vicieux l'ordre européen assimilant la politique à "la
chose privée des rois", et se fait l'apôtre de la transparence. La
Révolution française s'y essaiera, transformant bientôt « la
"diplomatie de la transparence" en une "diplomatie de l'arène" » ; «
détruisant sans chercher à reconstruire, l'expérience tourne au chaos
», aboutissant selon Frank Attar à « la diplomatie du vide ».
Multilatéralisme
La seconde partie traite de l'« actualité de la négociation,
de la souveraineté française au consensus européen », esquissant
quelques comparaisons avec les siècles passés. Marie-Christine Kessler
identifie des vecteurs de stabilité : « En France [...], il y a eu très
vite une institutionnalisation et une professionnalisation du métier de
diplomate. » Mais l'influence des opinions, ainsi que l'émergence du
multilatéralisme, ont bouleversé la donne. Des contributions évoquent
la représentation permanente de la France aux Nations Unies – dont le
Conseil de Sécurité se réunit tous les jours – et l'engagement de la
Commission européenne dans des négociations internationales. Une
expérience de « multilatéralisme au carré », selon l'expression
d'Hubert Védrine, le mandat des négociateurs européens étant lui-même
issu d'une négociation entre les États membres de l'UE. Observant les
réticences des États-Unis à l'égard d'un multilétaralisme qu'ils
avaient jadis encouragé, l'ancien ministre des Affaires étrangères
conclut ainsi sa postface : « Selon qu'il s'agit [...] d'un mouvement
conjoncturel [...] ou durable, les conséquences n'en seront pas du tout
les mêmes pour l'art de la négociation. »
En définitive, l'ouvrage semble quelque peu "bricolé".
Rassemblant des contributions inégales, il constitue moins l'« histoire
vivante de la négociation » annoncée en quatrième de couverture qu'un
aperçu des œuvres des ses théoriciens classiques, complété par quelques
considérations d'actualité. On s'agace en outre de l'inclination de
certains auteurs à dénicher dans le passé les sources supposées de leur
européisme un peu naïf... C'est une étude originale dont on regrettera
qu'elle ne tienne pas toutes ses promesses.
Sous la direction d'Alain Pekar Lempereur et Aurélien Colson :
Négociations européennes - D'Henri IV à l'Europe des 27 ;
A2C Medias, avril 2008, 284 p., 25 euros.
Publié dans Europe, Histoire, Livres | Pas de commentaires
3 juillet 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelles sont les grandes lignes de la politique européenne de Nicolas Sarkozy ? Jean-Dominique Giuliani – président de la Fondation Robert Schuman – tente de les identifier dans un ouvrage publié en mai dernier, où il brosse le portrait d'« un Européen très pressé ».
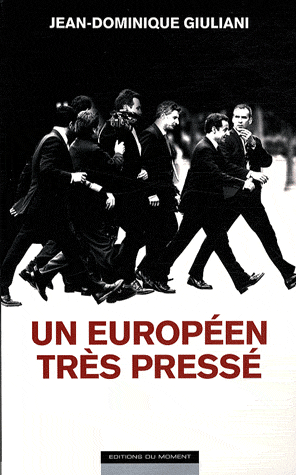
L'auteur souligne l'importance – relative, certes, mais
inédite – que le candidat Sarkozy avait accordée à la construction
européenne pendant sa campagne, annonçant la négociation du traité de
Lisbonne et sa ratification par voie parlementaire. Un choix «
courageux » selon Jean-Dominique Giuliani, mais qui nous paraît
finalement peu coûteux, étant donné l'indifférence de nos concitoyens.
Ont-ils été abusés par l'esbroufe présidentielle ? En tout cas, le
numéro d'équilibriste de Nicolas Sarkozy semble avoir touché son public
: nuancés par un zeste d'euroscepticisme, ses discours ont rassuré les
nonistes, ouvrant la voie au "retour de la France en Europe" proclamé
le soir de sa victoire électorale.
Symboles
Dès son entrée en fonction, le chef de l'État multiplie les
symboles, « comme autant de gestes en direction de l'Union européenne »
: pour sa photographie officielle, par exemple, il pose devant la
bannière bleue étoilée. Jean-Dominique Giuliani revient sur la façon
parfois houleuse dont se sont nouées les relations avec Angela Merkel.
En dépit d'une main tendue au Royaume-Uni, la collaboration privilégiée
avec l'Allemagne serait « inévitable » de toute façon... Une
observation tout juste étayée par quelques considérations économiques.
Le lecteur avide d'analyses géopolitiques pointues passera son chemin.
Retour à l'Est
L'auteur signale toute l'importance que le Président accorde à
la Méditerranée, mais insiste aussi sur ses efforts visant à resserrer
les liens avec les pays de de l'Europe de l'Est, vilipendés par Jacques
Chirac à la veille de leur entrée dans l'Union. Le rapatriement des
infirmières bulgares retenues en Libye, orchestré triomphalement par
Nicolas Sarkozy, aurait largement contribué au succès de son
entreprise. Le « passage obligé » par Washington rassure également les
États fraîchement libérés du joug soviétique. L'objectif est clair : le
président de la République espère développer un pôle de sécurité
européen, et, plus généralement, conférer à l'UE le rôle d'un véritable
acteur politique.
En matière économique et monétaire, son ambition de
"repolitiser" l'Europe apparaît manifeste. Ainsi a-t-il réclamé un
assouplissement de la politique de concurrence – nécessaire à la
préservation de nos intérêts industriels –, ou une réaction face à la
menace des fonds souverains. Ses homologues sont disposés à le suivre
sur ce point. En revanche, ils ne sauraient cautionner ses critiques
formulées à l'encontre de la Banque centrale européenne, qui se sont
certes assagies depuis son élection. Une fois n'est pas coutume,
Jean-Dominique Giuliani exprime ici quelque réserve, rappelant cette
évidence, vraisemblablement négligée par un politicien en campagne : «
La revendication d'un "gouvernement économique" n'a [...] de chance
d'aboutir que le jour où certains pays accepteront de se concerter
avant de prendre leurs grandes décisions économiques internes. » En
attendant, aucune alternative à l'indépendance de la BCE n'est
envisageable, à moins d'abandonner la monnaie unique évidemment.
Identité chrétienne
Telle que nous la dépeint Giuliani, l'Europe rêvée par Nicolas
Sarkozy bénéficierait d'une forte identité, inspirant la fierté de
citoyens conscients d'appartenir à une communauté de civilisation. « Il
replace le projet européen dans une perspective historique, morale et
politique, dont l'ont éloigné le temps, la bureaucratie et les
habitudes. Pour lui, l'Europe doit désormais avoir pour objectif d'être
une puissance nouvelle sur la scène internationale. À ce titre, elle a
droit à un territoire.. » Le chef de l'État veut en finir avec la fuite
en avant de l'élargissement, qui s'oppose au projet
d'approfondissement. De son point de vue, l'adhésion de la Turquie
serait une perspective d'autant moins acceptable qu'elle saperait les
fondements de l'unité européenne, brouillant les repères tant
géographiques que culturels. À l'inverse, la reconnaissance officielle
des racines chrétiennes de l'Europe lui semblerait indispensable ; leur
négation constituerait à ses yeux « une insulte à l'histoire » et même
une « faute politique ».
Un vieux fantasme
Un faute, sans doute, mais qui apparaîtrait bien minime
comparée à celle qu'il commettrait si, d'aventure, il privait la France
de son siège de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Fort heureusement, Jean-Dominique Giuliani ne lui prête pas
cette intention. Bien au contraire, il s'interroge sur son inclination
à « abandonner sa capacité à décider seul au profit d'institutions
européennes » supposées plus efficaces ; « s'il y a des contradictions
dans les discours européens de Nicolas Sarkozy, c'est ici qu'il faut
les chercher », précise-t-il. Cédant à un vieux fantasme européiste, il
l'appelle pourtant à « partager » son siège avec l'UE, au moins
provisoirement, pendant que la France assure la présidence de l'Union.
On s'agace pareillement de son aversion naïve pour la Realpolitik,
et de sa posture "bien pensante" qui le conduit à ériger en vérités
universelles des opinions ou des valeurs – telle la "parité" – qui sont
loin d'emporter notre adhésion. On lui reprochera enfin de se complaire
dans une relative apologie, son ouvrage s'approchant d'avantage de la
paraphrase que de l'analyse approfondie.
Jean-Dominique Giuliani : Un Européen très pressé.
Éditions du Moment, 22 mai 2008, 277 p., 19,95 euros.
Publié dans Europe, France, Livres | Pas de commentaires
3 juillet 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
La présidence française de l'Union européenne est lancée !

L'Europe est-elle en crise, voire en panne ? Sans doute dans
l'esprit des européistes. Pour eux, l'échec de la ratification du
traité de Lisbonne par l'Irlande est un nouveau camouflet. Depuis la
signature du traité de Nice en 2001 – toujours en vigueur – l'Union
s'est élargie à douze nouveaux États, rendant d'autant plus délicate la
négociation d'une révision, et a fortiori sa ratification, soumise
parfois aux aléas des référendums... La réforme institutionnelle se
trouve manifestement dans l'impasse.
La tâche de la France en est-elle bouleversée, alors qu'elle
assure pour six mois, depuis le 1er juillet, la présidence du Conseil
de l'Union ? Le chef de l'État tentera vraisemblablement de sauver son
traité. Mais s'ils le souhaitent, les gouvernements « peuvent avancer
exactement comme avant », remarque Hubert Védrine. Selon l'ancien
ministre des Affaires étrangères, « nous attendons "trop des traités" »
; l'essentiel « dépend de la volonté des gouvernements". [...] Nous
pouvons donc "faire énormément de choses même avec des traités
imparfaits" » (Toute l'Europe, 16/06/08).
Nicolas Sarkozy, dont l'ambition serait « de redonner à
l'Union une direction politique » selon Jean-Dominique Giuliani,
devrait en avoir conscience. Les européistes les plus virulents
gagneraient à s'y résoudre : sans admettre la nécessité de "construire
l'Europe par la preuve", comment pourraient-ils reconquérir les
opinions publiques ?
La France entend donner la priorité à quatre dossiers :
l'ouverture des discussions sur la Politique agricole commune, la
conclusion d'un accord sur l'immigration, le renforcement de la
politique européenne de défense, l'aboutissement des négociations sur
le paquet énergie-climat. Sa mission sera d'organiser les débats. Si
les Conseils des ministres sont financés par l'UE, ce n'est pas le cas
des conseils informels, par exemple... 190 millions d'euros sont
affectés à l'événement (trois fois plus qu'en 2000). Tous les
ministères sont mobilisés, ainsi, bien sûr, que le Secrétariat général
des Affaires européennes et la Représentation permanente de la France à
Bruxelles. Le personnel, redéployé, est d'ores et déjà confronté à une
surcharge de travail...
Que rapporte une présidence du Conseil de
l'Union ? « Rien sur le plan financier, mais beaucoup en
termes d'image, de promotion des idées françaises et de mise en valeur
du savoir-faire français », explique un fonctionnaire cité par Euractiv
(19/06/08). « "C'est de l'ordre de l'immatériel", conclut-t-il. » La
République saura-t-elle en tirer profit ?
Publié dans Europe, France | Pas de commentaires
20 décembre 2007
Article publié dans L'Action Française 2000
La partie n'est pas encore gagnée pour les promoteurs du traité de Lisbonne.

L'absence du Premier ministre britannique n'aura pas empêché
la signature du traité de Lisbonne le 13 décembre dernier, dans le
cloître du monastère des Jeronimos datant du XVIe siècle, où le
Portugal avait déjà signé son traité d'adhésion à l'Union européenne en
1985. Programmée pour le 1er janvier 2009, l'entrée en vigueur de ce
texte n'est pas acquise : une nouvelle période d'incertitude vient de
s'ouvrir, celle de la ratification par les vingt-sept États membres de
l'UE.
Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et
européennes, l'avait rappelé le 11 décembre devant les députés : « La
France souhaite montrer l'exemple [...] : dès le lendemain de la
signature, le Conseil constitutionnel sera saisi. » Finalement, cela
aura été fait le jour même. Un projet de loi constitutionnelle devrait
être présenté en Conseil des ministres début janvier, puis examiné par
l'Assemblée nationale et le Sénat, respectivement, les 14 et 28 janvier
2008, avant une adoption par le Congrès le 4 février, à la majorité des
trois cinquièmes. Ce préalable est rendu nécessaire par la référence
explicite de la Constitution française au défunt traité constitutionnel
européen : paradoxalement, bien qu'il consacre la primauté "effective"
du droit communautaire, le traité de Lisbonne reste soumis à
notre loi fondamentale, qui ne saurait s'en accommoder sans une
énième révision... L'Assemblée et le Sénat devraient entériner
la ratification par une loi votée entre les 5 et 8 février.
Sarkozy tient ses promesses
Ce processus arrivera vraisemblablement à son terme sans
encombre. Confronté à la fronde des "nonistes", qui sont prompts à
dénoncer un « coup d'État », le gouvernement pourra s'abriter derrière
les promesses de campagne du président de la République. Le 21 février
2007 à Strasbourg, Nicolas Sarkozy avait clairement proclamé ses
intentions : « Débloquer l'Europe
institutionnellement, ce sera le sens de ma première initiative
européenne si je suis élu. Dans ce but je proposerai à nos partenaires
de nous mettre d'accord sur un traité simplifié qui reprendra les
dispositions du projet de traité constitutionnel. [...] Je proposerai
notamment de mettre fin à la règle de l'unanimité. [...] Ce traité
simplifié, de nature institutionnelle, sera soumis pour ratification au
Parlement. » Dans ces conditions, comment prétendre que la démocratie a
été bafouée ? Les électeurs ont librement renouvelé leur soutien à ceux
dont ils avaient apparemment désavoué la politique par référendum deux
ans plus tôt... Point de putsch derrière tout ça ! Ce phénomène
illustre simplement le conservatisme du suffrage universel et témoigne
des aberrations inhérentes à la démocratie. Les souverainistes
républicains finiront par en tirer les conséquences... De toute façon,
il est vain de courir après une souveraineté privée de souverain !
À la limite, on reprochera à Nicolas Sarkozy d'avoir parlé
abusivement d'un traité « simplifié ». Alors que la Constitution
européenne se proposait de réintégrer les traités existants dans un
nouveau texte, le traité de Lisbonne amende les traités en vigueur
(Rome, Euratom, Maastricht) pour y apporter – à quelques détails près,
exception faite des symboles – les mêmes innovations. Il en résulte un
document beaucoup moins lisible, mais c'était l'objectif poursuivi si
l'on en croit Valéry Giscard d'Estaing. « Quel est l'intérêt de cette
subtile manœuvre ? D'abord et avant tout d'échapper à la contrainte du
recours au référendum, grâce à la dispersion des articles, et au
renoncement au vocabulaire constitutionnel. » (Le Monde, 26/10/2007)
Le traité de Lisbonne supprime les "Communautés européennes"
appelées à se fondre dans l'Union, et met à jour quelques termes
dépassés, en remplaçant par exemple la mention de l'écu par celle de
l'euro. La lecture de la version consolidée des traités ainsi modifiés
s'en trouvera un peu moins confuse... Tout au plus s'agit-il d'un
traité légèrement "simplificateur".
Qui sera le mouton noir ?
À l'étranger, la ratification s'annonce parfois plus délicate.
En République tchèque, par exemple, le Premier ministre Mirek Topolanek
a prévenu que cela ne serait « pas si simple » ; l'ODS, sa formation
politique, a déjà signalé qu'elle ferait examiner la conformité du
nouveau traité avec la loi fondamentale tchèque par le Conseil
constitutionnel. Selon Radio Prague (www.radio.cz, 14/10/2007), « pour certains analystes, ce serait également une manière de ne pas
ratifier "trop tôt", pour ne pas compromettre la présidence tchèque de
l'UE au premier semestre 2009 » ; en effet, l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne mettrait fin à la présidence tournante du
Conseil européen réunissant les chefs d'État et de gouvernement.
Gordon Brown, quant à lui, devra compter avec
l'euroscepticisme partagé par l'opinion britannique et nombre de ses
parlementaires : les dérogations obtenues par Londres – sur la
Charte des droits fondamentaux ou le renforcement de la coopération
judiciaire et policière – n'ont pas suffi à les rassurer. Le Sun, qui
milite en faveur d'un référendum, met en garde le Premier
ministre, qui doit s'attendre « à une âpre révolte à la
Chambre des Communes lorsqu'il tentera de faire passer en force le
traité au Parlement » (cité par letemps.ch, 14/12/2007).
En Irlande, la tenue d'un référendum sera inévitable. Au
préalable, suivant la terminologie consacrée, un actif travail de
"pédagogie" devra être entrepris : un sondage réalisé par l'institut
TNS pour le quotidien Irish Times avait révélé le 5 novembre 2007 que
seuls 25 % des Irlandais pensaient voter "oui", tandis que 12 %
seraient certains de voter "non", les indécis représentant 62 % des
sondés. En 2001, l'Irlande avait déjà perturbé le processus de
ratification du traité de Nice, rejeté lors d'un premier référendum.
Qu'adviendra-t-il, enfin, si la crise se poursuit en Belgique,
ou si le pays éclate ? « L'arrivée d'un cabinet provisoire mené par Guy
Verhofstadt, l'ancien Premier ministre, ne fait que déplacer la
question selon Sylvain Lapoix (marianne2.fr, 06/12/2007) : en
droit constitutionnel, un gouvernement provisoire ne peut en effet
traiter que des questions relevant des "affaires courantes". D'où le
débat qui, depuis le retour en fonction de Verhofstadt, agite les pages
du quotidien Le Soir : l'adoption d'un traité européen
est-elle une affaire courante ? Entre juristes, la bataille fait
d'autant plus rage qu'un précédent existe : le 2 février 1992, le
traité de Maastricht fut signé alors que le gouvernement issu des
élections du 24 novembre 1991 n'avait pas été formé. La situation est
ici sensiblement différente dans la mesure où ce n'est pas le délai de
formation du nouveau gouvernement qui retarde la mise en place d'un
cabinet mais une crise politique majeure qui empêche tout accord... »
La partie n'est pas encore gagnée pour les promoteurs du traité de
Lisbonne !
D'ailleurs, comment est-elle censée se dérouler ? Le 14
décembre, lendemain de la signature du traité, le Conseil européen
s'est à nouveau réuni. Il a salué l'entrée, le 21 décembre, de neuf
États membres dans l'espace Schengen (Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie). À
la demande de la France, il a décidé la création d'un "groupe de
réflexion" présidé par l'ancien Premier ministre espagnol Felipe
Gonzalez, chargé d'examiner l'avenir de l'Union à l'horizon 2020-2030.
Ce "comité de sages" ne traitera pas des questions institutionnelles ou
budgétaires ; et contrairement au souhait du président de la
République, son mandat ne mentionnera pas explicitement la question des
frontières. Il devrait commencer ses travaux au second semestre 2008,
et rendre ses conclusions en 2010.
Gouvernement des juges
D'ici là, au cours du second semestre 2008, la présidence
française de l'UE aura pour tâche, entres autres, de mener les
discussions sur la définition du rôle du futur président du Conseil
européen, ou sur la mise en œuvre de l'action du représentant pour la
politique étrangère. Dans son rapport d'information, le
sénateur Hubert Haenel souligne que l'incertitude
demeure quant aux modalités d'application du nouveau traité :
« On ne peut pas, par exemple, savoir a priori comment se fera
le partage des responsabilités entre le président du Conseil européen,
le Haut Représentant et le président de la Commission. On ne peut pas
savoir non plus jusqu'où ira le Parlement européen dans l'usage de ses
nouveaux pouvoirs. Le nouvel équilibre institutionnel se dégagera
avec le temps. »
La révision des objectifs assignés à l'Union suscite également
des interrogations, comme l'explique Nicolas Gros dans le numéro
spécial d'Europolitique : « Ce renversement de valeurs
pourrait ne pas être cosmétique. Placer les valeurs sociales,
d'environnement et de développement durable au même niveau que les
valeurs d'économie libérale, voire légèrement au-dessus est un geste
politique fort. [...] Les conséquences pourraient être juridiques,
estiment plusieurs analystes. Elles pourraient donner aux magistrats de
la Cour, l'occasion de d'opérer une hiérarchisation entre les valeurs
sociales et les principes de la libre circulation. » Autrement dit, la
balle est dans le camp des juges. Un comble pour un traité qui se veut
davantage politique !
À défaut de se plonger dans la lecture du traité de Lisbonne,
particulièrement ardue pour un profane, les plus curieux pourront se
référer au numéro spécial d'Europolitique (www.europolitique.info)
ainsi qu'au rapport d'information du Sénat (n° 76, déposé le
8 novembre 2007, www.senat.fr). En dépit d'une relative
complaisance à l'égard du texte présenté, ces synthèses en donnent un
aperçu plutôt objectif.
Publié dans Europe | Pas de commentaires