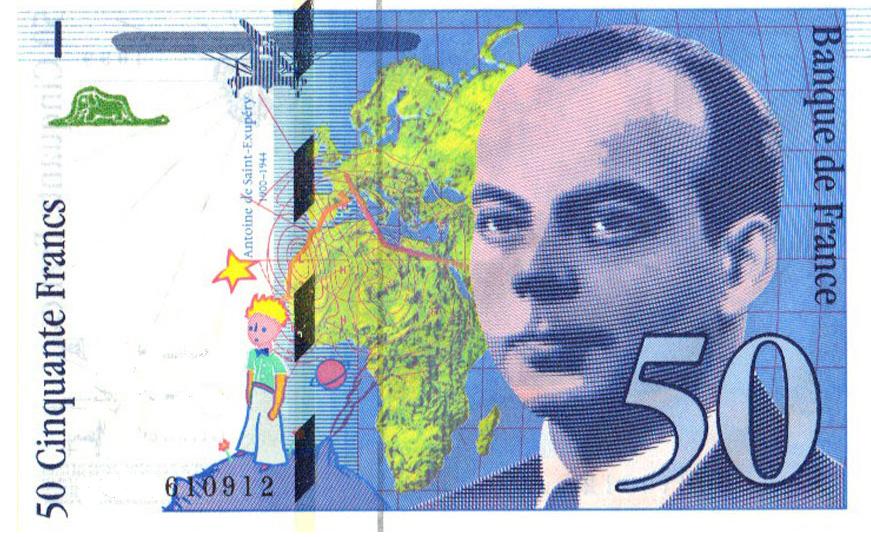26 avril 2018
Le Gouvernement s'érige en promoteur de l'économie circulaire, sans verser toutefois dans le complotisme cher aux détracteurs d'une prétendue obsolescence programmée ; la belle est dans le camp des consommateurs, explique-t-il en substance.

Lundi dernier, 23 avril 2018, le Premier ministre a présenté une feuille de route pour l'économie circulaire. « il nous faut un jouet neuf tous les jours et nous sommes constamment tenus en haleine par les inventeurs qui nous créent des besoins ridicules
», a-t-il dénoncé en introduction de son discours, citant Paul Morand. « On se sépare d'un appareil défectueux sans très bien d'ailleurs savoir ce qu'il va devenir et qui semble finalement parfois en bon état
», a-t-il ensuite regretté. « Cette logique-là, qui n'est pas fait de malveillance, il faut la casser
», a-t-il martelé.
Une planète en voie d'obsolescence ?
Le chef du Gouvernement serait-il, lui aussi, le détracteur d'une obsolescence programmée fantasmée ? Pas vraiment. « Il y a une obsolescence dont nous sommes convaincu, certain, qu'elle est programmée, c'est celle de la planète
», a-t-il expliqué ; « c'est celle d'un modèle dans lequel on extrait, on fabrique, on vend, on case, on jette – avec d'un côté des mines toujours plus profondes et de l'autre côté des montagnes de déchets qui sont toujours plus hautes
». Ce faisant, Édouard Philippe s'est bien gardé de cautionner l'idée selon laquelle les fabricants comploteraient pour saboter délibérément leurs produits.
Consommer, c'est choisir !
« Il est grand temps
[...] de fermer les circuits de production et de consommation
», a-t-il annoncé. « La première manière de moins jeter
», a-t-il rappelé, « c'est d'acheter robuste
» ; « et souvent
», s'est-il félicité, « acheter robuste, c'est acheter français, voire européen – mais de préférence français
». « Une autre façon de moins jeter
», a-t-il poursuivi, « c'est de consommer un peu moins, de manière plus consciente, plus précautionneuse, parce que l'obsolescence programmée, elle est aussi psychologique
». La balle est dans le camp du pays réel, a-t-il expliqué en substance : « Vous connaissez la formule "gouverner, c'est choisir". Eh bien, consommer, c'est choisir aussi. Et d'une certaine façon, consommer, c'est gouverner un peu aussi. Ce choix du consommateur, il faut le documenter, il faut le faciliter, l'orienter, il faut l'amplifier. Parce qu'il a besoin de l'être. C'est là que nous pouvons intervenir, c'est là que la volonté politique peut commencer à produire des effets.
» L'autorité en haut, les libertés en bas ?
Publié dans Économie et Industrie, Politique | Pas de commentaires
10 avril 2018
Commentaire critique d'un reportage diffusé sur France 2. Un article d'abord publié sur Contrepoints le 7 avril 2018.

Poursuivi en justice pour « obsolescence programmée
», Epson a d'ores et déjà été condamné par un tribunal médiatique. Dans un numéro d'Envoyé spécial diffusé sur France 2 le 29 mars 2018, les journalistes Anne-Charlotte Hinet et Swanny Thiébaut ont repris avec une étonnante crédulité les accusations assénées par l'association HOP (Halte à l'obsolescence programmée), à l'origine d'une plainte déposée l'année dernière contre l'industriel japonais.
Certains constats rapportés dans cette enquête s'avèrent effectivement troublants : on y découvre qu'une imprimante prétendument inutilisable peut tout à fait sortir plusieurs pages après l'installation d'un pilote pirate ; quant aux cartouches, elles semblent loin d'être vides quand l'utilisateur est appelé à les changer. La preuve n'est-elle pas ainsi faite qu'un complot est ourdi contre des consommateurs aussi malheureux qu'impuissants ?
La musique accompagnant ce reportage, angoissante, laisse entendre qu'un danger planerait sur ceux qui se risqueraient à le dénoncer. On tremble à l'évocation de cet homme qui « a fini par briser le silence
» ; quel aura été le prix de sa témérité ? Un passionné d'électronique susceptible d'assister les enquêteurs vit en marge de la société, reclus loin des villes et de leurs menaces : « il a fallu avaler quelques kilomètres en rase campagne pour trouver un expert
», racontent les journalistes. Un expert censé décrypter le contenu d'une puce électronique à l'aide d'un tournevis… Succès garanti.
La concurrence met les fabricants sous pression
Les imprimantes incriminées sont vendues autour d'une cinquantaine d'euros. « Le fabricant n'a pas intérêt à avoir des imprimantes de ce prix-là qui soient réparables, sinon il n'en vendra plus
», croit savoir l'un des témoins interrogés. Étrange conviction : si un fabricant était en mesure de prolonger la durée de vie de ses produits et d'étendre leur garantie en conséquence, sans en renchérir le coût ni en compromettre les fonctionnalités, n'aurait-il pas intérêt à le faire, dans l'espoir de gagner des parts de marché aux dépens de ses concurrents ?
De toute façon, pour Epson, l'activité la plus lucrative n'est pas là : « autant vendre une imprimante pas chère pour vendre ensuite de l'encre très chère
», souligne une autre personne interrogée, cette fois-ci bien inspirée. Il est vrai qu'au fil du temps, les fabricants de cartouches génériques parviennent à contourner les verrous mis en place par Epson et ses homologues pour s'arroger d'éphémères monopoles sur le marché des consommables. Cela étant, même s'il préfère acheter de l'encre à moindre coût, le possesseur d'une imprimante Epson fonctionnelle sera toujours un acheteur potentiel des cartouches de la marque ; ce qu'il ne sera plus, assurément, quand son imprimante sera tombée en panne… Ce constat, frappé du sceau du bon sens, semble avoir échappé aux enquêteurs, qui prétendent pourtant que « les fabricants font tout pour vous faire acheter leurs propres cartouches
». Peut-être cela pourrait-il expliquer l'obligation de changer une cartouche pour utiliser le scanner d'une imprimante multi-fonctions… Mais quelle garantie Epson aurait-il que ses clients lui restent fidèles au moment de renouveler leur matériel dont il aurait lui-même programmé l'obsolescence ? Ils le seront d'autant moins s'ils ont été déçus par leur achat – notamment s'ils jugent que leur imprimante les a lâchés prématurément.
La pertinence d'un stratégie d'obsolescence programmée est donc sujette à caution. Comment, dès lors, expliquer certaines aberrations ? Epson se montre peu prolixe à ce sujet ; sa communication s'avère même calamiteuse ! « Une imprimante est un produit sophistiqué
», affirme-t-il dans un communiqué. Pas tellement en fait. Du moins l'électronique embarquée dans un tel appareil n'est-elle pas des plus élaborée. Assistant au dépeçage d'une cartouche, les journalistes ont mimé l'étonnement à la découverte de sa puce : « Surprise !
[…] Pas de circuit électrique, rien qui la relie au réservoir d'encre. Elle est juste collée. Comment diable cette puce peut-elle indiquer le niveau d'encre si elle n'est pas en contact avec l'encre ?
» Que croyaient-ils trouver dans un consommable au recyclage notoirement aléatoire ? Ou dans un appareil vendu seulement quelques dizaines d'euros ? Quoi qu'en dise Epson, sans doute la consommation de l'encre et l'état du tampon absorbeur sont-ils évalués de façon approximative. Apparemment, le constructeur voit large, très large même ! C'est évidemment regrettable, mais qu'en est-il des alternatives ? Les concurrents d'Epson proposent-ils des solutions techniques plus efficaces sur des produits vendus à prix comparable ? Encore une question qui n'a pas été posée…
Des produits réputés à tort irréparables
Concernant les cartouches, dont l'encre est en partie gaspillée, la malignité prêtée au constructeur reste à démontrer. On n'achète pas une cartouche d'encre comme choisit une brique de lait ni comme on fait un plein d'essence. Si le volume d'encre qu'elle contient est bien mentionné sur l'emballage, cette information n'est pas particulièrement mise en valeur. D'une marque à l'autre, d'ailleurs, elle n'est pas la même ; elle ne constitue pas un repère ni un élément de comparaison. En pratique, on n'achète pas des millilitres d'encre, mais des cartouches de capacité dite standard, ou bien de haute capacité, avec la promesse qu'elles nous permettront d'imprimer un certain nombre de pages. Dans ces conditions, quel intérêt y aurait-il, pour un constructeur, à restreindre la proportion d'encre effectivement utilisée ? Autant réduire le volume présent dans les cartouches ! Pour le consommateur, cela reviendrait au même : il serait condamné à en acheter davantage ; pour l'industriel, en revanche, ce serait évidemment plus intéressant, puisqu'il aurait moins d'encre à produire pour alimenter un nombre identique de cartouches vendues au même prix. Un représentant d'Epson, filmé à son insu, a tenté de l'expliquer au cours du reportage, avec toutefois une extrême maladresse. Les enquêteurs n'ont pas manqué de s'en délecter, prenant un malin plaisir à mettre en scène la dénonciation d'un mensonge éhonté.
Force est de constater qu'ils n'ont pas fait preuve du même zèle pour vérifier les allégations des militants qui les ont inspirés. Quand il juge nécessaire de changer le tampon absorbeur d'une imprimante, Epson en interdit l'usage au motif que l'encre risquerait de se répandre n'importe où. Parmi les utilisateurs d'un pilote pirate permettant de contourner ce blocage, « on a eu aucun cas de personnes qui nous écrivaient pour dire que cela avait débordé
», rétorque la représentante de l'association HOP. Pourquoi les journalistes n'ont-ils pas tenté l'expérience de vider quelques cartouches supplémentaires dans ces conditions ? À défaut, peut-être auraient-ils pu arpenter la Toile à la recherche d'un éventuel témoignage. « Il y a quelques années j'ai dépanné une imprimante qui faisait de grosses traces à chaque impression, dont le propriétaire avait, un an auparavant, réinitialisé le compteur
[…] pour permettre de reprendre les impressions », raconte un internaute, TeoB, dans un commentaire publié le 19 janvier sur le site LinuxFr.org ; « le tampon était noyé d'encre qui avait débordé et qui tapissait tout le fond de l'imprimante
», précise-t-il ; « ça m'a pris quelques heures pour tout remettre en état, plus une nuit de séchage
», se souvient-il. Dans le cas présent, ce qui passe pour de l'obsolescence programmée pourrait relever en fait de la maintenance préventive… Les journalistes l'ont eux-mêmes rapporté au cours de leur reportage : Epson assure remplacer gratuitement ce fameux tampon ; pourquoi ne l'ont-ils pas sollicité pour évaluer le service proposé ?
Ils ont préféré cautionner l'idée selon laquelle une imprimante affectée par un consommable réputé en fin de vie – à tort ou à raison – devrait être promise à la casse. La confusion à ce sujet est entretenue au cours du reportage par un technicien présenté comme un « spécialiste de l'encre et de la panne
». Les militants de l'association HOP témoignent en cela d'une inconséquence patente : ils pourraient déplorer le discours sibyllin des constructeurs d'imprimantes, dont les manuels d'utilisation ou les messages à l'écran ne semblent pas faire mention des opérations de maintenance gracieuses promises par ailleurs ; mais ils préfèrent entretenir le mythe d'un sabotage délibéré de leurs produits, confortant paradoxalement leurs utilisateurs dans la conviction qu'ils seraient irréparables… Si la balle se trouve parfois dans le camp des industriels, ceux-ci ne manquent pas de la renvoyer aux consommateurs ; encore faut-il que ces derniers s'en saisissent, plutôt que de fuir leurs responsabilités éludées par une théorie complotiste.
Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaires
24 juillet 2017
Article publié dans L'Action Française 2000
Qwant, c'est le petit moteur de recherche qui monte, qui monte. Un concurrent français de Google qui s'honore de respecter la vie privée de ses utilisateurs. Succès garanti ?

Il n'y a pas d'alternative à Google, a-t-on entendu dernièrement à l'antenne de France Info (12 juillet 2017). C'est pourtant loin d'être le cas. Certains de ses concurrents sont même développés en France. C'est le cas d'Exalead, qui a bénéficié du soutien des pouvoirs publics sous la présidence de Jacques Chirac : « face à la croissance exponentielle de l'industrie des moteurs de recherche, il fallait que la France, avec ses partenaires allemands et demain, je l'espère, européens, soit à la hauteur de cet enjeu majeur
», avait déclaré le chef de l'État au printemps 2006. Devenu la propriété de Dassault Systèmes, Exalead a poursuivi son chemin en direction des entreprises.
Plus récemment, au printemps 2015, alors qu'il était ministre de l'Économie, Emmanuel Macron avait salué sur Twitter « un Google français en marche
» : Qwant, dont l'ambition est effectivement d'« offrir la première alternative européenne crédible face aux grandes plate-formes américaines qui dominent les services sur Internet
». Lancé en 2013 par une société créée deux ans plus tôt, il serait devenu, en 2016, le quatre-vingt-seizième site le plus visité en France. Ses équipes sont installées à Paris, Nice et Rouen. « De soixante environ en ce début 2017, le nombre d'employés devrait passer à cent cinquante en fin d'année et à deux cent cinquante en 2018
», précise L'Usine digitale.
On a testé pour vous
Qu'en es-il à l'usage ? La pertinence des résultats s'avère parfois prise en défaut. Aucun service de cartographie n'est encore intégré : c'est une lacune criante qui devrait être prochainement comblée. Mais on s'y retrouve très bien le plus souvent. Soucieux de « décloisonner les sources d'information et refléter toute la richesse du Web
», Qwant propose une interface qui tranche avec le minimalisme de Google : les liens les plus classiques, les actualités mais aussi les résultats tirés des réseaux sociaux y sont présentés sur un pied d'égalité. C'est déroutant. Mais pas inintéressant.
« Né de la vision d'entrepreneurs privés
», comme se plaisent à le rappeler ses fondateurs, Qwant a ouvert son capital au groupe allemand Axel Springer ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il bénéficie également du soutien de la Banque européenne d'investissement (BEI), laquelle y voit la preuve de « l'excellente coopération entre institutions publiques et privées, tant au niveau national qu'européen
». L'Éducation nationale promeut elle-même la déclinaison du moteur de recherche destinée aux plus jeunes – une version sécurisée, en quelque sorte, voire bridée… De quoi frustrer les internautes en herbe ? En tout cas, les dizaines de milliers d'ordinateurs mis à la disposition des fonctionnaires ne semblent pas concernés par cette publicité. [En fait, si, certains le sont bel et bien, selon un témoignage recueilli après la rédaction de cet article, mais dans quelles proportions ?]
Servitude volontaire
Le succès grandissant de Qwant se nourrit vraisemblablement de la défiance qu'inspirent les GAFA – à commencer par Google évidemment. Pour affronter ce dernier, Qwant a pactisé avec Microsoft, dont les résultats du moteur de recherche (Bing) pallient parfois ses propres insuffisances en toute transparence. Cela étant, « contrairement aux autres moteurs de recherche
», Qwant s'honore de fonctionner « sans collecter de données personnelles de ses utilisateurs
». Concrètement, « il n'y a aucun dispositif de traçage ou cookie permettant d'afficher des publicités selon votre profil
». Par conséquent, « la sélection et l'affichage des publicités s'appuient exclusivement sur les mots clefs de la recherche de l'utilisateur
». Aux dires de ses promoteurs, ce modèle économique serait « efficace sans être intrusif
». D'autres le jugeraient dépassé. Les internautes trancheront ! Parallèlement, la neutralité des résultats leur est garantie : « Qwant ne modifie pas les réponses selon l'internaute. Tous les utilisateurs d'une même région ont les mêmes réponses, ce qui évite d'enfermer les individus dans des bulles de filtres qui les confortent de plus en plus dans leurs opinions
[…] ou qui leur proposent uniquement les produits adaptés à leur pouvoir d'achat supposé.
»
Tant mieux ? C'est bien notre avis. Mais force est de constater que les utilisateurs de Facebook s'en remettent volontiers aux algorithmes développés sous la houlette de Mark Zuckerberg pour ordonner leur fil d'actualité, bien qu'ils n'y soient pas toujours contraints. Par ailleurs, en 2009, les usagers du métro parisien détenteurs d'une carte Navigo standard étaient presque neuf fois plus nombreux que ceux ayant préféré la carte "découverte", censée préserver leur anonymat. Qu'en est-il aujourd'hui ? Aucune réponse ne nous a été apportée par la RATP. Mais il n'est pas certain que ces proportions aient beaucoup évolué. « Les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent
», est-il souvent rappelé dans les colonnes de L'Action Française 2000. Encore faut-il avoir la volonté de les saisir, fussent-elles à portée de clic.
Publié dans Économie et Industrie, Internet, Médias | Pas de commentaires
26 mars 2017
Contrairement à ce que prétend le vice-président du FN, ce ne sont pas 95 % des pays du monde qui disposent de leur propre monnaie, mais moins de 75 % d'entre eux.

Florian Philippot, vice-président du Front national, l'a martelé samedi dernier, 25 mars 2017, sur le plateau de BFM TV : selon lui, « à peu près 95 % des pays du monde ont leur monnaie nationale
». Or, dans son acception la plus stricte, la zone euro compte à elle seule dix-neuf États (Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie) – lesquels représentent déjà près de 10 % des États reconnus par l'Organisation des Nations unies ! Cela sans compter les quelques autres pays qui utilisent également la monnaie européenne (Andorre, Kosovo, Monaco, Monténégro, Saint-Marin, Vatican).
Au delà du Vieux-Continent, il y a le franc CFA de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), partagé par huit États (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), et celui de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), qui est la monnaie de six États (Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, Tchad). Il existe aussi le dollar des Caraïbes orientales (Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie Sainte-Lucie, voire Anguilla et Montserrat). Le dollar américain circule lui-même au-delà des frontières où il est émis (Équateur, Marshall, Micronésie, Palaos, Salvador, Timor oriental, Zimbabwe), tout comme son homologue australien (Kiribati, Nauru, Tuvalu), voire le franc suisse (Liechtenstein).
Tout cela mériterait d'être approfondi et détaillé. Une chose est sûre cependant : ce ne sont pas 95 % des pays du monde qui disposent de leur propre monnaie ; selon une première estimation, ce seraient moins de 75 % d'entre eux.
Publié dans Économie et Industrie, Monde, Politique | Pas de commentaires
21 mars 2017
Dans les années quatre-vingt-dix, à la différence d'autres opposants au traité de Maastricht, le directeur de L'Action Française Hebdo accueillait avec bienveillance la politique du "franc fort", tout en en dénonçant certaines limites.
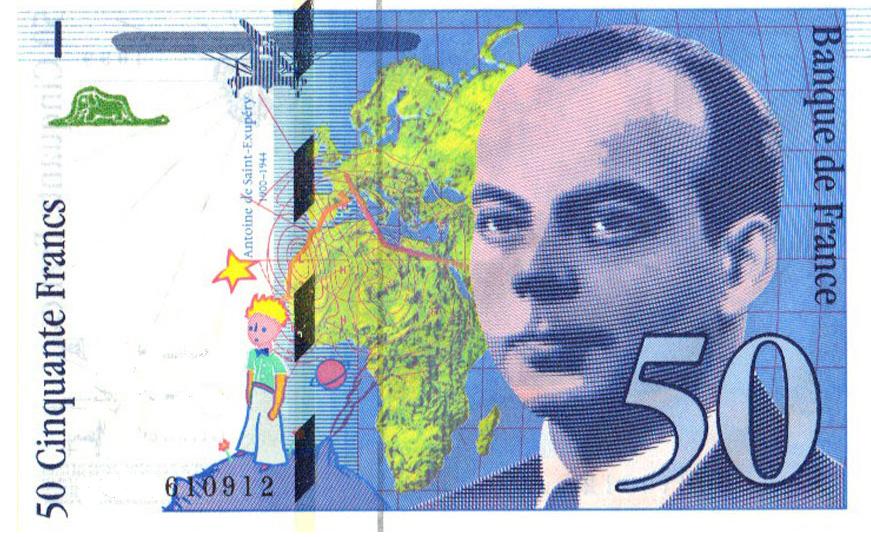
Été 1993 : les statuts de la Banque de France sont révisés afin de garantir son indépendance. On en parle peu dans les colonnes de L'Action Française Hebdo, où l'on dénonce plutôt l'entrée en vigueur imminente du traité de Maastricht. Dans le numéro du 15 juillet, Pierre Pujo évoque néanmoins la « politique du "franc fort"
» – laquelle « n'est pas la panacée
» selon le titre de son éditorial.
« M. Balladur
[…] a quelque mérite à s'y accrocher dans un pays où, depuis près de quatre-vingts ans, les gouvernements ont manié à répétition la planche à billets et procédé à d'innombrables dévaluations
», commente-t-il alors. Selon lui, en effet, « la stabilité de la valeur de la monnaie est un facteur de sécurité et d'enrichissement pour tous
» ; elle a même « une valeur morale
». « Cependant
», souligne-t-il, « la conversion de l'État français à la stabilité monétaire est trop récente pour effacer les doutes sur la durée
» ; c'est pourquoi, prévient-il, « le "franc fort" demeure bien fragile
».
Et de poursuivre : « M. Balladur a fait le pari de concilier une politique du "franc fort" avec une reprise de l'emploi. Ce pari n'est pas gagné d'avance. Alors que notre économie dépend largement de ses échanges extérieurs, nous devons faire face aux "dévaluations compétitives" de certains pays de la Communauté européenne, tels la Grande-Bretagne, l'Italie ou l'Espagne, tandis que les États-Unis et le Japon continuent à sous-évaluer leur monnaie respective pour faciliter leurs exportations. La puissance économique de ces deux derniers leur permet de nous imposer le cours de leur monnaie. Ne risquons-nous pas d'être victimes d'un excès de rigueur ? On peut se demander par ailleurs s'il est possible de combiner le maintien d'un "franc fort" avec des charges fiscales et sociales et des réglementations aussi lourdes que celles qui pèsent sur les entreprises françaises sans conduire l'économie sur la voie de la récession.
»
Le propos se veut donc nuancé. Quelques jours plus tôt, sur le même sujet, Pierre Pujo s'était montré critique à l'égard du chef de file des opposants à l'Union européenne en gestation. « M. Séguin condamne la politique du franc fort (disons plutôt du franc stable) qui conduit la France à lier son sort à l'Allemagne, à assouplir le statut de la Banque de France pour mieux la mettre sous la dépendance de la Bundesbank
», rappelle-t-il dans son éditorial du 24 juin 1993 ; « il souhaiterait que le franc "décroche" du deutschemark et il ne répugne pas à une dévaluation éventuelle
». Or, selon le directeur de L'Action Française Hebdo, « il est permis d'émettre des réserves sur ce point
». En effet, explique-t-il, « une dévaluation renchérirait nos importations qui (l'expérience passée le montre) ne diminueraient pas en volume, relancerait l'inflation et ferait remonter les taux d'intérêts
» ; et d'annoncer que « la croissance économique en France ne serait nullement garantie
».
Publié dans Action française, Économie et Industrie, Histoire | Pas de commentaires
18 mars 2017
Comment la réforme de la Banque de France fut traitée en 1936 dans l'organe du nationalisme intégral.

Début 1936, alors que le Front populaire n'est pas encore au pouvoir, L'Action Française en annonce le programme. Dans un numéro paru le 12 janvier, Perspicio évoque, entre autres, sa volonté de « faire de la Banque de France, aujourd'hui banque privée, la banque de la France
» ; cela afin de « soustraire le crédit et l'épargne à la domination de l'oligarchie économique
».
Le spectre des assignats
Quelques mois plus tard, alors qu'une loi sera bientôt votée à cet effet, Le Petit Journal s'en réjouit, comme le rapporte l'« organe du nationalisme intégral
» dans son numéro du 18 juillet : « Un privilège disparaît. Un grand espoir apparaît. La République entre à la Banque de France. Il faut l'y installer. Cette banque peut, si nos gouvernants persévèrent – et nous faisons confiance à leur fidélité – devenir, enfin, non plus la chose de deux cents féodaux, mais la banque des Français.
» Signant la revue de presse du quotidien royaliste, Pierre Tuc se montre critique : de son point de vue, « la "réforme" de la Banque de France apparaît en effet comme une belle duperie
». Et de citer L'Ère nouvelle, « fort inquiète
» : « On ne résoudra pas la question en faisant clamer par les haut-parleurs que la Banque de France va devenir la banque de la France. Car, si l'on veut faire courir à notre institut d'émission tous les risques que supportent, plus ou moins bien – ou mal – toutes les antres banques, on ne fera que doubler la fonction de celles-ci sans profit avouable pour personne et sans raison. Et si, dans le même temps, on entend demander à la Banque de Fiance d'apparaître comme un instrument docile à satisfaire à toutes les demandes de l'État et des collectivités, solvables ou non, on aura tôt fait de détruire la garantie de la monnaie et d'avilir celle-ci. Jusqu'à quel point ?
»
Le même jour, dans la foulée d'une diatribe antisémite, Charles Maurras dénonce les « innovations dangereuses apportées à la Banque de France
» ; « les fondateurs de notre institut d'émission y avaient accumulé les forces de résistance destinées à donner confiance, c'est-à-dire à constituer du crédit
», rappelle-t-il notamment, craignant manifestement que cet héritage soit dilapidé. Le lendemain, Marie de Roux affirme que « l'étatisation de la Banque est un immense danger économique
». « Nous allons droit à l'assignat, plus ou moins masqué
», surenchérit Léon Daudet dans le même numéro ; « la nationalisation de la Banque de France
», c'est « la planche à assignats fonctionnant a tour de bras
», avait-il annoncé deux jours plus tôt, le 17 juillet.
La monnaie à la botte des partis
« Le plus important, les questions de crédit et d'escompte, sera désormais soumis aux volontés de gouvernements de passage
», déplore encore L'Action Française dans son édition du 16 juillet 1936. Et d'enfoncer le clou trois jours plus tard : « Le nouveau statut de la Banque de France met le crédit du pays à la disposition et au service des partis au pouvoir. Et quand on connaît ces partis et leur émanation, on ne peut s'empêcher d'être justement alarmé. Aussi bien la Bourse, par sa mise volontaire en sommeil, reflète-t-elle exactement l'angoisse grandissante du pays réel qui ne peut être dupe des manifestations d'allure impressionnante de l'équipe judéo-maçonnique
[sic] en place.
»
« Pierre Gaxotte caractérise admirablement
[…] l'opération du gouvernement Blum et de la majorité contre la Banque de France
», résume Pierre Tuc, dans sa revue de presse du 24 juillet 1936. « La Banque de France est désormais une banque d'État
», regrette celui-là. Et celui-ci de rapporter son commentaire paru dans Candide : « La Banque de France, la vraie, celle qui est morte cette semaine, avait été établie pour défendre la stabilité de la monnaie, pour garantir au franc, mesure de toutes choses, une valeur constante et sincère. La nouvelle Banque, celle du Front populaire, est organisée pour fournir à la coalition socialo-communiste la quantité de billets dont elle a besoin. Les opérations de l'ancienne banque (escompte, crédit, etc.), étaient subordonnées au maintien du franc à sa parité or. Pour la nouvelle, la défense du franc n'est qu'une tâche accessoire, secondaire, sacrifiée. La besogne primordiale est d'imprimer des billets et de les répandre là où la majorité parlementaire veut qu'ils aillent.
»
Empirisme organisateur
Quelques mois plus tôt, le 21 mai, Pierre Tuc avait cité Claude Barjac rappelant dans L'Ordre que la Banque de France avait toujours été « dans toutes les grandes crises, l'auxiliaire indispensable et toujours présente de l'État
» : « Sans elle, le gouvernement aurait fait faillite en 1830. Sans elle, le Trésor aurait dû fermer ses guichets en 1870 et en 1871, Sans elle on ne sait comment aurait pu être menée la dernière guerre. Dans ces grandes circonstances, elle a vraiment joué le rôle de banque d'État, par toutes les avances qu'elle a faites au Trésor ; mais précisément elle l'a fait parce qu'elle n'était pas banque d'État, et parce qu'ainsi elle avait conservé intact un crédit que n'avait plus le gouvernement. Que le gouvernement absorbe la Banque, la Banque fera défaut à l'État le jour où celui-ci aura besoin de ressources que les circonstances ne lui permettront pas de se procurer directement. Ce qui est exact, c'est que Banque et État sont étroitement solidaires l'un de l'autre. Aussi est-il tout naturel que l'État veuille avoir droit de regard sur la Banque, mais ce ne signifie pas qu'il doive lui enlever son caractère essentiel qui est d'être indépendante. On peut tout obtenir de la Banque de France quand son intervention est indispensable, on l'a vu dans le passé, encore y a-t-il la manière.
» Une fois n'est pas coutume, les royalistes s'en remettent à la sagesse de l'Empereur : « Je veux, disait Napoléon en 1806, que la Banque soit assez dans les mains du gouvernement et n'y soit pas trop.
»
Les débats d'hier sont-ils susceptibles d'éclairer ceux d'aujourd'hui ? Force est de constater que les inquiétudes exprimées jadis sont ravivées aujourd'hui, tandis qu'on parle d'une hypothétique sortie de l'Union économique et monétaire. Dans cette perspective, il est assurément saisissant, voire piquant, de constater le renversement des forces en présence. Cela étant, il serait bien hasardeux d'en tirer quelque conclusion. Tout au plus s'agit-il d'une petite porte entrouverte sur l'histoire.
Publié dans Action française, Économie et Industrie, Histoire | Pas de commentaires
17 mars 2017
Retour en juillet 1936.

L'histoire est pleine d'ironie. Les statuts de la Banque de France furent jadis réformés à l'initiative du Front populaire, afin d'exercer un certain contrôle politique sur ses activités. C'est un peu ce que réclament les souverainistes aujourd'hui ! Mais comment cette réforme fut-elle accueillie à l'époque par L'Action Française, « organe du nationalisme intégral
», comme ce journal se définissait lui-même ?
Un premier indice nous est donné par la lecture de son numéro du 24 juillet 1936. « Pierre Gaxotte caractérise admirablement
[…] l'opération du gouvernement Blum et de la majorité contre la Banque de France
», écrivait Pierre Tuc dans une revue de presse parue ce jour-là. « La Banque de France est désormais une banque d'État
», regrettait alors Pierre Gaxotte. Extrait de son commentaire publié auparavant par Candide :
« La Banque de France, la vraie, celle qui est morte cette semaine, avait été établie pour défendre la stabilité de la monnaie, pour garantir au franc, mesure de toutes choses, une valeur constante et sincère. La nouvelle Banque, celle du Front populaire, est organisée pour fournir à la coalition socialo-communiste la quantité de billets dont elle a besoin. Les opérations de l'ancienne banque (escompte, crédit, etc.), étaient subordonnées au maintien du franc à sa parité or. Pour la nouvelle, la défense du franc n'est qu'une tâche accessoire, secondaire, sacrifiée. La besogne primordiale est d'imprimer des billets et de les répandre là où la majorité parlementaire veut qu'ils aillent. Les deux conceptions s'excluent. Le Front populaire affirme repousser l'inflation : il l'organise. L'Humanité a exprimé à cet égard des réserves significatives : c'est sur le terrain monétaire que les communistes fausseront un jour compagnie à l'équipe Blum. L'opération se prépare de loin. En attendant, la planche à billets est en place. Le mécanisme commence à tourner. »
Ces propos, pour le moins critiques, sont les premiers nous ayant été proposés par Gallica à la faveur d'une recherche sur le sujet dans les colonnes de L'Action Française. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en rapporter quelques autres !
Publié dans Action française, Économie et Industrie, Histoire | Pas de commentaires
16 mars 2017
Extrait d'un éditorial d'Aspects de la France publié dans les années quatre-vingt.

Depuis la Libération et jusqu'à sa disparition au profit de l'euro, le franc subit des dévaluations à répétition. Au sens le plus strict, la dernière remonte au 6 avril 1986. Commentant l'événement quelques jours plus tard dans les colonnes d'Aspects de la France, Pierre Pujo se montrait désabusé. Extrait de son éditorial du 10 avril :
« Lors de chaque dévaluation, les dirigeants français prennent des résolutions de rigueur et de sagesse, moyennant quoi nos partenaires étrangers nous accordent leur absolution en se prêtant à un rajustement des monnaies. […] Hélas, les bonnes résolutions françaises ne durent pas et nous retombons bientôt dans nos fautes passées ! Notre malédiction s'appelle la démocratie dont les effets démagogiques sont bien pires en France que chez nos voisins d'outre-Rhin. Tant que la démocratie poursuivra chez nous ses débordements, il ne faut pas s'attendre à voir les choses changer. On continuera périodiquement à réévaluer le Deutsche Mark et à dévaluer le franc. »
Cela ne manquera pas de nourrir les réflexions sur l'éclatement potentiel de l'Union économique et monétaire. À l'époque, celle-ci n'était même pas en gestation… Le moment venu, le directeur d'Aspects de la France puis de L'Action Française 2000 ne manqua pas de s'opposer à sa constitution, gardons-nous de travestir sa pensée ! Cela étant, peut-être n'est-il pas inutile de rappeler avec lui qu'« une dévaluation est le signe d'un affaiblissement économique du pays
». À méditer.
Publié dans Action française, Économie et Industrie, Histoire | Pas de commentaires
16 février 2017
François Villeroy de Galhau galvanise les conspirationnistes qui fantasment sur la loi "Pompidou-Giscard-Rothschild" de 1973.

L'accusation a été lancée par Alain Madelin, mardi dernier, 14 février 2017, sur BFM Business : « je soupçonne fortement Villeroy de Galhau d'être un sous-marin du Front national
», a-t-il déclaré ; « parce qu'une facture de 30 milliards pour la sortie de la France de l'euro, ce n'est vraiment pas cher
», a-t-il expliqué. À ses yeux, c'est même « une facture ridicule
» ; en réalité, a-t-il prévenu, « bien évidemment, elle serait beaucoup plus élevée
».
La veille, le 13 février, le gouverneur de la Banque de France était intervenu sur France Inter, répondant aux questions d' Alexandra Bensaid. À cette occasion, il a évoqué la question « du financement des déficits par la Banque de France
». « On dit quelquefois que cette interdiction date de l'euro
», a-t-il rappelé ; mais « cela n'est pas le cas
», a-t-il poursuivi, affirmant qu'« elle date de bien avant
» et, plus précisément, « d'une loi de 1973
». C'est exagérer la portée de cette loi, qui avait modifié sans les bouleverser les statuts de la Banque de France établis dans les années trente. D'ailleurs, comme l'a souligné Jean-Marc Daniel sur BFM Business, « tous les gens qui accusent la loi de 73 d'avoir tout bloqué devraient regarder comment a été financé le plan de relance de 1975
».
Incidemment, donc, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, donne du crédit à cette thèse conspirationniste d'inspiration clairement antisémite, selon laquelle Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, aux ordres de la banque Rothschild, auraient soudainement privé la France d'une source inépuisable de financement, cela dans le seul but d'enrichir des juifs cupides aux dépens de la nation. Affligeant !
NB – Quelques liens présentant la réelle teneur de cette loi votée en 1973.
Publié dans Conspirationnisme, Économie et Industrie | Pas de commentaires
16 février 2017
Article publié dans L'Action Française 2000
La présentation d'une nouvelle Alpine est imminente. Pour Renault, il s'agit de renouer avec une tradition en sommeil depuis une vingtaine d'années.

L'attente aura été longue : le mois prochain (en mars 2017), à l'occasion du salon de Genève, sera enfin dévoilée la nouvelle Alpine ; plus d'un quart de siècle se sera écoulé depuis la présentation, en mars 1991, au même endroit, de l'A610, ultime héritière d'une dynastie fondée en 1955. Pour peu qu'ils soient chauvins, cela ne manquera pas de réjouir les amateurs de conduite, sinon de pilotage. « À quoi sert la course automobile ?
», avait jadis demandé le général de Gaulle. « À faire gagner la France !
», lui avait répondu Jean Rédélé, fondateur d'Alpine.
Montée en gamme
C'est d'abord sur la route que cette nouvelle voiture se frottera à ses rivales. Moins bourgeoise qu'une Porsche Cayman, elle s'annonce toutefois plus confortable qu'une Lotus Élise. À travers elle, Renault prétend investir le segment du « sport premium
». Sans doute les ventes seront-elles modestes, quoique les quelque deux mille premiers exemplaires ouverts à la réservation aient déjà trouvé preneur. En tout cas, c'est un petit pas vers la montée en gamme du Losange. De toute façon, comme l'expliquait dernièrement Carlos Tavares, ancien directeur général de Renault, aujourd'hui à la tête de PSA, « la course au volume est une dimension d'un autre âge
» (Les Échos) – la priorité étant désormais donnée à l'accroissement des marges.
Reniant l'aspect spartiate de la célèbre A110, ce nouveau modèle se rapprochera davantage, dans sa philosophie, de l'A310 appelée à lui succéder en 1971. Mais pas dans son design ! Se raccrochant aux épisodes les plus glorieux de son histoire, Alpine inscrit son renouveau dans l'héritage quasi-exclusif de la berlinette disparue en 1977. D'un point de vue technique, cependant, sa lointaine descendante s'en distingue à bien des égards. Son moteur ne sera plus disposé en porte-à-faux arrière, mais en position centrale, juste derrière les sièges. De plus, « elle va disposer d'un châssis en aluminium qui est la marque de fabrique de Lotus et non d'Alpine
», s'indigne Jacques Cheinisse, numéro 2 historique de la marque, dans un entretien au site Motor 1. Cela étant, toute tradition n'est-elle pas nécessairement critique ?
Soucieux de renouer avec elle, Renault enracine à Dieppe, siège historique de la marque, la production de la nouvelle Alpine. C'est un choix rationnel dans une optique strictement économique, cette usine étant spécialisée dans les productions de niche et tout particulièrement dans celle des voitures de sport. Mais c'est aussi un atout marketing, les clients potentiels exigeant aujourd'hui, plus ou moins consciemment, des gages d'authenticité. En revanche, le retour du "A fléché" en compétition apparaît, quant à lui, très artificiel : si les victoires sont engrangées sur les circuits des European Le Mans Series, elles le sont en fait par un constructeur tiers (Signatech) dont les voitures ont simplement été repeintes aux couleurs d'Alpine.
Noblesse mécanique
Le public sera-t-il dupe ? On verra bien. Mais peut-être Renault aura-t-il tiré quelque leçon de ses erreurs, parfois récentes. En 2010, il avait tenté une relance bien hasardeuse de Gordini, un nom prestigieux lui aussi, ravalé au rang de simple finition. Par ailleurs, ses modèles sportifs ont souvent pâti d'un manque de noblesse mécanique. Sur ce point, les circonstances jouent en sa faveur : sous les capots des Porsche et autres BMW, par exemple, afin de réduire les consommations, les moteurs quatre cylindres sont désormais légion, si bien que l'Alpine n'aura pas à rougir de la comparaison. Si les acheteurs sont conquis, il sera tentant de transformer l'essai afin d'en récolter des dividendes via la production d'une modèle plus largement diffusé (on parle déjà d'un SUV). Au risque de rompre les fils reliant Alpine à son passé, lesquels sont pourtant la clef du succès escompté.
Publié dans Automobile, Économie et Industrie, Société | Pas de commentaires