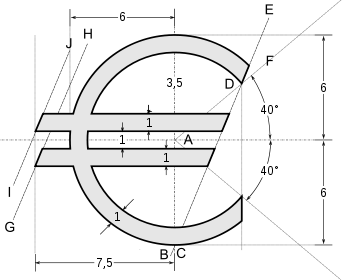12 janvier 2011
Intervenant dans la "bataille de l'euro", Alain Madelin se distingue en
fustigeant les velléités fédéralistes dont s'honorent moult défenseurs
de la monnaie unique.
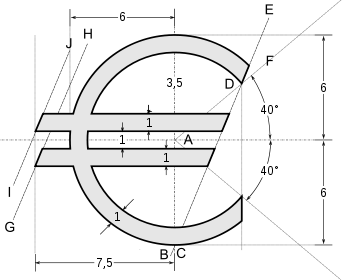
« L'euro a-t-il besoin de plus de
fédéralisme budgétaire et fiscal pour survivre à la
crise ? » Certainement pas aux yeux d'Alain Madelin.
Dans une
tribune publiée le mois dernier (en décembre 2010), l'ancien
ministre de l'Économie conteste vigoureusement les poncifs
européistes : « Plutôt qu'à des surenchères
ultra-irréalistes voire dangereuses, nous ferions mieux de revenir aux
fondamentaux », affirme-t-il : « une stricte
discipline budgétaire et une plus grande flexibilité économique,
assorties d'une police indépendante ».
« Le problème originel de l'euro, c'est
l'hétérogénéité des pays qui l'ont adopté », explique Alain
Madelin. De fait, « nos vieux pays européens ne peuvent guère
être comparés aux États américains de par leurs langues, leurs
cultures, leurs modèles sociaux et familiaux, leurs structures
économiques et démographiques, leurs choix collectifs, leurs niveaux de
dépenses publiques... » Cependant, poursuit-il, « une
telle diversité ne fait pas obstacle à l'adoption d'une même monnaie en
l'absence de véritable État fédéral. L'étalon or hier, le franc CFA ou
le dollar de Hong Kong aujourd'hui montrent que des liens monétaires
fixes peuvent unir des pays fort différents sans besoin d'un
gouvernement commun. » Mais « la solidarité au sein
de l'Europe n'a rien de comparable avec celle qui permet la coexistence
dans une même nation de l'ile-de-France et la Guadeloupe, de l'Italie
du Nord et du Mezzogiorno ou celle qui unit les États américains. Une
solidarité d'ailleurs complétée par la mobilité interne de la
population facilitée par l'usage d'une même langue. »
En conséquence, affirme Alain Madelin, « il est
chimérique d'imaginer un budget fédéral européen organisant des
transferts financiers massifs pour compenser les différences de
compétitivité. Tout comme il est chimérique de vouloir forcer la
solidarité par l'émission d'obligations européennes communes. [...]
Quant à l'idée d'harmoniser [...] les politiques fiscales et sociales
au travers d'un gouvernement économique, il est clair qu'elle se heurte
tant à l'exigence de souplesse et de concurrence de la zone euro qu'à
la nécessité de faciliter les ajustements des différences nationales
par des variations relatives de prix et des politiques budgétaires
autonomes. »
Et Madelin de conclure que « de telles propositions,
si elles étaient suivies, conduiraient assurément à l'explosion et de
l'euro et de l'Europe ».
Publié dans Économie et Industrie, Europe | Pas de commentaires
9 janvier 2011
Commentaire du rapport sur la gouvernance économique
européenne remis au président de la République jeudi dernier,
6 janvier 2011.

À la demande du président de la République, « un
chemin pour un "pilotage économique européen" » a été tracé
par Constance Le Grip et Henri Plagnol, respectivement député
au Parlement européen et député du Val-de-Marne. Leur
rapport reprend moult propositions ouvertement soutenues par
Paris, sinon d'ores et déjà mises en œuvre par l'Union ou ses États
membres. En marge des banalités, on relève un appel à développer les
capacités d'emprunt de Bruxelles, un plaidoyer en faveur d'une gestion
commune des dettes souveraines, et la volonté de réviser en profondeur
le budget communautaire.
Tétanisés par « une montée inquiétante [...] des
mouvements populistes et nationalistes dans l'ensemble de
l'Union », les rapporteurs préviennent « que le
gouvernement économique européen n'est pas le cheval de Troie du
fédéralisme ». « Au cœur de notre
problématique », expliquent-ils, « il y a la défiance
des peuples et des États vis-à-vis de l'Union ». Arguant de
« la complexité institutionnelle de l'Union » (qui
s'avère davantage affectée par son originalité en réalité), ils
martèlent que « seul le Conseil européen constitué des chefs
d'État et de gouvernement peut impulser une dynamique
efficace ». Considérant que « l'Union n'a de raison
d'être que si les États membres ont des intérêts communs à défendre
dans la nouvelle donne mondiale », ils proclament que
« c'est évidemment le Conseil européen qui est la seule
instance légitime pour définir ces intérêts et décider de la meilleure
stratégie pour les promouvoir » - cela en dépit des traités
selon lesquels « la Commission promeut l'intérêt général de
l'Union et prend les initiatives appropriés à cette fin ».
L'implication de la Commission est contestée jusque dans ses missions
les plus traditionnelles : ainsi les rapporteurs
préféreraient-ils confier à un "Conseil des sages", créé à cet effet,
la surveillance des écarts de compétitivité et la responsabilité
d'identifier « des seuils de divergence acceptables ou non en
matière salariale ou sociale ».
S'agit-il d'un tournant ? Pas vraiment. Comme le
rappellent Constance Le Grip et Henri Plagnol, « sous la
pression de la crise, la répartition des rôles a [...]
changé ». Sans doute la personnalité des dirigeants européens
et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ont-ils également
contribué à renforcer le poids du Conseil européen. En pleine
controverse autour des Roms, alors qu'il était encore secrétaire d'État
en charge des Affaires européennes, Pierre Lellouche aurait tenté de
justifier, auprès
de notre confrère Jean Quatremer, la défiance de Paris à
l'égard de l'Europe communautaire. L'Élysée ayant commandité ce
rapport, celle-ci se trouverait-elle délibérément confirmée ?
Publié dans Europe | Pas de commentaires
7 janvier 2011
Bruxelles affiche de timides velléités protectionnistes.

« Il convient [...] de protéger notre propriété
intellectuelle et nos marchés des biens non conformes à nos règles en
matière de protection des consommateurs », a affirmé l'Italien
Antonio Tajani commissaire européen en charge de l'Industrie et de
l'Entreprenariat, dans un
discours diffusé, cette fois-ci, par le service de presse de
Bruxelles.
« Je suis également en train d'envisager
l'opportunité de prendre des initiatives pour protéger nos actifs
stratégiques », a-t-il déclaré, évoquant l'autonomie spatiale,
les terres rares (dont
la Chine a décidé de réduire les exportations), et la
conservation des savoir-faire technologiques.
« Il nous faut prendre acte du fait que les marchés
sont devenus mondiaux, avec des chaînes de valeur disséminées autour du
globe », a-t-il encore observé. Arguant de ce constat
inévitable, il s'est dit « convaincu qu'il n'est plus possible
de réfléchir en termes de marchés nationaux et de politiques
économiques nationales ». Sur ce point au moins, sans doute y
a-t-il matière à discussion !
Publié dans Europe | Pas de commentaires
6 janvier 2011
Timide immixtion dans le domaine financier.

Dans une tribune publiée par L'Action
Française 2000, Jean-Claude Martinez appelle au
non-remboursement des dettes publiques « Les États ont [...]
le choix », affirme-t-il : « ou faire payer
des millions de femmes et d'hommes, en leur enlevant le nécessaire
vital, ou faire payer quelques milliers de traders,
de banquiers, de financiers, en diminuant les moyens de leur luxe
outrancier ».
Vision manichéenne, sinon simpliste, que l'auteur semble
lui-même démentir quand il observe que « les
créanciers prêteurs des États ne sont plus des banquiers
lombards ou des Templiers bien identifiés ». Les acteurs
intervenant sur les marchés financiers n'étant pas des
individus mais des personnes morales, cela rend peu opérantes les
accusations de cupidité, et pour le moins légère la mise en cause d'une
caste de privilégiés.
« Banques, fonds de pension, compagnies d'assurance,
institutions financières ne sont pas de simples prêteurs, mais des
concurrents, voire des adversaires des États, qui règnent déjà en
maîtres sur les marchés mondialisés, en n'obéissant à aucun
droit », écrit encore le professeur Martinez, que nous
soupçonnons de forcer le trait. Quid des règles prudentielles, en vertu
desquelles les banques fuient les obligations d'État les moins bien
notées, alimentant de facto la crise des
dettes souveraines ? Les marchés ont bon dos ! Plutôt
que de désigner un bouc émissaire, nous voudrions décrypter leur
fonctionnement. Peut-être quelques lecteurs pourront-il nous y
aider ! 😉
Publié dans Économie et Industrie | 2 Commentaires
6 janvier 2011
Article publié dans L'Action Française 2000
Puissant moteur de l'intégration européenne, la Cour de
Justice de Luxembourg (CJUE) a failli à sa réputation le mois dernier.

Ainsi a-t-elle jugé « conforme au droit de
l'Union » l'interdiction d'admettre des non-résidents dans les
coffee-shops néerlandais. De son point de vue,
« l'introduction de stupéfiants dans le circuit économique et
commercial de l'Union étant interdite, un tenancier d'un coffee-shops
ne saurait se prévaloir des libertés de circulation ou du principe de
non-discrimination, en ce qui concerne l'activité consistant en la
commercialisation du cannabis ». Aussi la décision du conseil
communal de Maastricht lui apparaît-elle « justifiée par
l'objectif visant à lutter contre le tourisme de la drogue et les
nuisances qu'il draine, objectif se rattachant tant au maintien de
l'ordre public qu'à la protection de la santé des citoyens ».
Des patronymes non reconnus
Par ailleurs, toujours selon la Cour de Justice de l'Union
européenne, « un État membre peut refuser de reconnaître le
nom d'un ressortissant contenant un titre de noblesse, tel qu'il a été
obtenu dans un autre État membre ». Affirmant « que
l'Union respecte l'identité nationale de ses États membres »,
la Cour estime que « la forme républicaine de
l'État » en fait aussi partie. « Elle admet donc que,
dans le contexte de l'histoire constitutionnelle autrichienne, la loi
d'abolition de la noblesse peut être considérée comme une justification
d'ordre public et, par conséquent, être mise en balance avec le droit
de libre circulation des personnes reconnu par le droit de
l'Union. » D'autant que cette loi constitue à ses yeux
« la mise en œuvre du principe plus général de l'égalité en
droit de tous les citoyens autrichiens, principe que l'ordre juridique
de l'Union tend à assurer en tant que principe général du
droit ».
Publié dans Europe | Pas de commentaires