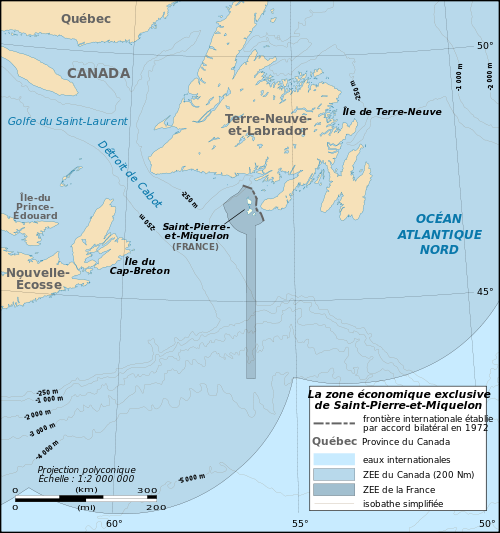5 mars 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
À la faveur du droit international, Paris convoite des
ressources maritimes situées au-delà de sa zone économique exclusive,
notamment dans l'Atlantique Nord, autour de Saint-Pierre-et-Miquelon.
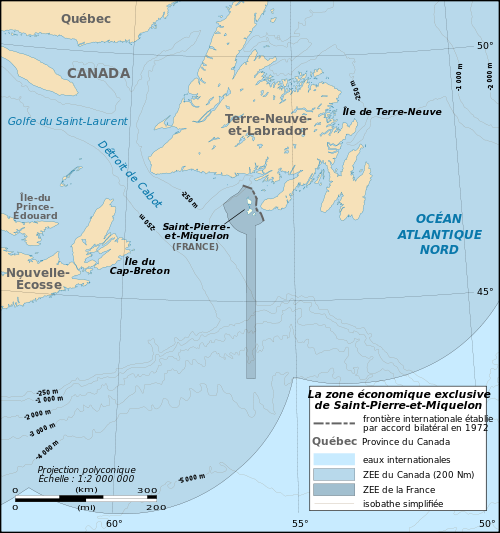
La délimitation des frontières Amaritimes « est bien
l'un des enjeux du XXIe siècle », préviennent les
députés Jean-Claude Fruteau (PS), Paul Giacobbi, Annick Girardin et
Roger-Gérard Schwartzenberg (affiliés tous les trois au PRG). Dans une
proposition de résolution, dont l'Assemblée nationale devait discuter
en séance publique mardi dernier, 18 février 2014,
ils appellent « à la reconnaissance des droits légitimes de la
France sur le plateau continental de
Saint-Pierre-et-Miquelon ». Au risque de froisser Ottawa,
Paris en revendique l'extension, en application du droit international.
Montego Bay
Comme l'expliquent les parlementaires, la convention des
Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay en 1982 et
ratifiée par la France en 1996, « a ouvert la possibilité pour
les États côtiers d'étendre leur juridiction sur les ressources se
trouvant sur son plateau continental, c'est-à-dire sur les fonds marins
et leur sous-sol, et ce, au-delà des deux cent milles marins constitués
par la zone économique exclusive de base ». En mai 2009, une
lettre d'intention a donc été déposée auprès de la Commission des
limites du plateau continental (CLPC), émanation de l'ONU.
« Depuis lors les éléments constitutifs de notre revendication
se sont renforcés », se réjouissent les députés. « En
juillet 2011, une campagne scientifique a été menée au large de
l'archipel par le navire le Suroit dans le cadre du grand programme
Extraplac, conduit par l'Ifremer, afin de préparer les dossiers de
revendication devant la CLPC. Les résultats scientifiques de cette
campagne sont probants et montrent que le plateau continental de
Saint-Pierre-et-Miquelon répond bien géologiquement aux critères
juridiquement exigés par le droit international pour permettre
l'extension d'un plateau continental au-delà de la limite des deux
cents milles marins. »
De quoi nourrir quelque espoir de revanche ?
« Saint-Pierre-et-Miquelon est la seule collectivité
d'outre-mer française située en Amérique du Nord, à vingt-cinq
kilomètres de Terre-Neuve au Canada », rappellent les
parlementaires. « Peuplé de 6 311 habitants,
Saint-Pierre-et-Miquelon a toujours vécu, depuis le XVIe siècle, de la
pêche jusqu'à ce que la diminution des ressources halieutiques et un
arbitrage désastreux intervenu en 1992 entre le Canada et notre pays,
arbitrage donc les conséquences nous furent particulièrement
défavorables – il fut vécu comme une injustice dans l'archipel –, aient
condamné ce petit territoire à ne plus pouvoir exploiter les richesses
de la mer, compromettant gravement sa survie économique et, à terme, la
pérennité même de la présence de nos compatriotes sur ces
îles. »
Parfum de revanche
« Aujourd'hui, une nouvelle chance est offerte à
Saint-Pierre-et-Miquelon et, plus largement, à notre pays »,
se félicitent Jean-Claude Fruteau, Paul Giacobbi, Annick Girardin et
Roger-Gérard Schwartzenberg. Le président de la République semble
décidé à la saisir. Le 24 juillet dernier, il avait promis que
« la France défendrait les intérêts de l'archipel concernant
l'extension du plateau continental au large de
Saint-Pierre-et-Miquelon ». « Le cap est donc
clairement fixé », se félicitent les députés. « Reste
à déposer concrètement ce dossier de revendication auprès de la CLPC,
ce qui incombe au gouvernement. » Affaire à suivre.
Publié dans International, Monde, Outre-mer | Pas de commentaires
24 février 2014
Évoquant la Collaboration mise en œuvre par le régime de
Vichy, Libération entretient la confusion
historique.

« Étape par étape, sous couvert de bonne volonté,
l'État se met au diapason de l'ensemble de la politique du
Reich : aryanisation des entreprises, obligation du port de
l'étoile jaune et déportation de
78 000 Juifs », rapporte
notre consœur Sophie Gindensperger. Or, si la police
française a participé à la distribution des étoiles jaunes en zone
occupée, ce fut en application d'une ordonnance allemande. En outre, comme
rappelé sur Wikipedia,
« l'étoile jaune n'a pas été portée en zone libre, même après
son envahissement, le 11 novembre 1942 ». Bien qu'il ait fait
« apposer le tampon "Juif" sur les papiers
d'identité », le maréchal Pétain « s'opposa au port
de l'étoile jaune en zone libre » : « Tant
que je serai vivant, je n'accepterai jamais que cette ignominie qu'est
l'étoile jaune soit appliquée en zone Sud », aurait-il déclaré
au grand rabbin Schwartz.
Le souvenir de l'Occupation est suffisamment douloureux pour
qu'on s'épargne de l'assombrir injustement.
Publié dans Histoire | 3 Commentaires
15 janvier 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
Alors que les autorités s'apprêtent à célébrer l'amitié
franco-chinoise, nous avons interrogé une jeune femme qui l'éprouve au
quotidien depuis son arrivée à Paris.

La présence des Chinois est devenue familière en France, du
moins pour ceux d'entre nous vivant à Paris. Jing, la trentaine, y est
arrivée pour ses études voilà trois ans. Elle est originaire de
Tsingtao, une ville de la province du Shandong, construite par les
Allemands, célèbre pour sa bière exportée aux quatre coins du monde. À
sa naissance, nous raconte-t-elle, il n'y avait pas de télévision dans
les foyers, ni même de réfrigérateur - alors qu'aux États-Unis,
avait-elle découvert dans des films, chacun avait sa voiture.
« C'était incroyable », se souvient-elle. La Chine, à
l'époque, « c'était comme la Corée du Nord
actuellement », nous explique-t-elle.
Ouverture des portes
Dans les années soixante-dix, l'empire du Milieu a commencé à
ouvrir ses portes, nous rappelle-t-elle. Son développement économique,
qui s'accélère depuis lors, a franchi un nouveau cap dans les années
2000, à la faveur d'un « boom de la high tech ». La
France apparaît « très, très importante » aux yeux de
notre interlocutrice. Notamment dans la distribution.
« Carrefour est très présent en Chine », nous
précise-t-elle. L'influence mondiale de Pékin croît à la mesure de son
économie. D'un point de vue politique, « nous sommes de plus
en plus forts », observe Jing. Elle énonce ce constat avec
réalisme, mais sans orgueil, nous semble-t-il. Consciente des
inquiétudes suscitées par l'émergence de son pays, elle lui dénie toute
velléité impérialiste. « Nous ne sommes pas
belliqueux », se défend elle. La question du Tibet lui tient
particulièrement à cœur. Spontanément, elle s'insurge contre la
propagande à l'œuvre en France au profit du dalaï-lama. Quant à la
multiplication des interventions militaires en Afrique, elle traduirait
simplement la poursuite par Paris de ses propres intérêts. Visiblement,
les Chinois ne sont pas abusés par les discours lénifiants sur les
droits de l'homme.
Romantisme français
En Chine, nous dit-elle, « on pense que les Français
sont romantiques ». Qu'en est-il en réalité ?
« Cela dépend », nous répond-elle. « Les
Français aiment bien les fleurs » ; de plus,
« ils font beaucoup de bisous », observe-t-elle avec
enthousiasme. Paris demeure associé au luxe dans l'imaginaire chinois,
nourri par le souvenir de Louis XIV et le prestige de marques
telles que Dior et Chanel. Dans un autre registre, Michelin a lui aussi
la cote. Principale ombre au tableau : comparés aux Chinois,
« les Français ne sont pas travailleurs », remarque
notre interlocutrice ; pour preuve, « ils aiment beaucoup les
vacances » !
Reste un privilège réservé aux Français : la liberté.
Celle de surfer sur Youtube ou Facebook, notamment. La censure à
l'œuvre dans l'empire du Milieu ne lui semble plus vraiment tenable,
maintenant que l'Internet a envahi les foyers. D'ailleurs, à la
télévision chinoise, on annoncerait de plus en plus de mauvaises
nouvelles. « C'est le progrès », a-t-elle répondu à
une amie qui lui faisait part de ce constat. Cela étant, la Chine est
« un pays vraiment très grand », souligne-t-elle.
C'est pourquoi, à certains égards, la liberté serait
« vraiment un problème ». En fait, en dehors des plus
jeunes, les Chinois se montrent apparemment peu enclins à compliquer la
tâche du gouvernement, considérant que cela nuirait, en définitive, à
la prospérité du pays. Alors que nous l'invitions à s'exprimer sur la
tragédie de la place Tian'anmen – un sujet sur lequel les autorités
maintiennent le tabou en Chine -, notre interlocutrice se montre
nuancée. Tout en déplorant les souffrances infligées aux manifestants,
elle dit « comprendre » la nécessité de remédier au
désordre.
Étonnante humilité
Complaisance déplacée, magnanimité irréfléchie ?
Chacun jugera. Au fil de la conversation, nous avons relevé comme une
forme d'humilité, aux antipodes de l'individualisme revendicatif qui
nous caractérise, nous autres Français, prompts à réclamer les fruits
sans trop nous soucier de l'arbre nécessaire à leur production.
Comparant la situation de la Chine à celle de la Syrie ou de l'Irak,
par exemple, Jing considère que ses compatriotes ne sont pas à
plaindre. De toute façon, se demande-t-elle, quelle alternative y
aurait-il au gouvernement actuel ? Si le pouvoir devenait
vacant à Pékin, « ce serait la guerre »,
s'inquiète-t-elle. Sur le ton de la plaisanterie, nous lui proposons
d'échanger nos présidents. « Je ne veux pas
changer », proteste-t-elle. De fait, l'évocation de François
Hollande suscite chez elle une réaction récurrente : le
rire... Sans commentaire.
Publié dans International | 1 Commentaire
15 janvier 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
En pleine Guerre froide, la reconnaissance par la France de la
République populaire de Chine fut mal accueillie par l'Action
française.

Dans son numéro du jeudi 23 janvier 1964, Aspects
de la France dénonça « une politique dont le seul
souci apparent » était « de prendre, en toutes circonstances, le
contre-pied des États-Unis ». « L'insolence de
M. De Gaulle ne fera qu'agacer les Américains et
avivera leur désir de prendre ses distances avec un allié de jour en
jour plus rétif », était-il déploré dans l'éditorial, signé
"AF".
« Nous allons jaunir », se désolait Claude
Chavin, prédisant qu'on nous ferait « payer au centuple les
coups de boutoir, les crocs-en-jambe et les virages de notre politique
extérieure ». Cela dit, nuançait-il, « les
fautes » n'étaient « pas que de Paris ».
Évoquant la crise du canal de Suez, il rappelait que « les
Américains, à leur heure, avaient choisi Nasser ». À ses yeux,
le président de la République n'en apparaissait pas moins comme le
pendant occidental de Mao, semant la zizanie dans son propre camp. La
soif de « grandeur » du général, tout comme sa quête
d'« indépendance », lui inspiraient la plus grande
circonspection : « Comment ne pas songer en même
temps au Second Empire, à Napoléon III, à ses guerres au nom
du principe des nationalités [...] tout cela finissant à
Sedan »
Mouvements d'humeur et de vanité
« M. De Gaulle sait fort bien qu'en
piquant le colosse américain [...] il touche la fibre cocardière qui
existe au cœur des Français », lisait-on encore à la "une" du
journal : « La France, voyons, est une nation
majeure, indépendante, qui ne veut être à la remorque d'aucune autre,
si puissante soit-elle... Hélas, le mot a trop servi pour avoir gardé
quelque vertu, surtout, comme l'écrit l'éditorialiste du Bulletin de
Paris, "lorsqu'il s'agit d'une nation qui, comme nous, peut être en
très peu de quarts d'heure à peu près anéantie par les fusées
soviétiques et qui ne doit son existence qu'au bouclier
américain". »
Alors que Paris venait de larguer l'Algérie, l'AF ne
manifestait pas la moindre complaisance à l'égard du chef de
l'État : « Le vrai courage », écrivaient nos
prédécesseurs, « celui qui n'ignore pas les réalités, c'est le
chancelier Erhard qui l'a eu, lorsqu'il a reconnu que l'Allemagne
n'avait pas à rougir d'être protégée militairement par l'Amérique
puisque cette protection est la garantie suprême de son existence. Nous
ne croyons pas à l'habileté d'une politique qui, hier, amputait le
territoire national de quinze départements et qui nous conduit
aujourd'hui aux pires aventures. Nous nous refusons à confondre le
courage et l'honneur avec des mouvements d'humeur et de
vanité. » Dans quelle mesure les temps ont-ils vraiment
changé ?
Publié dans Action française, Histoire, International | Pas de commentaires
15 janvier 2014
Article publié dans L'Action Française 2000
Regard critique sur la loi contre la burqa,
qui aurait préparé les esprits à bannir les crèches de Noël de tous les
espaces ouverts au public.

Une crèche de Noël « porte-t-elle atteinte au
principe de laïcité dans les lieux publics » ? La
question a été posée par l'AFP, et reprise par plusieurs de nos
confrères, après qu'un usager de la SNCF se fut plaint d'une
représentation de la nativité dans la gare de Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron). Or, l'envisager, c'est méconnaître la nature de la laïcité
telle qu'elle est définie dans le droit français.
Jugeant cette polémique « ridicule », le
socialiste Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la
laïcité, a dû le rappeler : « La neutralité
s'applique seulement à l'État et aux bâtiments de la fonction publique,
comme les mairies ou les écoles. » En conséquence, a-t-il
souligné, « il n'y a pas d'impossibilité à installer une
crèche dans une gare, car si l'entreprise est privée avec une mission
de service public, le lieu de la gare est un espace public, un peu
comme la rue ».
De l'école à la rue
La rue où, précisément, le port du voile intégral est proscrit
depuis le 11 avril 2011 et l'entrée en vigueur de la loi votée
à cet effet. Cela en vertu de la laïcité, s'imagine-t-on
vraisemblablement. Prétendant lutter contre une pratique
marginale, au risque d'en faire la promotion, le président Sarkozy et
sa majorité auront distillé l'idée que, dorénavant, la laïcité ne
devrait plus s'imposer seulement à l'école, mais dans tous les lieux
ouverts au public. De là à s'indigner de croiser un curé en soutane, il
n'y qu'un pas... Potentiellement blessés par des lois dirigés à leur
encontre, nos compatriotes musulmans assistent, de plus, au spectacle
d'une France en prise avec sa religion historique. À ce petit jeu-là,
personne n'a rien à gagner, sinon quelque politiciens exploitant avec
démagogie la hantise croissante de l'islam, sans craindre d'en
légitimer les propagateurs les plus radicaux. Chapeau !
Publié dans Islam, Société | Pas de commentaires
6 janvier 2014
Projet de billet avorté pour L'Action Française 2000.

Ouvrant la session de l'IHEDN (Institut des hautes études de
défense nationale), l'amiral Édouard Guillaud, chef d'état-major des
armées (CEMA), a cité Antonio Gramsci, se demandant s'il était l'auteur
d'un constat ou d'une prémonition : « L'ancien monde
est en train de mourir, un nouveau monde est en train de naître mais,
dans cette période intermédiaire, des monstres peuvent
apparaître. »
Pareille inquiétude n'est pas le propre des militaires à
l'affut des bouleversements géopolitiques, loin s'en faut.
Qu'adviendra-t-il de la société que nous contribuerons à façonner au
cours de la nouvelle année ? Tandis que nos faits et gestes
sont archivés dans le nuage informatique - quand bien même nous nous
refuserions à nous exhiber sur les réseaux sociaux -, la hantise d'une
surveillance généralisée est devenue convenue. Des regards accusateurs
se sont tournés vers Google, la NSA, la loi de programmation
militaire... Mais qu'en est-il de votre voisin ? L'internet
offre des opportunités inédites aux activistes politiques. Que ce soit
pour organiser la Manif pour tous ou traquer l'ennemi. À la faveur d'un
piratage, les coordonnées des sympathisants supposés de Dieudonné ont
été livrés à la vindicte militante. On devine que la Toile n'a plus
rien de virtuel pour les victimes d'expéditions punitives. S'attaquant
à d'autres cibles, les Anonymous s'étaient déjà essayés à la délation
en ligne...
Dans le cas présent, le trouble à l'ordre public étant
désormais caractérisé, peut-être cela donnera-t-il quelque crédibilité
aux gesticulations du ministre de l'Intérieur. Preuve que la politique
reprend encore ses droits, fût-ce à mauvais escient ?
Publié dans Internet, Société | Pas de commentaires