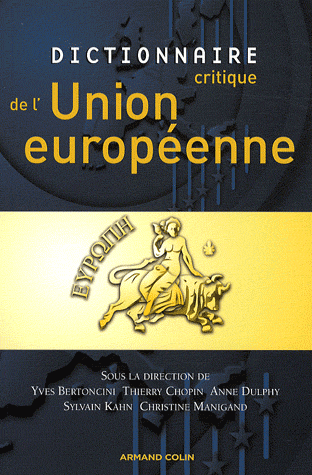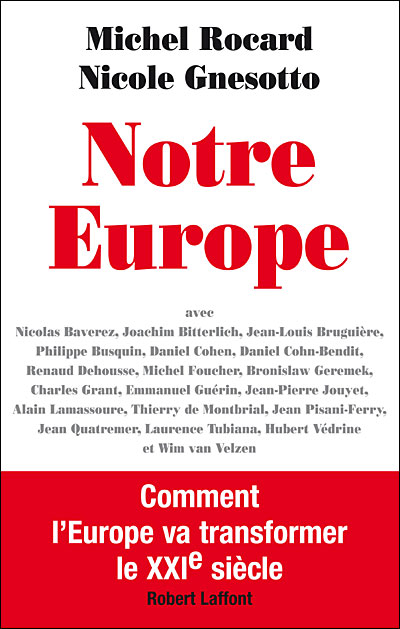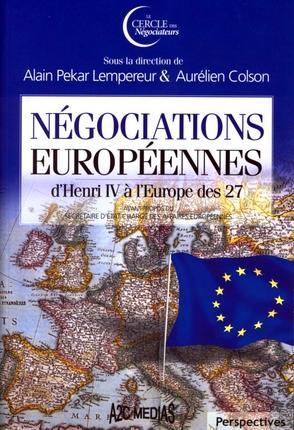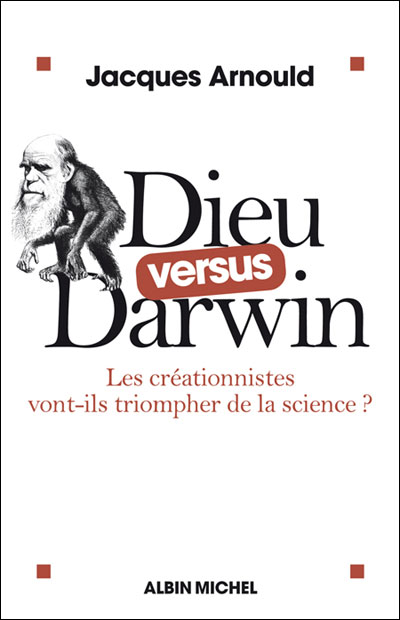30 juillet 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
L'idéologie prend parfois la défense en otage. Les déboires de
l'Airbus A400M, développé sous la bannière de la coopération
européenne, illustrent un phénomène dénoncé par le journaliste
Jean-Dominique Merchet.

Réunis au Castellet le vendredi 24 juillet, les sept pays
partenaires du programme A400M (1) se sont donné six mois pour renégocier
le contrat les liant au groupe EADS. Celui-ci avait annoncé le
9 janvier que les premiers avions ne seraient pas livrés avant
fin 2012, avec un retard de trois ans au moins. L'industriel reconnaît
sa difficulté, voire son incapacité, à satisfaire à toutes les
exigences du cahier des charges.
Polyvalence
Ces déboires inquiètent l'armée, confrontée au vieillissement
de ses appareils de transport, anticipé de longue date : la
formalisation du besoin à l'origine du projet A400M remontre à 1984.
Cinquante avions ont été commandés par la France. Sans eux, selon les
sénateurs Jacques Gautier et Jean-Pierre Masseret (2), « la capacité de
projection tactique à 1 000 km en cinq jours, actuellement de l'ordre
de 5 000 tonnes (soit 1 500 militaires avec leur équipement et leur
autonomie) passerait, en 2012, à moins de 3 000 tonnes, voire 2 500
tonnes ». Il faudra supporter le coût des solutions palliatives (remise
à niveau d'avions en fin de vie, achats ou locations), et les
conséquences d'un moindre entraînement des équipages.
Enfin aux commandes de l'A400M, ceux-ci bénéficieront d'un
appareil à la polyvalence inédite : son rayon d'action, sa capacité
d'emport et sa vitesse conviendront aux missions stratégiques ;
susceptible d'opérer sur terrain meuble, à basse altitude et faible
vitesse, il répondra également aux exigences tactiques ; il pourra
aussi participer à des ravitaillements en vol. Embarquant une
technologie de pointe, il exploitera le « plus puissant turbopropulseur
développé en Occident », selon l'expression de Noël Forgeard. L'avion
cumule les ruptures technologiques. Pourtant, Airbus Military s'était
engagé à le développer « à un prix très bas,
dans des délais très courts, et sans programme d'évaluation
des risques ». L'industriel a sous-estimé l'ampleur du défi ; aux yeux
des parlementaires, sa première erreur fut « de penser qu'un avion de
transport militaire tactique équivalait à un avion de transport civil
"peint en vert", bref qu'il s'agissait de construire un Airbus comme
les autres et que les compétences acquises en matière de certification
civile seraient un atout substantiel », voire suffisant.
Une gouvernance inefficace
EADS a pâtit, en outre, d'une mauvaise organisation de ses
filiales, conduisant à « une mobilisation insuffisante des forces vives
d'Airbus ». En effet, « AMSL était placée dans une situation intenable
vis-à-vis d'Airbus : en tant que filiale, elle devait exécuter ses
ordres ; en tant que responsable industriel du programme, elle devait pouvoir
mobiliser les unités de production de la société mère. » Cela dit,
Louis Gallois nuance l'échec de son groupe, d'autant que les retards
sont monnaie courante dans l'industrie d'armement : « On ne connaît pas
de programme de ce type livré en moins de douze ans. [...] Si nous
livrions l'avion dans une amplitude de dix ans, nous serions encore la
référence dans ce domaine. » (3)
Divergences
Réunis dans l'Organisation conjointe de coopération en
matière d'armement (Occar), les États impliqués ont entrepris une
collaboration délicate, sinon hasardeuse. Ils avaient opté pour une
approche commerciale, consistant, selon l'explication des sénateurs, «
à délivrer, au terme d'une phase unique pour le développement et la
production, un nombre fixe d'avions – 180 – à un prix indexé, mais
ferme : 20 milliards d'euros aux conditions économiques initiales ».
Mais les priorités divergeaient : le Royaume-Uni voulait acquérir des
appareils au plus vite ; l'Allemagne surveillait le budget avec un
calendrier élastique ; l'Espagne espérait surtout développer son
industrie aéronautique ; quant à la France, elle souhaitait répondre à
un besoin opérationnel, mais aussi « faire avancer l'Europe de la
défense ». Au total, estiment les parlementaires, ces stratégies
différentes « ont conduit à prolonger les négociations plus que de
mesure », ainsi qu'à imposer des conditions contractuelles
difficiles... En l'absence d'un État pilote, « le dialogue
indispensable entre l'industriel et le donneur d'ordres a fait défaut
», poursuivent-ils. « En outre, le principe du juste retour a été
appliqué strictement, aussi bien pour le moteur que pour l'avion. » «
Enfin, la faible capacité de l'Occar à prendre des décisions [...], le
manque de dialogue entre EADS et les sous-traitants, ainsi que les
problèmes d'organisation du consortium des motoristes ont conduit à
retarder l'identification des problèmes et donc leur résolution. »
Une exception, l'A400M ? « Bien au contraire », proclame
Jean-Dominique Merchet dans son dernier livre (4). L'animateur du blog
Secret Défense, collaborateur de Libération et conférencier occasionnel
de la NAR, rapporte que « l'autre programme phare de la coopération
européenne, l'hélicoptère NH90, souffre des mêmes maux ». L'industrie
d'armement serait « victime de l'idée que plus on embarque de
partenaires [...], mieux c'est » ; idée dont le seul mérite serait
d'être européenne.
Réussite en solo
À l'opposé, l'auteur souligne la réussite du Rafale : « Très
critiqué, le choix de jouer en franco-français apparaît aujourd'hui
comme le plus rationnel, tant sur le plan des finances publiques que
sur celui des besoins militaires. » Et de citer la Suède en exemple,
qui produit des avions militaires et réussit même à en
exporter : « Ce que la petite Suède sait faire, et plutôt
bien, il n'y avait aucune raison que la France – six fois plus grande –
ne puisse le réussir, n'en déplaise aux idéologues qui estiment, une
fois pour toutes, que la France est trop petite. »
Fustigeant la Politique européenne de sécurité et de défense
(PESD), Jean-Dominique Merchet juge lamentables les multiples
déclarations d'intention jamais suivies d'effet. On attribue
certes quelques réalisations concrètes à la PESD, mais dont la
dimension "européenne" serait souvent usurpée, comme en Bosnie : « En
décembre 2004, l'opération militaire Althéa prend la suite de l'Otan.
Pour plus d'efficacité, l'UE le fait néanmoins avec les moyens et
capacités de commandement de l'Otan, dans le cadre des accords dits de
"Berlin Plus". » Première mission navale entreprise sous l'égide de
l'Union, l'opération Atalanta lutte avec succès contre la piraterie au
large de la Somalie. Mais « "on ne déploie pas de bateaux exprès pour
cette mission", explique-t-on à l'état-major de la Marine rue Royale.
"On a deux bateaux qui auraient été là-bas de toute façon dans le cadre
de notre présence dans l'océan Indien." »
L'UE et les tâches ménagères
Autant d'exemples illustrant « la grande illusion de la
défense européenne ». Avec un mépris teinté d'humour, Jean-Dominique
Merchet observe que l'Europe « est conçue pour les temps ordinaires »,
ce qui s'avère à certains égards « bel et bon » : « Comme le disait
l'inoubliable Paul Volfoni des Tontons flingueurs, "les tâches
ménagères ne sont pas sans noblesse". » Mais là où il est question « de
vie et de mort », on entre dans une cour où « l'Europe ne joue pas et
n'est pas prête de le faire ».
Ce petit livre, clair et concis, est un vrai réquisitoire.
Pour l'étayer, l'auteur convoque Carl Schmitt et Joseph de Maistre. Ses
arguments suffiraient-ils à prononcer la condamnation de l'UE ? Pas
forcément, car la PESD apparaît bien marginale au sein de l'Union, dont
l'ossature demeure le marché unique. Et si la défense témoigne des
méfaits de l'idéologie européiste, celle-ci n'est pas le seul moteur de
la construction européenne, où interviennent également des calculs
d'intérêts. Cela dit, Jean-Dominique Merchet confesse volontiers un
euroscepticisme plus prononcé que celui d'un Védrine, par exemple.
Quant au souverainisme, « c'est un mot qui ne me fait pas peur » nous
a-t-il confié, tout en se définissant plutôt comme un « gaulliste du 18
juin ».
(1) Les États engagés dans le programme A400M sont les
suivants : Allemagne (60 avions), France (50), Espagne (27),
Grande-Bretagne (25), Turquie (10), Belgique (7) et Luxembourg (1).
L'Afrique du Sud a commandé huit appareils et la Malaisie quatre.
(2) Jacques Gautier & Jean-Pierre Masseret : Rapport
d'information sur les conditions financières et industrielles de mise
en œuvre du programme A400M. Annexe au procès-verbal de la
séance du 10 février 2009, 97 pages, disponible en téléchargement
gratuit sur le site Internet du Sénat.
(3) Cité par Nicolas Gros-Verheyde : « Louis Gallois
s'explique ». Europolitique, n° 3722, 26 mars
2009. Cf http://bruxelles2.over-blog.com/
(4) Jean-Dominique Merchet : Défense européenne, la
grande illusion. Larousse, coll. "À dire vrai", 126 pages,
9,90 euros. Deux extraits sont en ligne sur le blog de l'auteur :
http://secretdefense.blogs.liberation.fr/
Publié dans Défense, Économie et Industrie, Europe, France, Livres | 2 Commentaires
18 juin 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Lecture d'un "album secret" signé Jean-Claude Martinez.
Député au Parlement européen de 1989 à 2009, Jean-Claude
Martinez se propose de révéler les secrets de cette institution.
S'appuyant sur les illustrations de Norma Caballero, il convie le
lecteur à la rencontre de six mille habitants, évoluant sur cinquante
hectares répartis dans trois villes : Strasbourg, le siège officiel du
Parlement, où les couloirs seraient un vrai cauchemar ; Bruxelles, qui
supplante peu à peu la capitale alsacienne ; Luxembourg, qui héberge
l'administration. En Belgique, étant donné l'étendue des surfaces à
couvrir, les rondes des agents de sécurité prennent entre six et huit
heures.
On découvre des lieux parfois insolites : la banque ING,
classée centième sur les 4 800 agences que compte le groupe dans le
Plat pays ; un bar dévalisé le soir du 13 juillet 2004, où le Parlement
accueillait les représentants de dix nouveaux États-membres ; une salle
de prières à Strasbourg ; un centre d'épilation à Bruxelles...
L'hémicycle constitue « une PME de cent personnes ». Les votes y sont
expéditifs : les députés disposent de quelques secondes pour presser la
bonne touche de leur machine électronique. Et quand ils prennent la
parole, c'est pour une ou deux minutes, trois tout au plus. Alors
s'affairent les interprètes, censés jongler avec 506 combinaisons
linguistiques possibles !
Soulignant « l'impérialisme de l'anglais », Jean-Claude
Matrinez rapporte cette mésaventure de Jacques Barrot : « Un député
voulait la lecture officielle de la position de la Commission
européenne. Mais ce texte officiel était en anglais. Le commissaire
français un peu juste dans cette langue ne se voyait pas en train de
lire un long texte en anglais. Il a donc fait le sourd en dépit de la
demande répétée de plusieurs députés et de la cruauté complice du
président, ajoutant goguenard : "Le commissaire ne souhaite pas lire." »
Précarité sociale du personnel
Le Parlement européen apparaît sous un jour plus humain qu'à
l'accoutumée. Ce qui n'est pas toujours flatteur. L'auteur s'indigne
des conditions de travail imposées au personnel de la restauration ;
employé par un prestataire externe, il est même privé de badge et de
parking, ceux-ci étant apparemment réservés aux fonctionnaires.
Conséquence des "privatisations", cette précarité illustre les méfaits
du libéralisme économique aux yeux de Jean-Claude Martinez, qui a
incarné une sensibilité "altermondialiste" au sein du Front national.
Issu d'une formation politique marginalisée, il dénonce les
privilèges des groupes majoritaires, ainsi qu'une procédure douteuse
qui l'aurait privé d'une vice-présidence du Parlement Europe-Amérique
latine (Eurolat). Le ton partisan de l'ouvrage procède d'un choix
discutable : des commentaires superflus agaceront peut-être les
sympathisants, et rebuteront sans aucun doute tous les autres.
Jean-Claude Martinez s'autorise même des piques répétées contre « la
fille Le Pen ». On regrette également les insuffisances de la mise en
page, ainsi que la rédaction hasardeuse du texte, où les redondances
sont légion. Si elle permet de glaner ici ou là des informations
précieuses, la lecture s'avère de ce fait décevante, voire frustrante.
Un essai à transformer !
Jean-Claude Martinez, Norma Caballero : L'Album
secret du Parlement européen. Édité par La Maison de la Vie
et des Libertés, 13 rue Durand, 34000 Montpellier ; 200 pages,
59,50 euros franco (chèque à l'ordre de La Maison de la Vie) ;
www.martinezlavie.com
Publié dans Europe, Livres | Pas de commentaires
2 avril 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Retour sur l'histoire du négationnisme en France.

Le négationnisme s'est immiscé dans l'actualité ces derniers
mois. Nos lecteurs intéressés par cette "école" pseudo-historique
pourront consulter l'étude que Valérie Igounet a consacrée à ses
représentants français (1). L'auteur considère Maurice Bardèche comme l'«
initiateur » de la contestation des crimes nazis. Ouvertement fasciste,
le beau-frère de Robert Brasillach devint l'éditeur d'un transfuge de
la gauche pacifiste, député SFIO puis militant actif de la Fédération
anarchiste : Paul Rassinier. Revenu de déportation à Buchenwald et
Dora, celui-ci entreprit de relativiser la responsabilité des SS dans
les camps, incriminant plutôt les communistes. Ces "précurseurs"
ouvrirent la voie à Robert Faurisson, un professeur de lettres amoureux
de la vérité selon ses dires, sans aucun doute avide de provocation.
Signe des insuffisances de la recherche historique, il fut,
dans les années soixante-dix, l'« un des premiers Français à fouiller
dans les archives d'Auschwitz, à comparer des documents et à mettre en
évidence des contradictions entre [...] les plans et [...] le terrain
». Se rendant sur place, un pharmacien qui préparait un roman observa
moult incohérences, au point de douter à son tour de l'existence des
chambres à gaz homicides. Aussi Jean-Claude Pressac travailla-t-il aux
côtés de Robert Faurisson pendant quelque temps. La rupture fut
consommée après qu'il eut décelé les « traces d'aménagement criminelles
» d'un camp qui, en réalité, n'avait pas été conçu dès l'origine à des
fins d'extermination. Une découverte fondamentale. Non sans hésitation,
Pierre Vidal-Naquet introduisit cet "amateur" dans les milieux
universitaires. Ses conclusions, publiées aux États-Unis en 1989 sous
le titre Auschwitz - Technique and operation of the gas chambers,
devinrent « une des références bibliographiques dans l'histoire du
génocide ». Dans un entretien accordé au Spiegel du 9 février dernier,
Mgr Williamson s'est engagé à étudier l'ouvrage de ce "négationniste
repenti". Celui-ci n'en reste pas moins une personnalité controversée,
étant donné son choix de ne considérer que les « données et documents
techniques » ; d'autant qu'il révise à la baisse le nombre de victimes.
Valérie Igounet rend compte de la pénétration du négationnisme
dans l'idéologie et le discours du Front national, ainsi que des
collusions de l'extrême droite avec des courants pro-arabes, voire
islamistes. Les sympathies que s'attire aujourd'hui Dieudonné sont à ce
titre significatives. L'auteur souligne également le soutien décisif
apporté au négationnisme par un microcosme d'extrême gauche mené par
Pierre Guillaume, animateur de La Vieille Taupe, une librairie
"révolutionnaire". Influencé par Amadeo Bordiga, il a vu dans les
horreurs du nazisme « un alibi, utile au capitalisme, pour justifier
son exploitation de la classe prolétarienne ».
Fallait-il condamner lourdement les adeptes de cette «
métamorphose moderne de l'antisémitisme » ? « Ceux qui sont contre
[...] ne vivent pas au milieu des survivants et n'entendent pas leurs
cris », déplora Serge Klarsfeld, qui défendait la loi Gayssot en 1990 :
« Les poursuites s'imposent dans la période actuelle. Après, une fois
que tous les témoins seront morts, ce ne sera plus nécessaire. » Selon
Pierre Vidal-Naquet, en revanche, « il n'appartient pas aux tribunaux
de définir la vérité historique » : « Faire de la vérité sur la Shoah
une vérité légale [...] paraît une absurdité. Le fait de punir
l'expression du révisionnisme ne fera que transformer ces gens-là en
martyrs. » Un point de vue partagé par Valérie Igounet, qui s'est
exprimée à ce sujet le 26 janvier 2004 sur un forum en ligne du Nouvel
Observateur. Fort heureusement, le discours des historiens ne se réduit
pas à l'écho qu'en renvoie la sphère politico-médiatique. Ne l'oublions
pas.
(1) Valérie Igounet : Histoire du négationnisme en
France. Éd. du Seuil, mars 2000, 692 p., 28 euros.
Publié dans Conspirationnisme, Histoire, Livres | Pas de commentaires
20 novembre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Europe présentée à travers 236 notes synthétiques.
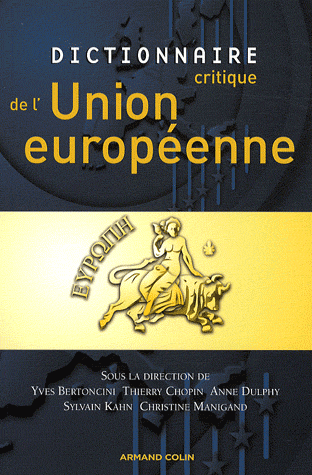
Les éditions Armand Colin ont publié le mois dernier un Dictionnaire
critique de l'Union européenne dont la lecture distille
mises au point historiques (voire historiographiques), juridiques
(arrêts déterminants de la Cour de Justice), politiques (présentation
des mouvements "pro-européens") ou théoriques (analyse fonctionnaliste
ou intergouvernementaliste de l'intégration européenne), ainsi que
quelques chiffres significatifs : par exemple, selon l'estimation
d'Yves Bertoncini, le droit communautaire dérivé représenterait 10 à 20 % de l'ensemble du droit en vigueur en France.
Au fil des 493 pages, écrites selon "l'esprit du temps", on
pourra discuter certains jugements, mais le caractère "universitaire"
de l'ouvrage le préserve des inepties politiciennes les plus désolantes
; l'article consacré au souverainisme, présenté par Justine Lacroix
comme « une identification de la nation à la démocratie » - plus
généralement au politique, diraient les souverainistes d'AF - témoigne
d'une relative impartialité.
Inévitablement, on sera frustré par les questions laissées
apparemment en suspens, comme le bilan économique du marché commun ou
les enjeux géopolitiques de la candidature d'Ankara... Ces 236 notes
synthétiques, complétées par des cartes et une chronologie, apportent
néanmoins un éclairage appréciable sur différentes facettes de l'UE,
faisant de ce dictionnaire un compagnon utile – quoique un peu coûteux
(39,50 euros) - au profane décidé à se documenter peu à peu sur le
"machin" européen.
Publié dans Europe, Livres | Pas de commentaires
2 octobre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
De Daniel Cohn-Bendit à Hubert Védrine, vingt et une personnalités s'expriment sur la construction européenne.
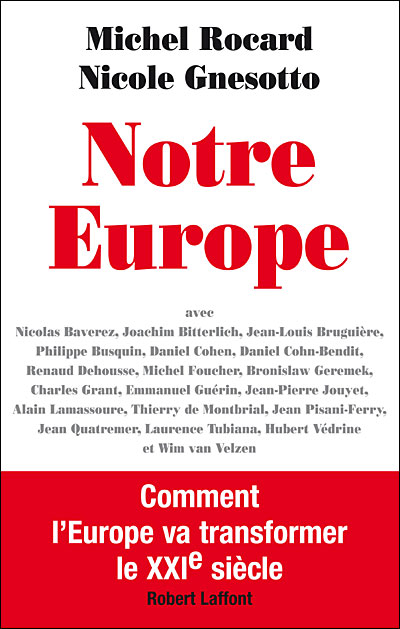
Un ouvrage paru en septembre, dirigé par Michel Rocard et
Nicole Gnesotto, rassemble les contributions de personnalités
éclectiques censées « rendre à Bruxelles ce qui revient à Bruxelles »
et « appréhender la construction européenne [...] comme une réalité
vivante ».
"Réalisme"
On y relève moult banalités. Ainsi Michel Rocard affirme-t-il
que « l'édification d'une institution commune [...] a comme résultat
majeur la réconciliation et la paix ». Une ineptie à laquelle Hubert
Védrine apporte un démenti cinglant : « Ce n'est pas
l'intégration de l'Europe de l'Ouest qui va l'empêcher [la guerre],
mais l'équilibre des forces [...] de l'OTAN et du Pacte de Varsovie...
»
Fidèle à son "réalisme", constatant la difficulté de conclure
un accord à vingt-sept, l'ancien ministre des Affaires étrangères
estime qu'on arrive « au point ultime de l'intégration politique pour
l'Europe dans son ensemble ». Il ne cache pas son relatif
euroscepticisme : s'appuyant sur des textes juridiques, « certains ont
attendu la naissance presque miraculeuse d'une politique étrangère
européenne. [...] Mais on le voit bien : cela ne conduira pas à une
politique étrangère européenne unique... » Appelant les Européens à «
dépasser l'irrealpolitik », caractérisée par « une fatigue historique
[...], une aspiration helvétique à une grande Suisse à l'abri des
turbulences de la mondialisation » - y compris chez certains
nationalistes, serions-nous tentés d'ajouter ! -, il plaide pour
l'autonomisation progressive des Européens au sein d'un pôle
occidental. Il se démarque ainsi de l'"esbroufe gaulliste" stigmatisée
implicitement par Thierry de Montbrial, et se montre bienveillant à
l'égard du président de la République, dont la politique pourrait être,
selon lui, le levier de cette transformation. Affaire à suivre.
Ultimes frontières
Dans l'immédiat, Michel Foucher lève le voile sur un « secret
de polichinelle », celui des frontières ultimes de l'UE : « Dans le
scénario d'expansion au fil de l'eau que Washington nourrit, celui qui
a effectivement cours, l'Union devra s'étendre à l'ensemble des États
membres du Conseil de l'Europe, à la seule exception de la Russie, mais
la Turquie incluse. » Dans ces conditions, sans identité
forte, quid de l'Europe politique ? Loin d'en entretenir l'illusion, la
plupart des auteurs parient plutôt sur la puissance de l'"empire
normatif". Renaud Dehousse en révèle une vision plus "morale" que
politique : il salue cette Europe ayant « dépassé le stade primitif où
les rapports entre États sont avant tout des rapports de force ».
Quitte à s'intéresser aux critiques de la realpolitik,
on préférera les analyses de Zaki Laïdi, beaucoup plus fouillées.
Jean Quatremer prétend briser un mythe, celui des 60 % de lois
d'émanation communautaire. « Le raisonnement en termes de pourcentage
est délicat, observe-t-il : le droit ne se prête guère à ce genre de
pesée. » Se livrant à son propre calcul, il estime néanmoins que ce
sont « seulement 25 % des lois adoptées en 2007 qui étaient d'origine
européenne ». De son point de vue, « tout ne se décide pas à Bruxelles,
[...] loin s'en faut ». Le sujet – controversé – aurait mérité de plus
amples développements. Le journaliste se veut catégorique : « Les États
sont non seulement à l'origine des traités par lesquels ils décident
d'exercer en commun leur souveraineté, mais ils en contrôlent à chaque
instant l'application. Ils sont aux deux bouts de la chaîne et décident
donc toujours en dernier ressort. » C'est oublier l'influence de la
Cour de Luxembourg, dont Renaud Dehousse rappelle que les juges « loin
de s'en tenir à l'intention [...] des parties contractantes [...], se
sont abondamment inspirés des objectifs ultimes de l'intégration,
énoncés de façon générale dans le préambule du traité de Rome ».
Le pragmatisme de Jean-Louis Bruguière tranche avec
l'idéologie inspirant bien des contributions. Tout en promouvant le
mandat d'arrêt européen, il s'insurge contre certaines dérives : « Une
coopération bien gérée est un facteur d'efficacité. Mais vouloir aller
trop vite ou négliger, dans une démarche politique ou doctrinaire, des
réalités opérationnelles peut avoir l'effet inverse de celui recherché.
C'est ce qui se passe [...] avec les tentatives d'intégration du
renseignement. Celui-ci ne se partage que dans une situation donnée et
dans une démarche bilatérale... »
Basses attaques
Daniel Cohn-Bendit se distingue par une intervention rédigée
sur un ton plus "politicien", où il attaque notamment le souverainisme
: une « nécrose », dont les « poussées xénophobes » ne seraient pas «
les moindres dégâts » ; par-delà la basse polémique, on relève cette
observation de bon sens : « La souveraineté demeure une
coquille vide sans l'efficience de l'action politique. »
Au final, on s'interroge sur le public auquel s'adresse un tel
ouvrage. Parfois rébarbatif et redondant, il ne présente pas de "vertus
pédagogiques" manifestes, véhicule des lieux communs sans franchement
ouvrir le débat, et présente des analyses trop superficielles pour
satisfaire un lecteur averti. On y trouvera éventuellement
une introduction à d'autres études traitant plus spécifiquement de tel
ou tel aspect de la construction européenne, à lire avec un regard
critique.
Sous la direction de Michel Rocard et Nicole Gnesotto : Notre
Europe ; Robert Laffont, 394 p., 22 euros.
Publié dans Europe, Livres | Pas de commentaires
4 septembre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
Aperçu d'un ouvrage traitant des négociations européennes d'Henri IV à l'Europe des Vingt-Sept.
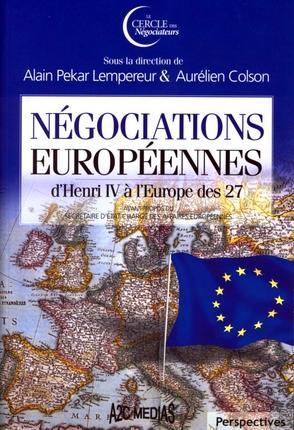
Comment les négociations internationales ont-elles été menées
en Europe depuis le XVIIe siècle ? La question a fait l'objet
d'un ouvrage collectif paru en avril dernier.
La première partie est historique. On y rencontre d'abord Jean
Hotman de Villiers, qui est, en 1603, le premier à disserter en
français sur La charge et la dignité de l'ambassadeur ; «
composé par un homme [...] dont la science et l'érudition sont
fortement imprégnées par l'esprit de la Renaissance et les références à
l'Antiquité, [ce traité] n'en est pas moins en prise directe avec son
temps », dont bien des aspects sont révolus : imaginerait-on qu'un
ambassadeur s'appauvrisse aujourd'hui au service de l'État ?
Vers 1640, le cardinal de Richelieu développe dans son
Testament politique « une conception éminemment nouvelle de la
négociation », qui devient permanente, « s'ordonnant [...] en vue de la
réalisation d'un dessein plus général, ce que l'on appellera la
politique étrangère... » En 1716, François de Callières s'intéresse à
l'éloquence dans La Manière de négocier avec les souverains ; son
existence témoigne d'« une capacité rare d'alterner vie active de
diplomate et vie contemplative du penseur ». Un article publié en 1770
dans l'encyclopédie d'Yverdon est reproduit intégralement ; Barthélémy
Fortuné de Félice y souligne le poids des passions et lance quelques
piques à l'encontre de Mazarin (dont les intrigues ne feraient pas
honneur à la diplomatie française selon lui).
En 1757, dans ses Principes des négociations, Gabriel Bonnot
de Mably conteste l'aptitude du système de l'équilibre à garantir la
paix ; il juge vicieux l'ordre européen assimilant la politique à "la
chose privée des rois", et se fait l'apôtre de la transparence. La
Révolution française s'y essaiera, transformant bientôt « la
"diplomatie de la transparence" en une "diplomatie de l'arène" » ; «
détruisant sans chercher à reconstruire, l'expérience tourne au chaos
», aboutissant selon Frank Attar à « la diplomatie du vide ».
Multilatéralisme
La seconde partie traite de l'« actualité de la négociation,
de la souveraineté française au consensus européen », esquissant
quelques comparaisons avec les siècles passés. Marie-Christine Kessler
identifie des vecteurs de stabilité : « En France [...], il y a eu très
vite une institutionnalisation et une professionnalisation du métier de
diplomate. » Mais l'influence des opinions, ainsi que l'émergence du
multilatéralisme, ont bouleversé la donne. Des contributions évoquent
la représentation permanente de la France aux Nations Unies – dont le
Conseil de Sécurité se réunit tous les jours – et l'engagement de la
Commission européenne dans des négociations internationales. Une
expérience de « multilatéralisme au carré », selon l'expression
d'Hubert Védrine, le mandat des négociateurs européens étant lui-même
issu d'une négociation entre les États membres de l'UE. Observant les
réticences des États-Unis à l'égard d'un multilétaralisme qu'ils
avaient jadis encouragé, l'ancien ministre des Affaires étrangères
conclut ainsi sa postface : « Selon qu'il s'agit [...] d'un mouvement
conjoncturel [...] ou durable, les conséquences n'en seront pas du tout
les mêmes pour l'art de la négociation. »
En définitive, l'ouvrage semble quelque peu "bricolé".
Rassemblant des contributions inégales, il constitue moins l'« histoire
vivante de la négociation » annoncée en quatrième de couverture qu'un
aperçu des œuvres des ses théoriciens classiques, complété par quelques
considérations d'actualité. On s'agace en outre de l'inclination de
certains auteurs à dénicher dans le passé les sources supposées de leur
européisme un peu naïf... C'est une étude originale dont on regrettera
qu'elle ne tienne pas toutes ses promesses.
Sous la direction d'Alain Pekar Lempereur et Aurélien Colson :
Négociations européennes - D'Henri IV à l'Europe des 27 ;
A2C Medias, avril 2008, 284 p., 25 euros.
Publié dans Europe, Histoire, Livres | Pas de commentaires
3 juillet 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelles sont les grandes lignes de la politique européenne de Nicolas Sarkozy ? Jean-Dominique Giuliani – président de la Fondation Robert Schuman – tente de les identifier dans un ouvrage publié en mai dernier, où il brosse le portrait d'« un Européen très pressé ».

L'auteur souligne l'importance – relative, certes, mais
inédite – que le candidat Sarkozy avait accordée à la construction
européenne pendant sa campagne, annonçant la négociation du traité de
Lisbonne et sa ratification par voie parlementaire. Un choix «
courageux » selon Jean-Dominique Giuliani, mais qui nous paraît
finalement peu coûteux, étant donné l'indifférence de nos concitoyens.
Ont-ils été abusés par l'esbroufe présidentielle ? En tout cas, le
numéro d'équilibriste de Nicolas Sarkozy semble avoir touché son public
: nuancés par un zeste d'euroscepticisme, ses discours ont rassuré les
nonistes, ouvrant la voie au "retour de la France en Europe" proclamé
le soir de sa victoire électorale.
Symboles
Dès son entrée en fonction, le chef de l'État multiplie les
symboles, « comme autant de gestes en direction de l'Union européenne »
: pour sa photographie officielle, par exemple, il pose devant la
bannière bleue étoilée. Jean-Dominique Giuliani revient sur la façon
parfois houleuse dont se sont nouées les relations avec Angela Merkel.
En dépit d'une main tendue au Royaume-Uni, la collaboration privilégiée
avec l'Allemagne serait « inévitable » de toute façon... Une
observation tout juste étayée par quelques considérations économiques.
Le lecteur avide d'analyses géopolitiques pointues passera son chemin.
Retour à l'Est
L'auteur signale toute l'importance que le Président accorde à
la Méditerranée, mais insiste aussi sur ses efforts visant à resserrer
les liens avec les pays de de l'Europe de l'Est, vilipendés par Jacques
Chirac à la veille de leur entrée dans l'Union. Le rapatriement des
infirmières bulgares retenues en Libye, orchestré triomphalement par
Nicolas Sarkozy, aurait largement contribué au succès de son
entreprise. Le « passage obligé » par Washington rassure également les
États fraîchement libérés du joug soviétique. L'objectif est clair : le
président de la République espère développer un pôle de sécurité
européen, et, plus généralement, conférer à l'UE le rôle d'un véritable
acteur politique.
En matière économique et monétaire, son ambition de
"repolitiser" l'Europe apparaît manifeste. Ainsi a-t-il réclamé un
assouplissement de la politique de concurrence – nécessaire à la
préservation de nos intérêts industriels –, ou une réaction face à la
menace des fonds souverains. Ses homologues sont disposés à le suivre
sur ce point. En revanche, ils ne sauraient cautionner ses critiques
formulées à l'encontre de la Banque centrale européenne, qui se sont
certes assagies depuis son élection. Une fois n'est pas coutume,
Jean-Dominique Giuliani exprime ici quelque réserve, rappelant cette
évidence, vraisemblablement négligée par un politicien en campagne : «
La revendication d'un "gouvernement économique" n'a [...] de chance
d'aboutir que le jour où certains pays accepteront de se concerter
avant de prendre leurs grandes décisions économiques internes. » En
attendant, aucune alternative à l'indépendance de la BCE n'est
envisageable, à moins d'abandonner la monnaie unique évidemment.
Identité chrétienne
Telle que nous la dépeint Giuliani, l'Europe rêvée par Nicolas
Sarkozy bénéficierait d'une forte identité, inspirant la fierté de
citoyens conscients d'appartenir à une communauté de civilisation. « Il
replace le projet européen dans une perspective historique, morale et
politique, dont l'ont éloigné le temps, la bureaucratie et les
habitudes. Pour lui, l'Europe doit désormais avoir pour objectif d'être
une puissance nouvelle sur la scène internationale. À ce titre, elle a
droit à un territoire.. » Le chef de l'État veut en finir avec la fuite
en avant de l'élargissement, qui s'oppose au projet
d'approfondissement. De son point de vue, l'adhésion de la Turquie
serait une perspective d'autant moins acceptable qu'elle saperait les
fondements de l'unité européenne, brouillant les repères tant
géographiques que culturels. À l'inverse, la reconnaissance officielle
des racines chrétiennes de l'Europe lui semblerait indispensable ; leur
négation constituerait à ses yeux « une insulte à l'histoire » et même
une « faute politique ».
Un vieux fantasme
Un faute, sans doute, mais qui apparaîtrait bien minime
comparée à celle qu'il commettrait si, d'aventure, il privait la France
de son siège de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Fort heureusement, Jean-Dominique Giuliani ne lui prête pas
cette intention. Bien au contraire, il s'interroge sur son inclination
à « abandonner sa capacité à décider seul au profit d'institutions
européennes » supposées plus efficaces ; « s'il y a des contradictions
dans les discours européens de Nicolas Sarkozy, c'est ici qu'il faut
les chercher », précise-t-il. Cédant à un vieux fantasme européiste, il
l'appelle pourtant à « partager » son siège avec l'UE, au moins
provisoirement, pendant que la France assure la présidence de l'Union.
On s'agace pareillement de son aversion naïve pour la Realpolitik,
et de sa posture "bien pensante" qui le conduit à ériger en vérités
universelles des opinions ou des valeurs – telle la "parité" – qui sont
loin d'emporter notre adhésion. On lui reprochera enfin de se complaire
dans une relative apologie, son ouvrage s'approchant d'avantage de la
paraphrase que de l'analyse approfondie.
Jean-Dominique Giuliani : Un Européen très pressé.
Éditions du Moment, 22 mai 2008, 277 p., 19,95 euros.
Publié dans Europe, France, Livres | Pas de commentaires
19 avril 2007
Article publié dans L'Action Française 2000
Un frère dominicain veut réconcilier foi et raison.
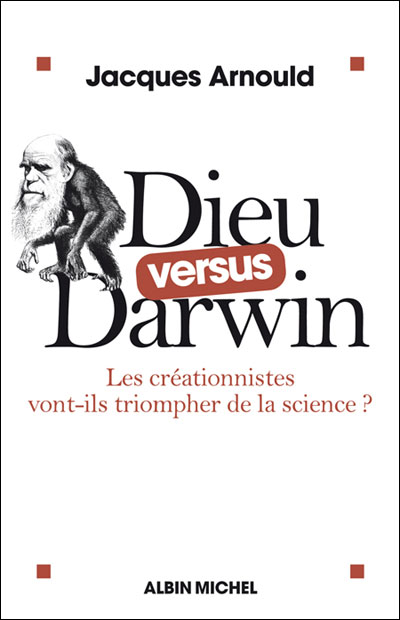
Le créationnisme est en vedette dans les librairies. Selon les
cas, l'ouvrage que lui a consacré Jacques Arnould (1) – un
frère dominicain – est classé en science ou en religion. Cette
ambiguïté est à l'image d'un objet d'étude dont M. Glauzy affirme qu'il
est une « science biblique ».
Les créationnistes « refusent la vision
évolutionniste [...] selon laquelle les espèces vivantes et, plus
largement, l'ensemble de la réalité seraient le résultat du lent
travail des forces naturelles » ; pour eux,
« au contraire, Dieu en est le seul auteur, d'une manière
directe et indépendante des lois de la nature ».
Parmi les créationnistes stricts, certains observent un rejet
catégorique du discours scientifique, mais d'autres ne le condamnent
pas dans tous les cas. Ces derniers se divisent en deux écoles, selon
leur appréciation de l'âge de la Terre : les young-earth
creationists « pratiquent une lecture littérale des
onze premiers chapitres du livre de la Genèse », tandis que l'old-earth
creationism s'accommode de quelques exégèses. Moins
radicaux, les partisans du créationnisme progressif
« acceptent l'existence de différences, voire
d'incohérences, entre le texte de la Bible et les données de la
science », tout en prétendant que « l'évolution ne
permet pas d'expliquer les événements de l'histoire de la vie ».
Considéré parfois comme un néocréationnisme, le courant du dessein
intelligent s'appuie sur l'« irréductible
complexité » du vivant pour récuser la responsabilité du
hasard dans sa constitution.
Un lobby influent
La majorité des scientifiques se montrent sévères à l'égard du
mouvement créationniste. Citons par exemple Jean Chaline, directeur de
recherche émérite au CNRS (2) – qui condamne parallèlement le
néoscientisme : « Pour les créationnistes, la méthode
consiste à découvrir les failles scientifiques potentielles dans les
hypothèses, de façon à les couvrir de ridicule, ou à montrer leurs
incertitudes. Ils recourent sans état d'âme à la falsification, à la
manipulation des données scientifiques et de certains principes de la
physique... » Passant en revue quelques sujets de controverse,
il s'indigne notamment de cette réponse faite aux évolutionnistes,
selon laquelle « Dieu pourrait avoir donné une apparence de
vieillesse à l'univers qui tromperait les astronomes ». Une
hypothèse évidemment irréfutable, qui transgresse en cela les principes
élémentaires de la science.
En France, bien qu'elles comptent quelques défenseurs, ces
thèses se heurtent à une société fortement laïcisée, ainsi qu'à la
prédominance historique de l'Église catholique. La situation est tout
autre aux États-Unis, où le créationnisme est né dans des milieux
presbytériens et évangélistes pendant la seconde moitié du
XIXe siècle. Jacques Arnould rend compte de son immixtion dans
les programmes scolaires et des batailles judiciaires qui l'ont
accompagnée. Outre-Atlantique, le créationnisme s'attire les sympathies
des plus hautes personnalités politiques, tel le président Bush qui
déclara en août 2005 : « Ces deux théories
[l'évolution et l'intelligent design] doivent être
correctement enseignées de manière que les gens saisissent la nature du
débat. »
Est-il légitime de traiter les deux approches sur un pied
d'égalité ? « Le concept de théorie prend en compte
les faits, les hypothèses et les lois pour tenter d'expliquer la
réalité », rappelle Jacques Arnould ; par conséquent,
« une théorie ne peut pas être testée en dehors de la
science ». Or, celle-ci est « athée a priori
et par
méthode ». Bien que croyant, l'auteur ne s'en offusque pas,
car il a conscience « qu'il ne faut pas confondre origine
ultime et origine immédiate », Cause première et causes
secondaires.
« L'œuvre du démon »
Il entend cantonner la science à son domaine. Et aussi sa
foi : « Je dois rassurer ceux qui se demandent si je
crois [...] en Darwin. Je réserve la croyance à la religion, aux
relations humaines, voire à l'intelligence, mais pas à la
science. » Jacques Arnould constate que « les
théories héritées de Darwin sont celles sur lesquelles une majorité de
biologistes se fondent pour travailler » ; comme
nous, il reconnaît n'avoir « ni la compétence ni l'autorité
pour les critiquer ».
S'il ne leur accorde aucune caution scientifique, le frère
Arnould ne traite pas les créationnistes avec mépris :
« Il existe sans aucun doute de la bonne foi [...] de part et
d'autre. » On perçoit le désarroi que lui inspire une foi
fondée sur une lecture littérale de la Bible... Sans doute a-t-il à
l'esprit l'enseignement de Saint Paul : « La lettre
tue et l'esprit vivifie. »
Bien des auteurs abordant le sujet auraient versé dans
l'anticléricalisme. On tremble à la lecture d'un sermon prononcé jadis
dans le Tennessee par un prédicateur assimilant la découverte des
dinosaures à « l'œuvre du démon ». Jacques Arnould
tient son propos à l'écart des polémiques, mais nous observerons que
les dépositaires de cet héritage fanatique, trop prompts à tout
analyser à travers le prisme de la christianophobie, dénoncent
volontiers l'évolution comme un « montage » contre
la foi, au mépris des travaux scientifiques. L'auteur reste conscient,
néanmoins, que ces théories « ne sont pas exemptes
d'idéologies a priori, ni d'ailleurs de
récupérations a posteriori ». Par sa
mesure, il redore un peu
l'image de la religion, dévalorisée par des "champions" déniant la
rationalité.
Il apporte sa pierre au débat entre foi et raison. De son
point de vue, « s'il convient de ne pas confondre ces deux
sphères, il ne faudrait pas non plus les maintenir totalement
séparées ». Ainsi souligne-t-il que « la quête
obstinée du commencement et de l'origine se trouve au fondement même de
notre conscience d'être humain ».
Dans une société laïcisée, largement dominée par la
technologie, les croyants pourront difficilement esquiver ce débat, à
moins de se replier dans leurs communautés. Quant aux politiques,
peut-être y seront-ils bientôt régulièrement confrontés ? On
se souvient qu'en début d'année, un "atlas de la création" avait été
massivement envoyé dans les établissements de l'Éducation nationale
afin de réfuter l'évolution au nom du Coran. En réaction, le ministère
avait diffusé un « message de vigilance » auprès des
recteurs.
(1) Jacques Arnould : Dieu versus Darwin ;
Albin Michel, 317 p., janvier 2007, 20 euros.
(2) Jean Chaline : Quoi de neuf
depuis Darwin ? Ellipses, 479 p., novembre 2006,
26,50 euros.
Publié dans Livres, Obscurantisme | Pas de commentaires
17 novembre 2005
Article publié dans L'Action Française 2000
Critique de la reconnaissance institutionnelle de
l'homosexualité.

Depuis la parodie de mariage orchestrée par Noël Mamère, les
partisans de la "cause homosexuelle" semblent peut-être moins
pressants, mais leur résolution n'a pas faibli. Le retour de leurs
revendications sur le devant de la scène politique sera-t-il l'occasion
d'un débat plus réfléchi ? Le dernier ouvrage du prêtre et
psychanalyste Tony Anatrella, Le Règne de Narcisse,
devrait nous aider à en cerner les enjeux.
Dans une première partie, l'auteur se propose de définir
l'homosexualité. Il y voit la conséquence d'un manque d'intériorisation
de la différence des sexes, le résultat d'une identification au même
que soi. Cette « fixation narcissique » donnerait
parfois des personnalités très imbues d'elles-mêmes ; à
l'opposé, elle pourrait aussi encourager les individus à se
dévaloriser. Dans tous les cas, elle ne serait pas une option
équivalente à l'hétérosexualité, mais un échec dans le processus normal
du développement psychique de l'individu.
Principe de précaution
Représente-t-elle une image de la sexualité à partir de
laquelle la société doit s'organiser ? Dans une seconde
partie, Tony Anatrella expose les motifs de son opposition à la
reconnaissance institutionnelle de l'homosexualité. Il décrypte la
"théorie du gender", selon laquelle la masculinité et la féminité
seraient déterminées par la culture. Ses implications sont
profondes : le déni de la différence sexuelle pourrait
notamment amener la société à dissocier la procréation de la sexualité,
brouillant ainsi les repères de la filiation.
L'auteur s'inquiète des conséquences de ce bouleversement
symbolique. Selon lui, l'amour ne suffit pas à combler les besoins de
l'enfant, qui risque d'être perturbé. Il en appelle donc au principe de
précaution pour justifier son refus d'ouvrir le mariage et l'adoption
aux « duos homosexuels ».
Imposture
Reste à convaincre nos compatriotes... La troisième partie est
consacrée à la dénonciation d'un concept désormais consacré par la loi,
l'"homophobie". Ce n'est qu'une « imposture » pour
Tony Anatrella. Sa fonction ne serait pas seulement de discréditer
l'opposition aux revendications homosexuelles, par analogie avec le
racisme. Ce concept pourrait également contribuer à occulter certains
phénomènes.
La détresse des jeunes homosexuels, particulièrement enclins
au suicide, est connue de tous, mais quelle en est l'origine ?
La mise en accusation de la société est une explication naïve aux yeux
de l'auteur. Considérée comme « le résultat d'un complexe
psychologique », l'homosexualité suscitera un trouble
indépendamment du regard porté sur elle par la société. Quant à la
réaction des parents découvrant l'homosexualité de leur enfant, parfois
vive, elle témoigne « d'une angoisse existentielle et non pas
d'une quelconque "homophobie", comme on veut le prétendre dans un excès
d'interprétation psychologique moralisante ».
Bons sentiments
S'il est démuni de toute connaissance en psychologie, le
lecteur ne se sentira peut-être pas à son aise, et dans ce cas il
regrettera d'autant plus que l'ouvrage ne soit pas construit d'une
façon plus rigoureuse. Trop d'idées sont avancées ici alors qu'il faut
chercher l'explication ailleurs ; d'autres reviennent comme un
leitmotiv sans être suffisamment argumentées : le déni de la
différence sexuelle est peut-être dénoncé à chaque page, mais aucune
n'est consacrée à la définition de cette réalité jugée fondamentale.
On comprend néanmoins combien la question de l'homosexualité
et de sa reconnaissance institutionnelle est abordée de façon
superficielle dans les médias. Sa dimension psychologique est écartée,
les possibles conséquences sociales sont ignorées... Sous « le
règne de Narcisse », les intelligences sont dévoyées par les
bons sentiments. Ce constat est inquiétant à plus d'un titre, car il
est symptomatique d'une société où le bien commun n'a plus sa place.
Tony Anatrella, Le Règne de Narcisse – Les Enjeux
du déni de la différence sexuelle, Presses de la
Renaissance, 250 p., 18 euros.
Publié dans Livres, Société | Pas de commentaires