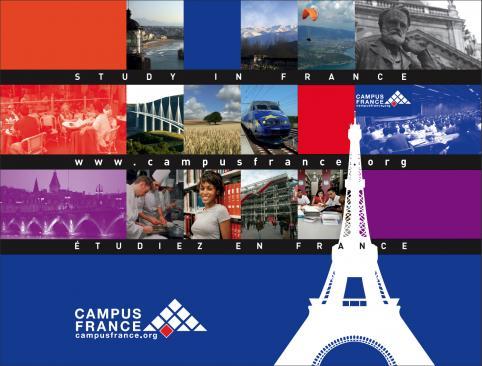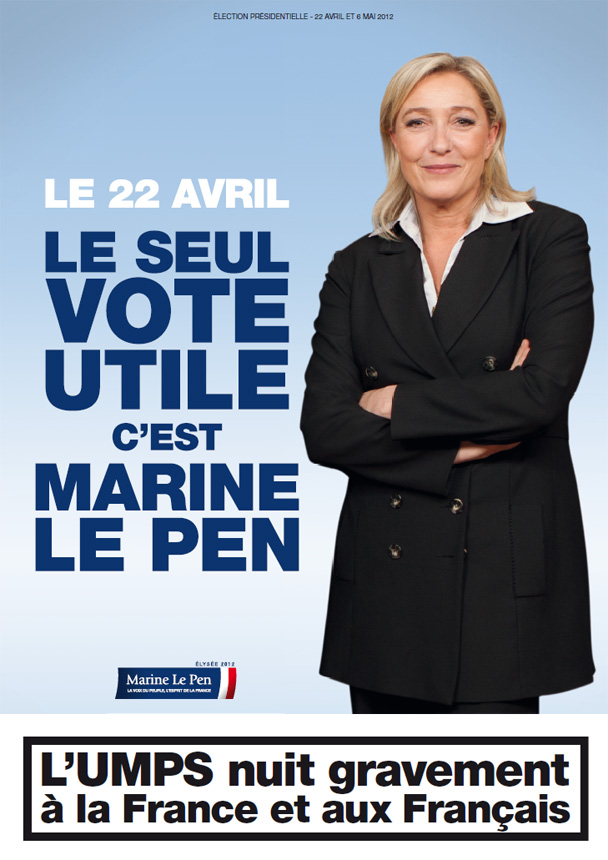21 février 2013
Article publié dans L'Action Française 2000
Moult commentateurs ont pointé l'inconséquence de l'Europe
dans le dossier malien. Peut-être sont-ils coupables d'avoir placé en
elle trop d'espoirs.

Dans l'affaire malienne, « l'Europe a été
nulle », selon les déclarations d'Alain Juppé au micro d'Europe 1.
Fidèle à son tropisme néo-gaullien, l'ancien Premier ministre continue
manifestement de projeter ses rêves de grandeur à l'échelle du
Vieux-Continent. Peut-être serait-il temps de l'admettre :
l'"Europe puissance" n'est rien d 'autre qu'un fantasme hexagonal. Au
moins Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense,
semble-t-il l'avoir compris : « Quand l'Europe de la
Défense aura la capacité d'intervenir immédiatement, ce sera dans cent
cinquante ans ! », a-t-il déclaré à La Voix
du Nord. « Le président du Mali nous a appelé à
l'aide le 10 », a-t-il précisé. « La décision
d'intervenir a été prise par le président le 11 à
12 h 30, j'y étais. Et nos forces ont commencé à
arriver à 17 heures. Que vouliez-vous faire ?
Consulter les Vingt-Sept ? [...] La vérité, c'est que nous
avons la réactivité militaire et le pouvoir de décision. » La
capacité "d'entrer en premier" est d'ailleurs une spécificité de
l'armée française, qui profite du primat accordé à l'exécutif, habilité
à placer le Parlement devant le fait accompli... Preuve que la nature
des institutions s'avère toujours décisive : « politique
d'abord », disait Maurras !
Heureuse solitude de la France
Apte à réagir dans l'urgence, la France doit toutefois
s'accommoder d'une relative solitude dans l'action. L'opposition n'a
pas manqué de s'en inquiéter, par la voix de Jean-François Copé, non
sans quelque légèreté. En effet, « pour la guerre, être seul
est parfois plus efficace », comme le souligne le
géopolitologue Olivier Kempf, animateur du blog Egea.
« C'est d'ailleurs ce qu'ont beaucoup ressenti les Américains
lors de la guerre d'Afghanistan, lorsqu'ils voyaient tout un tas
d'alliés européens se défiler dans des zones peu
dangereuses. » La France vient de le vérifier à ses dépens.
Les Pays-Bas ont certes mis un avion ravitailleur à sa disposition,
mais en en restreignant l'emploi, de telle sorte qu'il lui était
interdit d'atterrir à Bamako. Quant au C-17 britannique qui s'est posé
à Évreux, son équipage a d'abord refusé d'embarquer les rations des
soldats, au motif qu'elles comprenaient des allumettes : dans
la Royal Air Force, en effet, « on ne mélange pas munitions et
dispositif d'allumage dans le même appareil », explique notre
confrère Nicolas Gros-Verheyde. « Il a fallu quelques heures
de patience et un coup de fil entre les deux chefs d'état-major pour
régler la question », a-t-il rapporté sur le blog Bruxelles 2.
À ses yeux, cependant, « sans l'apport précieux et
coûteux des alliés, c'est bien simple, l'opération Serval n'aurait pas
duré plus de soixante-douze heures ». Selon ses estimations,
ce soutien aurait représenté 60 à 100 millions d'euros au
cours du premier mois d'intervention. « Soit tout autant que
l'engagement français annoncé par le ministre Jean-Yves Le Drian
(70 millions d'euros). » Cela étant, cette aide
n'émane pas de l'Union européenne en tant que telle. D'ailleurs, parmi
les alliés engagés derrière la France figurent le Royaume-Uni et le
Danemark, dont Olivier Kempf rappelle qu'ils sont « les plus
hostiles à tous nos baratins sur l'Europe de la Défense ».
Mission formation
L'opération Serval en sanctionnerait-elle alors
l'échec ? « Pour moi, l'Europe de la Défense, c'est
la mise en commun de certains moyens de défense, c'est l'industrie de
défense, un certain nombre d'actions communes », plaide
Jean-Yves Le Drian, qui cite en exemple l'opération Atalante,
luttant contre la piraterie dans l'océan Indien. « L'Europe de
la Défense, ce n'est pas l'Europe militaire », explique-t-il
encore. Le cas échéant, peut-être pourra-t-elle contribuer à la
reconstruction de l'État malien et plus particulièrement de ses forces
armées. D'autant qu'en la matière, l'Europe peut légitimement
revendiquer une certaine compétence, illustrée notamment par le
précédent somalien. Laborieusement, l'Union européenne prépare donc une
mission de formation à cet effet. D'ores et déjà connue sous le nom
EUTM Mali, elle sera placée sous le commandement d'un officier
français, le général Lecointre. « C'est, en fait, le logiciel
de l'armée malienne que nous voulons reconstruire », a-t-il
confié à Nicolas Gros-Verheyde. Par conséquent, a-t-il prévenu
« il faut [...] considérer les choses sur le temps long, au
moins le temps moyen, et non sur le court terme ».
Défi américain
Reste un autre défi qui se présente à l'Europe :
celui d'une moindre protection américaine. Comparant l'intervention au
Mali à celle survenue en Libye deux ans plus tôt, le politologue Zaki
Laïdi relève un élément nouveau, Washington ayant envisagé
« de faire littéralement payer à la France la location
d'avions de transport de troupes ». « C'est un fait
tout à fait inédit dans l'histoire des relations
transatlantiques », souligne-t-il sur Telos.
« Car même si en définitive cette option a été écartée, elle
révèle à la fois l'érosion du soutien américain et la détermination de
Washington à envoyer des signaux de non-assistance à Européens en
danger. » Ceux-ci sauront-ils en tirer les
conséquences ?
Publié dans Défense, Europe, International, Monde | Pas de commentaire | Lien permanent
21 février 2013
Article publié dans L'Action Française 2000
Quand les parlementaires se penchent sur l'ouverture des
universités aux étudiants étrangers ou jugent menacée la pérennité de
la langue de Molière.
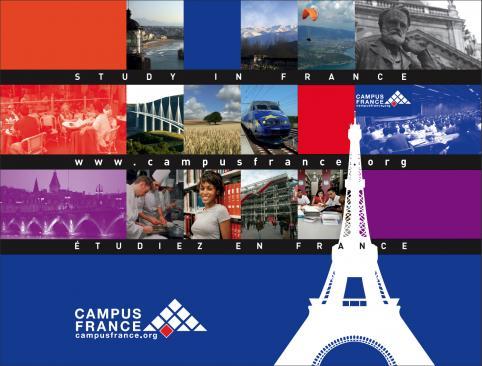
Les universités françaises manqueraient-elles d'attrait aux
yeux des étudiants étrangers ? Telle est, en tout cas, la
conviction de Mme Dominique Gillot, sénateur PS du Val-d'Oise,
auteur d'une proposition de loi censée remédier à cette situation. En
dix ans, le nombre d'étudiants étrangers recensés en France aurait
pourtant bondi de 40 %, atteignant deux cent trente-mille en
2010-2011. Cependant, « notre pays reste [...] en
retard », déplore Mme Gillot. Devancée désormais par
l'Australie, la France aurait été reléguée au quatrième rang de la
compétition mondiale qui se jouerait en la matière.
Incohérences
« Notre politique [...] a été entachée
d'incohérences », martèle le sénateur, qui pointe
« une forte hésitation entre la volonté d'accueillir les
meilleurs éléments et l'obsession du "risque migratoire" ».
Tandis que ces jeunes gens seraient appelés à devenir « nos
meilleurs ambassadeurs », il ne serait « ni dans
l'intérêt des pays d'origine, ni dans le nôtre » de les
renvoyer chez eux dès la fin de leurs études. Au contraire, plaide
Mme Gillot, « c'est après au moins une première
expérience professionnelle que ces diplômés pourront, à leur retour
chez eux ou à l'international, mettre à profit les compétences acquises
en France et en faire la promotion ».
En conséquence, elle propose que leur soient attribués des
titres de séjour pluriannuels, dont la durée dépendrait de la formation
suivie. Cela afin de « limiter les démarches administratives,
souvent vexatoires, qui épuisent et précarisent les étudiants étrangers
tout en encombrant inutilement les services préfectoraux ».
Selon Mme Gillot, il conviendrait également de porter de six à
douze mois l'autorisation provisoire de séjour, période pendant
laquelle un étranger peut chercher un premier emploi après l'obtention
de son diplôme. En outre, « pour éviter le choix souvent
cornélien [...] entre le retour dans le pays d'origine ou une
installation quasi-définitive dans notre pays », un
« droit illimité au séjour en France » pourrait
bénéficier aux titulaires d'un doctorat obtenu en France. Une mesure
censée contribuer au développement d'une « coopération
économique continue, enrichissante, sans pillage des cerveaux des pays
émergents ». Reste à convaincre nos compatriotes, aux yeux
desquels il y aurait déjà « trop d'étrangers en
France »...
Anglais ou français au choix ?
Par ailleurs, Mme Gillot propose d'introduire une
dérogation au code de l'éducation, lequel oblige à dispenser des cours
en français. Déjà « contournée par de nombreux
établissements », cette disposition constituerait
« un obstacle au recrutement d'étudiants étrangers de
qualité ». Toutefois, reconnaît le sénateur, on ne saurait
s'en affranchir sans s'exposer aux foudres du Conseil constitutionnel.
C'est pourquoi, au sein d'un même établissement, les étudiants
devraient pouvoir « suivre les mêmes cursus en français et en
langue étrangère ». Au risque qu'y soit instituée une certaine
ségrégation ?
Quoi qu'il en soit, un tel projet devrait conforter dans sa
démarche Jean-Jacques Candelier, député PC du Nord, auteur d'une
proposition de résolution « tendant à la création d'une
commission d'enquête sur les dérives linguistiques ».
« Dans la publicité, les enseignes commerciales, la
communication [...] des grandes entreprises et, désormais, dans
l'enseignement secondaire et universitaire, on peut redouter que la
langue de Molière disparaisse à brève échéance », prévient
M. Candelier. Selon lui, « il y a urgence ».
D'autant que « la dilapidation de la langue française se
couple [...] avec la sape de l'héritage progressiste universel de notre
pays, le démantèlement des acquis sociaux et des services publics, la
destruction de l'indépendance nationale, avec l'adoption du traité de
Lisbonne [...] et du traité sur la stabilité, la coordination et la
gouvernance (TSCG), le sacrifice de la défense nationale dans l'Otan,
la violation de la laïcité et la substitution de l'euro-régionalisation
du territoire à la République une, laïque et indivisible issue de la
Révolution ».
Ce discours n'est pas sans rappeler celui de l'ambassadeur
Albert Salon... « L'internationalisme des travailleurs ne
s'oppose pas au patriotisme populaire », soutient Jean-Jacques
Candelier. Au contraire, « parce qu'il n'aspire qu'au droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes » (que nous contestons
toutefois pour notre part), le « patriotisme
populaire » s'opposerait, entre autres, « au
cosmopolitisme capitaliste » ainsi qu'au
« supranationalisme impérialiste ». Pour les
pourfendeurs de la mondialisation, l'heure serait-elle à l'union
sacrée ?
Publié dans Francophonie, Mondialisation, Société | Pas de commentaire | Lien permanent
7 février 2013
Article publié dans L'Action Française 2000
Tandis qu'il esquisse des « orientations stratégiques
pour les recherches sur le genre », le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche cultive la confusion,
confondant quête du savoir et prosélytisme éhonté.

Les "études de genre" ont acquis une notoriété inédite à la
faveur de leur immixtion, sinon dans la lettre des programmes
scolaires, du moins dans les manuels de sciences de la vie et de la
terre (SVT) de première. La faute aux éditeurs trop zélés ? Peut-être
faut-il y voir, également, l'influence des milieux universitaires, où
l'intérêt pour les gender studies va
croissant : tandis que sept revues leur seraient entièrement
consacrées, elles auraient mobilisé, ces dernières années, plus ou
moins assidument, près de deux mille chercheurs. Des
« orientations stratégiques » devraient leur être
assignées, clame le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, qui vient de publier un rapport en ce sens, coordonné par
Alban Jacquemart, Agnès Netter et Françoise Thibault.
Genre et sexe
« Le genre est d'abord un concept, initialement issu
des sciences médicales et de la grammaire française puis repris par les
sciences sociales », rappellent-ils. Un concept censé aider
« à mettre au jour, en les questionnant, les rapports sociaux
entre hommes et femmes ». Le psychiatre Robert Stoller aurait
été le premier à l'utiliser, dans les années soixante, pour
« distinguer la conformation sexuelle des individus (le sexe)
de l'identité sexuée, psychologiquement et socialement construite (le
genre) ». Outre l'anthropologie, la psychologie, la
littérature et les langues, le "genre" affecterait plus
particulièrement la sociologie et l'histoire, disciplines où il serait
majoritairement enseigné. Aux dires des rapporteurs, par exemple, la
compréhension du fait colonial s'en serait trouvée revisitée.
Une priorité du CNRS
Le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) se
serait saisi des ces recherches dans les années quatre-vingt. En son
sein, l'Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) les a depuis
érigées au rang de priorité, permettant le recrutement de sept chargés
de recherche. Toujours sous la houlette du CNRS a été créé, l'année
dernière, l'Institut du genre, un "groupement d'intérêt scientifique"
réunissant trente-cinq universités et autres institutions.
Parallèlement, l'Institut d'études politiques de Paris, ainsi que
l'université Paris VII, ont décidé de familiariser leurs
étudiants avec les gender studies. Aux yeux des
rapporteurs, cependant, cela reste insuffisant. Ainsi conviendrait-il,
selon eux, d'« inciter les universités à construire des
licences qui comportent aux moins deux modules obligatoires sur le
genre ». Mais aussi d'y confronter tous les enseignants au
cours de leur formation. Voire un plus large public, à l'intention
duquel pourrait être créée une « université
populaire ». D'autres propositions sont formulées
« afin de lutter contre [des] inégalités
persistantes » et « de faire évoluer les
établissements supérieurs et de recherche vers la parité »,
ceux-ci devant « prendre conscience de l'existence des
stéréotypes de genre qui biaisent l'évaluation ». Si,
contrairement à d'autres, les rapporteurs ne demandent pas que soit
rebaptisée l'école maternelle, ils appellent néanmoins à
« généraliser l'usage d'une langue non sexiste » - ce
à quoi ils s'emploient en bannissant le "masculin générique" : sous
leur plume, ce sont des chercheur-e-s qui se sont exprimé-e-s !
Mouvement LGBT
Parmi eux, relèvent-ils, « plusieurs [...] sont, par
exemple, membres de l'Observatoire de la parité et permettent que les
politiques publiques se nourrissent des savoirs académiques ».
Autant dire qu'ils versent volontiers dans un certain prosélytisme. En
cela, ils s'inscrivent d'ailleurs dans un tradition historique. Les
recherches portant plus particulièrement sur « les sexualités
et les identités de sexe [...] en partie initiées par le mouvement LGBT
(qui regroupe des militant-e-s lesbiennes, gays, bisexuel-le-s et
transgenres), ont été particulièrement importantes dans l'élaboration
même du concept de genre », soulignent les rapporteurs. C'est
dire combien le militantisme interfère, depuis l'origine, dans les
études de genre. Comment s'étonner, dans ces conditions, que « la
recherche sur le genre peine à trouver, dans l'organisation
scientifique actuelle, la reconnaissance » que revendiquent ses
promoteurs ?
Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent
7 février 2013
Article publié dans L'Action Française 2000
Après avoir enchaîné les succès, la fusée Ariane V
entrevoit désormais le lanceur qui lui succédera dans dix ans, et dont
dépendra l'avenir d'une filière industrielle où la France excelle.

Ce jeudi 7 février 2013 était programmé le premier
tir de l'année d'une fusée Ariane. Sans prendre trop de risques, on
peut parier qu'il se sera conclu par un nouveau succès – la
cinquante-quatrième réussite consécutive. Fort de la fiabilité de son
lanceur vedette, secondé désormais par des fusées Soyouz et Vega,
Arianespace domine largement son marché, dont il a accaparé
60 % des commandes au cours de l'année passée. Son carnet en
serait rempli pour les trois ans qui viennent !
Proton & SpaceX
Parmi ses principaux concurrents figure International Launch
Services (ILS), dont la fusée Proton accumule les déboires. Son dernier
échec – le cinquième en six ans – remonte au mois de décembre, où un
satellite de télécommunication avait été déposé sur une mauvaise
orbite. À la faveur d'un petit exploit, les ingénieurs de Thales Alenia
Space (TAS) ont rattrapé les dégâts. Toutefois, la durée d'exploitation
du satellite livré à Gazprom Space Services devrait s'en trouver
réduite à onze ou douze ans, contre une quinzaine d'années promises à
l'origine. Les assureurs s'en mordent les doigts... Autre rival de
poids : SpaceX, dont Jean-Yves Le Gall, le P-DG
d'Arianespace, raille volontiers les promesses extravagantes.
« Quelle confiance accorder à un concurrent qui annonce
envoyer dans quinze ans, quatre-vingt mille personnes sur
Mars ? », a-t-il demandé à La Tribune.
« On rêve », a-t-il prévenu.
Fusée low cost
En coulisses, cependant, on craint que les prix soient
durablement tirés à la baisse. Aussi le successeur d'Ariane V
est-il d'ores et déjà présenté comme un lanceur "low cost". Selon le
Quai d'Orsay, « Ariane VI aurait notamment l'avantage
d'être modulable en fonction de la charge à lancer – entre deux et huit
tonnes. Le lanceur serait également en mesure de transporter un seul
satellite, ce qui permettrait de répondre plus rapidement à la demande
d'un client, sans attendre la commande d'un second satellite.
Arianespace entend aussi réduire les coûts de fabrication et rendre
l'offre plus flexible. Ainsi, Ariane VI ne serait constituée que d'un
seul étage qui serait réallumable. » Son lancement inaugural
devrait intervenir d'ici dix ans. Ainsi en ont décidé les ministres des
vingt États membres de l'Agence spatiale européenne (ESA), réunis à
Naples les 20 et 21 novembre. Cela n'était pas gagné d'avance,
tant était contestée l'opportunité de lancer le développement d'une
nouvelle fusée. Berlin privilégiait celui d'une version modernisée
d'Ariane V, dont bénéficiera tout particulièrement le site industriel
de Brême. Astrium et Safran, les deux entreprises françaises les plus
impliquées, étaient du même avis, au grand dam du CNES (Centre national
d'études spatiales). Aussi Mme Geneviève Fioraso, ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a-t-elle dû batailler afin
que la France s'adresse d'une seule voix à ses partenaires européens.
Sa tâche aurait été d'autant plus ardue que son prédécesseur, Laurent
Wauquiez, aurait traité le dossier avec désinvolture.
Deux projets en un
En définitive, les États membres de l'ESA se sont accordés
pour moderniser Ariane V tout en concevant une nouvelle fusée,
les deux projets devant être menés en synergie. « Alors, tous
gagnants ? Sûrement, mais Paris a toutefois réussi un joli tour de
force en imposant dans le calendrier de l'ESA [...] le programme
Ariane VI », a commenté, dans La Tribune,
notre confrère Michel Cabirol. Toutefois, « si aujourd'hui
tout le monde semble satisfait, dès 2014 va resurgir la question du
partage de la charge de travail entre les différents pays contributeurs
au programme Ariane VI, notamment entre la France et
l'Allemagne. » Or, « plus rustique, Ariane VI
pourrait - à nombre de lancements égal - ne faire vivre que la moitié
des dix mille personnes qui travaillent dans la filière lanceur en
Europe, estiment certains experts ». Une inquiétude que
tempère François Auque, le président d'EADS Astrium, pariant sur le
succès commercial du futur lanceur.
Le rôle stratégique de Kourou
Pour la France, martèle le gouvernement, « le
programme Ariane concerne des milliers d'emplois et des compétences
industrielles majeures. En effet, le groupe français Astrium est aux
commandes de la réalisation de la fusée. La filiale du groupe EADS
emploie dix-huit mille salariés. Elle voit dans ces projets une marque
de la véritable consolidation de l'avenir du spatial européen. Pour
l'actuelle Ariane V, le groupe se charge notamment d'assembler le
premier étage de la fusée dans son usine des Mureaux en région
parisienne. Il travaille sur la conception du réservoir en lien avec
Cryospace, filiale à 55 % d'Air liquide et à 45 %
d'Astrium. Plusieurs composants d'Ariane sont fabriqués par d'autres
entreprises françaises comme Snecma, filiale de Safran, en charge des
moteurs Vulcain. Au total, près de deux cents entreprises participent à
la fabrication de cette colossale fusée de sept cent soixante-dix
tonnes. Pour éviter les risques inhérents aux opérations de transport,
les propulseurs à poudre de la fusée, conçus par Europropulsion (Snecma
et l'italien Avio), sont assemblés directement sur le site de Kourou.
C'est là qu'est établi, depuis 1973, le centre spatial guyanais, base
de lancement des fusées européennes. »
La chambre haute vient d'ailleurs d'examiner un accord, en
attente de ratification depuis sa signature le 18 décembre
2008, censé « fournir une base juridique unifiée et actualisée
à l'utilisation par l'Agence du Centre spatial guyanais »
(CSG), selon les explications du rapporteur Bertrand Auban, sénateur de
la Haute-Garonne. L'engagement de l'ESA en matière de financement et
d'utilisation de la base de lancement va s'en trouver pérennisé, se
félicite-t-il. Tandis que la zone euro peine à s'extirper de la crise,
alors que l'intervention solitaire de la France au Mali dissipe moult
illusions, peut-être la politique spatiale est-elle l'exemple d'une
coopération européenne réussie ?
Publié dans Économie et Industrie, Espace | Pas de commentaire | Lien permanent
16 janvier 2013
Article publié dans L'Action Française 2000
Décidé à collectionner les nationalités, sinon à les troquer,
Gérard Depardieu joue les nomades dans un monde toujours façonné par
les rivalités d'États souverains.

À la faveur du différend l'opposant à Jean-Marc Ayrault,
Gérard Depardieu n'a pas cessé de le marteler : « je
suis un citoyen du monde », a-t-il encore déclaré début
janvier (2013), alors qu'il venait de recevoir un passeport russe des
mains du président Vladimiir Poutine. « Il montre
effectivement que grâce à la mondialisation nous sommes, dans une
certaine mesure, libres d'échapper à la main lourde d'un
État », s'est félicité Emmanuel Martin, dans un billet publié
par l'Institut Turgot, arguant que « la concurrence
institutionnelle, et particulièrement la concurrence fiscale est une
composante essentielle de notre liberté ». De fait, constate
Élie Cohen, « l'accumulation de taxes nouvelles sur le capital
au moment de sa formation, de sa détention, de sa transmission, et de
sa distribution n'est pas soutenable à long terme dans une économie
ouverte ». De ce point de vue, souligne-t-il sur Telos,
« Gérard Depardieu met le doigt sur les contradictions
européennes de nos gouvernants ».
Citoyen du monde ?
Mais bien qu'il se proclame « citoyen du
monde », Gérard Depardieu n'en est pas moins réduit à se
placer sous la juridiction d'un État, comme tout un chacun, quoique son
aisance financière lui procure quelque facilité quand il s'agit de
solliciter sa protection, et non d'en hériter par naissance. En cela,
il ferait plutôt figure de nomade. Un nomade au déracinement somme
toute relatif. « J'ai un passeport russe, mais je suis
français », a-t-il également proclamé, nuançant ses propos
précédents. Amateur de bonne chère, souvent aigri mais volontiers
débonnaire, il « fait partie de notre patrimoine
cinématographique », comme l'a observé Mme Aurélie
Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Qu'il le
veuille ou non, l'interprète d'Obelix incarne la France aux yeux du
monde.
Paradoxalement, c'est vraisemblablement la raison pour
laquelle il a été accueilli si chaleureusement en Russie. On a beau
vivre dans un village global, les États continuent de se tirer dans les
pattes. « L'intelligence économique [...] de Vladimir Poutine
est une démonstration concrète de la façon de saisir des opportunités
pour affaiblir une nation », souligne un contributeur de
l'Alliance géostratégique (AGS). « Et peu importe les
déclarations diplomatiques de rose et de miel quand les faits
illustrent que les nations dites "amies" sont néanmoins concurrentes
avec leurs intérêts propres à promouvoir et à développer. »
Souveraineté
Dans ces conditions, « ce passeport est moins un
document juridique qu'un symbole », comme le remarque Yannick
Harrel, lui aussi contributeur de l'AGS. C'est pourquoi on ne
s'attardera pas sur la faculté, pour Gérard Depardieu, de bénéficier
effectivement d'une double nationalité franco-russe, en dépit des
doutes planant à ce sujet. Par ailleurs, à supposer qu'il souhaite à
nouveau se défaire de sa nationalité française - « je vous
rends mon passeport et ma Sécurité sociale », avait-il déclaré
à l'intention de Jean-Marc Ayrault - il lui faudrait engager des
démarches sans trop tarder, et justifier d'une résidence effective à
l'étranger. Autrement dit, sa nationalité dépend du bon vouloir de
l'État – c'est-à-dire, selon les cas, des dispositions du droit ou des
largesses du prince.
« C'est donc l'État souverain qui décide qui est un
de ses nationaux. C'est sans doute l'expression la plus pure de sa
souveraineté, car elle ne suppose pas l'accord d'un autre
État », selon Me Eolas, l'animateur du Journal
d'un avocat. Mme Najat Vallaud-Belkacem,
porte-parole du gouvernement, ne s'y est pas trompée :
« c'est le pouvoir discrétionnaire de Vladimir Poutine
d'offrir la nationalité russe à qui il l'entend », a-t-elle
observé, se refusant à tout autre commentaire sur BFM TV.
« Quand un citoyen français a une autre nationalité,
deux souverainetés se heurtent, et aucune ne peut
l'emporter », explique Eolas. « L'autre État a tout
autant que la France le droit de décider qui sont ses ressortissants,
et le législateur français n'a aucun pouvoir pour limiter la
transmission de cette autre nationalité. Qui n'est tout simplement pas
son affaire. » Tout au plus la France pourrait-elle
« s'attaquer aux Français par acquisition », selon
notre avocat. « Ceux-là devraient, pour pouvoir acquérir la
nationalité française, renoncer préalablement à leur nationalité
d'origine. Et on se casse à nouveau les dents sur la souveraineté des
États étrangers. Quid si l'État en question ne
prévoit pas la possibilité de renoncer à cette nationalité ?
[...] On aura des enfants nés en France, y ayant grandi, voire y passant
toute leur vie, mais qui ne seront jamais Français à cause d'une loi
votée dans un autre pays. Tandis que son voisin, lui, aura la
nationalité française dès l'âge de treize ans. En somme, la nationalité
française dépendra de la loi d'un État étranger. » C'est dire la
prudence avec lequel devra manœuvrer le législateur, si d'aventure il
se décide à bannir la double nationalité.
Publié dans Droit, Monde, Mondialisation, Politique, Société | Pas de commentaire | Lien permanent
6 janvier 2013
Plaidoyer récréatif en faveur de l'égérie populiste.
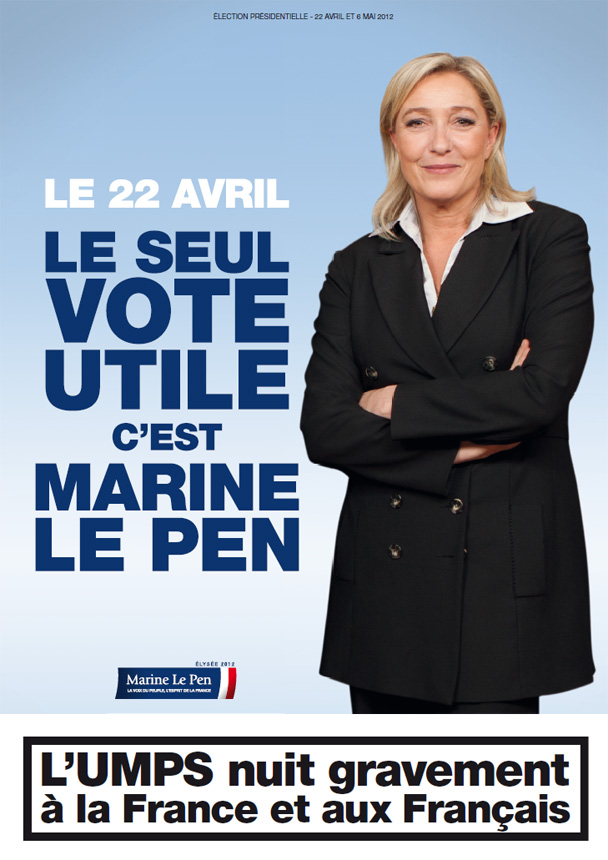
Scandale dans la blogosphère néo-frontiste ! Marine
Le Pen n'ira pas manifester, le 13 janvier prochain,
contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. L'égérie
populiste serait coupable de sacrifier la famille sur l'autel de
quelque calcul politicien, lit-on ici où là. C'est traiter bien
injustement celle qui continue d'incarner, contre vents et marées,
l'espoir du redressement national.
Aujourd'hui comme hier, en effet, la priorité demeure de
renverser l'UMPS, ce syndicat d'oligarques menant le pays à sa perte.
Politique d'abord ! Dans cette optique, la "manif pour tous"
doit être analysée pour ce qu'elle est : à savoir, une funeste
opération d'enfumage, téléguidée comme toujours depuis Bruxelles et
Washington. D'ailleurs, ses organisateurs cachent mal leur
jeu : les sympathies de Frigide Barjot à l'endroit des
invertis donnent à réfléchir ; pour bénéficier d'une telle
couverture médiatique, ne faut-il pas en être, d'une façon ou d'une
autre ? Seuls des naïfs peuvent l'ignorer : le
Système (avec une majuscule SVP) ne se divise que pour mieux régner.
Dans le cas présent, il entretient sciemment l'illusion d'une
opposition entre PS et UMP, donnant à croire qu'une alternance est
possible dans notre démocratie dont les acteurs sont, en réalité, les
marionnettes d'une superclasse mondiale à la solde du capitalisme
apatride.
Dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, Marine
Le Pen avait renvoyé dos à dos chacun des deux finalistes
sélectionnés par les médias aux ordres. À l'époque, il n'était pas
question de préférer François Hollande à Nicolas Sarkozy au motif que
celui-là brouillerait plus certainement que celui-ci les repères de
la filiation. Qu'on se le dise : Marine Le Pen est
d'une autre trempe que les girouettes qui nous gouvernent !
Elle n'est pas du genre à retourner sa veste au moindre mouvement de
foule canalisé par des services préfectoraux pour le moins
complaisants... Marine Le Pen a l'étoffe d'une femme
d'État, lucide dans son jugement, ferme dans ses convictions,
déterminée dans son action. L'amour de la France, voilà son unique
passion ! Hélas, jusqu'au sein de son propre parti, les
suppôts du mondialisme redoublent d'efforts pour la faire trébucher.
Ces traitres seront châtiés comme tel le jour la France, la vraie,
retrouvera ses droits. En attendant, la nouvelle Jeanne d'Arc résiste
admirablement aux terribles pressions qui s'abattent sur elle. Bravo
Marine ! De ton obstination à rester en marge d'une manifestation dépend évidemment l'avenir de la
France, sinon celui de la planète voire de l'univers tout entiers.
Publié dans Politique, Populisme | 3 commentaires | Lien permanent
2 janvier 2013
Article publié dans L'Action Française 2000
Chantre de l'égalité, le gouvernement entend surveiller
l'expression des internautes, mais aussi inculquer ses principes aux
enfants, cela dès le plus jeune âge. En s'inspirant, vraisemblablement,
des "études de genre".

L'"homophobie", voilà l'ennemi ! Du moins a-t-elle
été désignée comme telle par Mme Najat Vallaud-Belkacem,
ministre des Droits des femmes et porte-parole du gouvernement.
« Il y a quelques jours, le réseau Twitter a été le support
[...] d'un déferlement de propos d'une violence rare à l'endroit des
personnes homosexuelles », a-t-elle déploré dans une tribune
publiée par Le Monde vendredi dernier,
28 décembre 2012.
Suicides sur Twitter
Or, selon le ministre, « les messages ainsi maintenus
en accès libre [...] ont pu présenter un danger pour des jeunes
homosexuels de notre pays ». En effet, « à l'âge où
les questionnements sur la sexualité apparaissent », ils
seraient « très sensibles aux violences, y compris verbales,
homophobes » - lesquelles seraient « la première
cause de suicide chez les adolescents dans notre pays ». En
conséquence, « sans préjudice d'éventuelles actions
judiciaires », Mme Vallaud-Belkacem en appelle
« au sens des responsabilités de l'entreprise Twitter inc.,
pour qu'elle contribue à prévenir et à éviter de tels
débordements ». Celle-ci est invitée à entamer des discussions
le 7 janvier.
Canalisant l'expression des internautes, le gouvernement
entend, par ailleurs, façonner les con-sciences : de la
maternelle au lycée, « l'éducation à l'égalité des sexes doit
devenir une pratique quotidienne », a-t-il annoncé le
14 décembre. Dès la rentrée 2013, « les classes de
grande section de maternelle et des écoles élémentaires de cinq
académies expérimenteront "l'ABCD de l'égalité" » - un
« outil pédagogique » censé permettre aux enseignants
et à leurs élèves « de travailler sur les connaissances et les
comportements de chacun envers le sexe opposé ». Dans les
collèges et lycées, « des actions de sensibilisation pour
lutter contre le harcèlement et les violences sexistes verront le
jour ». En outre, les futurs enseignants
« bénéficieront d'un module de formation spécifique au sein
des écoles supérieures de professorat et de l'éducation »
dédié « à la "lutte contre les stéréotypes de genre dans les
pratiques professionnelles" ».
Changer les rôles
Déplorant que l'orientation des élèves soit « souvent
le résultat de stéréotypes intériorisés », les pouvoirs
publics vont mettre en valeur « les trajectoires de femmes
ayant réussi dans des métiers "dits d'homme", et
inversement ». Enfin, le gouvernement promet « un
nouveau plan d'action pour l'éducation à la sexualité » censé
« traiter la sexualité dans toutes ses dimensions :
physiologique, psychologique, sociale, éthique et
culturelle ». En s'inspirant des gender studies ?
Cela n'aurait rien d'étonnant. Début décembre, Mme Virginie
Duby-Muller, député UMP de Haute-Savoie, a déposé à l'Assemblée
nationale une proposition de résolution « tendant à la
création d'une commission d'enquête sur l'introduction et la diffusion
de la théorie du gender en France ». À
cette occasion, elle a rappelé, entre autres, l'existence de la crèche
Bourdarias en Seine-Saint-Denis : « une crèche dont,
depuis avril 2009, les équipes, qui ont été formées par des
spécialistes suédois, pratiquent une pédagogie "active égalitaire" et
se mobilisent pour lutter contre les stéréotypes de genre qui assignent
les enfants à des rôles différents en fonction de leur sexe - "on
encourage les filles à manier le marteau à l'atelier bricolage et les
garçons à s'exprimer à l'atelier émotions" ». Or
« cette expérience pilote intéresse le gouvernement puisque
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des Femmes et Dominique
Bertinotti, ministre déléguée [sic] à la Famille l'ont visitée en
septembre dernier et affirmé clairement leur désir de multiplier ce
type de dispositif, et de réfléchir à la formation et à la pratique des
professionnels de la petite enfance ».
Cependant, rappelle encore Mme Duby-Muller, le
23 novembre 2012, le tribunal administratif de Paris a annulé
l'agrément "Éducation nationale" dont bénéficiait SOS homophobie, en
tant qu'association éducative complémentaire de l'enseignement public,
pour atteinte au principe de neutralité qui s'impose aux associations
intervenant dans l'enseignement public, ainsi que pour atteinte aux
convictions religieuses et philosophiques des élèves, de leurs parents
ou des enseignants. Preuve que le bourrage de crânes rencontre encore
quelques obstacles.
Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent
2 janvier 2013
Article publié dans L'Action Française 2000
L'union des couples homosexuels et l'homoparentalité sont
d'ores et déjà consacrées par la loi à l'étranger, où se vérifie par
ailleurs la désaffection pour le mariage. Petit tour d'horizon.

A la faveur du "mariage pour tous" et de son corollaire,
l'ouverture de l'adoption aux couples de même sexe, des enfants
pourraient, demain, se voir réputés nés de deux pères ou deux mères.
Une situation ubuesque qui ne serait pas sans précédents. Au Québec,
une "présomption de parentalité" a été instituée en faveur des femmes
unies devant la loi. Modifié à cet effet en 2002, le code civil
appliqué dans la Belle Province envisage le recours à la procréation
médicalement assistée, mais aussi les cas où « l'apport
génétique se fait par relation sexuelle » - autrement dit avec
la complicité d'un homme consentant généreusement à quelque ébat
susceptible de palier la stérilité du ménage. Dans ces conditions, le
droit québécois le stipule explicitement, « l'enfant, issu
[...] d'un projet parental entre époux [...] qui est né pendant leur
union ou dans les trois cents jours après sa dissolution ou son
annulation est présumé avoir pour autre parent le conjoint de la femme
qui lui a donné naissance ».
Accrocs en série
En novembre, Le Figaro avait
signalé quelques « accrocs du mariage gay » recensés
à l'étranger. Notamment au Royaume-Uni. « Ann avait tout
d'abord consenti à ce que son mari Michael fasse don de son
sperme », racontent nos confrères Agnès Leclair et Stéphane
Kovacs. « Mais à l'annonce de la naissance d'une petite fille
chez un couple de lesbiennes, elle a craqué : le sperme ne
fait-il pas partie des "biens matrimoniaux" ?,
s'interroge-t-elle, bouleversée "comme si [son] mari l'avait trompée".
Les lesbiennes étant trop âgées, elles avaient fait appel à une mère
porteuse, tout en entamant une procédure d'adoption. Laquelle échouera,
justement à cause de leur âge... La mère porteuse accouchera donc sous
le nom de l'une d'entre elles. Et le tribunal, devant lequel Ann et
Michael tentèrent de récupérer l'enfant, donnera finalement raison au
couple de lesbiennes. » Et d'évoquer, un peu plus loin,
« le donneur qui voulait juste rendre service »,
auquel on réclame désormais le versement d'une pension alimentaire :
« "Pourquoi ne poursuit-on pas la deuxième mère, qui les a
élevées, et qui, elle, a les moyens ?", s'énerve-t-il. Quant
aux filles de douze et quatorze ans, elles sont très perturbées
psychologiquement. "Jamais je ne pourrai me marier ni avoir des
enfants", assène l'aînée. » Beau travail !
Cependant, tandis que la France s'apprête à marier des couples
homosexuels, « des États-Unis à l'Inde, en passant par les
Pays-Bas, l'Italie et le Liban, de plus en plus de voix s'élèvent
contre une norme sociale jugée dépassée ». C'est en tout cas
le constat dressé par le Courrier international
dans son dernier numéro de l'année 2012. « Katie Bolick a
tenté de cerner ce phénomène en retraçant l'histoire du mariage et de
son déclin dans un article publié dans The Atlantic.
[...] Le refus de convoler en justes noces est-il représentatif d'un
courant de fond ? se demande la journaliste américaine.
Faut-il vraiment idéaliser le mariage d'amour ? s'interroge à
son tour une humoriste à Bombay. Ne devrait-on pas autoriser les unions
avec... des appareils ménagers ? propose même un écrivain à
Milan. » De fait, l'ouverture du mariage aux couples de même
sexe serait demeurée inenvisageable si le mariage lui-même ne s'était
pas trouvé préalablement remis en cause.
Crime contre l'humanité
Cela dit, tous les habitants du village global ne sont pas
logés à la même enseigne. Le 12 décembre, le Parlement
d'Uruguay a certes approuvé un projet de loi légalisant le mariage
homosexuel. « Le petit pays sud-américain a pris une position
progressiste envers les droits des homosexuels au cours des six
dernières années, approuvant les unions civiles, les adoptions par des
couples gays et lesbiens, les changements de sexe dès l'âge de dix-huit
ans et la présence des homosexuels au sein des forces
armées », souligne l'AFP. Mais la veille de ce vote, le
secrétaire général de Nations Unis, Ban Ki-moon, avait exprimé son
indignation : « C'est un scandale que dans le monde
d'aujourd'hui, tant de pays continuent de [poursuivre] leurs citoyens
au prétexte qu'ils aiment une personne du même sexe », a-t-il
déclaré. Soixante-seize pays seraient visés par ses récriminations.
C'est le cas du Cameroun, où les paroles de
Mgr Bakot, l'archevêque de Yaoundé, prononcées pendant la
messe de minuit, n'ont pas dû choquer grand monde :
« le mariage entre personnes du même sexe est un crime sérieux
contre l'humanité », a-t-il martelé, selon les propos
rapportés par Pierre de Bellerive sur Nouvelles de France.
« Nous devons nous lever pour le combattre, avec toute notre
énergie », a-t-il poursuivi. Rendez-vous le 13 janvier !
Publié dans International, Monde, Société | Pas de commentaire | Lien permanent
20 décembre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Des Verts au FN en passant par le PS et l'UMP, le
malthusianisme nourrit la plupart des discours politiques...

La Chine « est prête à abandonner la politique de
l'enfant unique », a annoncé La Tribune
le 28 novembre 2012. Selon notre confrère Nabil Bourassi, dans
les régions les plus développées de l'empire du Milieu, les couples
devraient être autorisés prochainement à accueillir un second enfant.
Le malthusianisme s'en trouvera-t-il voué aux gémonies ? Loin
s'en faut.
L'or noir intarissable
Au printemps 2009, on s'en souvient, Yves Cochet, alors député
Vert de Paris, avait appelé à « la grève du troisième
ventre », au motif qu'un enfant européen présenterait
« un coût écologique comparable à six cent vingt trajets
Paris-New York ». À la hantise du réchauffement
climatique s'ajoute le spectre récurrent d'une raréfaction des
ressources. L'expérience donne pourtant à réfléchir : annoncé
à de multiples reprises, l'épuisement des réserves pétrolières n'en
finit pas d'être reporté ; depuis quarante ans, comme le
rappelait Georges Kaplan en juin dernier, « les réserves
prouvées mondiales [...] ont largement plus que
doublé » ; « il existe même aujourd'hui
quelques projets très sérieux de pétrole de synthèse ». C'est
dire combien le pessimisme s'avère de mauvais aloi. Pas plus que
Maurras, nous ne croyons « à la grève du génie
humain » !
Bien qu'ils en soient les chantres les plus éminents, les
écologistes n'ont pas l'apanage du malthusianisme. Sous ses diverses
déclinaisons, celui-ci façonne l'opinion publique en profondeur,
inspirant la plupart des discours politiques. À commencer par celui des
socialistes. Le Premier ministre l'a confirmé le 11 décembre,
tandis qu'il fustigeait l'évasion fiscale de Gérard
Depardieu : « on ne fera pas reculer la pauvreté si
ceux qui ont le plus [...] n'acceptent pas un peu de solidarité et un
peu de générosité », a-t-il déclaré. Ainsi la nation
serait-elle promise au rationnement selon Jean-Marc Ayrault... La mise
en place des trente-cinq heures a procédé d'un préjugé similaire, selon
lequel nous serions condamnés à partager un nombre figé d'emplois.
Traditionnellement, le Front national puise à la même source :
ne juge-t-il pas « l'immigration professionnelle [...]
particulièrement condamnable [...] alors que le chômage
explose » ?
Démondialisation
Prônée, entre autres, par Arnaud Montebourg, la
« démondialisation » transpose cette conception à
l'échelle du Village global, où l'on s'imagine qu'un emploi créé en
Chine serait nécessairement perdu en France. Or, si l'on en croit
Alexandre Gazaniol, auteur d'une note publiée par la Fabrique de
l'industrie, « l'internationalisation des entreprises a un
effet positif sur leur chiffre d'affaires, leur innovation et leur
emploi en France, et contribue donc au développement de l'activité
industrielle française ». Bien qu'elles appellent peut-être
quelque nuance, ces conclusions soulignent la complexité d'un débat
esquivé par le néo-malthusianisme, dont les adeptes feignant de croire
que l'économie est un jeu à somme nulle. N'ont-il jamais eu vent, par
exemple, des "avantages comparatifs" mis en évidence par David Ricardo
en 1817 ? « Il s'agit du meilleur exemple d'un
principe économique indéniable mais contraire à l'intuition de
personnes intelligentes », remarquent justement les
contributeurs de Wikipedia.
L'UMP n'est pas en reste : il y a un an, Alain
Moyne-Bressand, député de l'Isère, avait déposé une proposition de loi
« visant à interdire la généralisation des caisses
automatiques aux barrières de péages sur le réseau français
autoroutier » ; selon les signataires de ce texte,
parmi lesquels figuraient Lionel Luca, Christian Ménard, Jacques Myard,
Éric Raoult, Christian Vanneste..., « en temps de crise [...]
où le chômage atteint de tristes records, aucun emploi ne doit être
supprimé ou minimisé ». C'est méconnaître le caractère
dynamique de l'économie, où la « destruction »,
quoique parfois douloureuse, s'avère néanmoins
« créatrice », comme l'écrivait Joseph Schumpeter.
Les réactionnaires doivent-ils s'en offusquer ? Selon Maurras,
en tout cas, « la vérité politique et sociale qui nous conduit
n'a pas la forme du regret. Elle est plutôt désir, curiosité, solide
espérance apportant les moyens de réaliser l'avenir avec une
imperturbable sécurité. » Au passage, on rappellera que, dans
son rapport sur la compétitivité, Louis Gallois a précisément déploré
le faible niveau de robotisation de l'industrie nationale.
Qu'on le veuille ou non, il faudra compter avec le progrès
matériel. Pour le meilleur ou pour le pire. « Tous ces changements que
nous opérons dans l'économie de notre planète n'ont mené à rien
jusqu'ici et rien ne permet d'admettre qu'ils conduisent jamais à
rien », observait Maurras. Toutefois, poursuivait-il,
« nous y travaillons parce qu'il est dans notre ordre d'y
travailler ». « Animal industrieux », voilà,
selon lui, « la définition première de l'homme ».
Aussi les incantations lancées en faveur de la décroissance nous
paraissent-elles tout aussi vaines que la tentative de normaliser
l'homosexualité par l'institution d'un "mariage pour tous" :
ce ne sont jamais que les expressions multiples d'un volontarisme voué
à échec.
Publié dans Économie et Industrie, Idées | Pas de commentaire | Lien permanent
20 décembre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Sous quelles conditions des candidats à l'adoption
parviennent-ils à accueillir un enfant ? La question mérite
d'être posée, alors que l'ouverture du mariage aux couples de même sexe
pourrait prochainement changer la donne.

Plus de vingt-cinq mille foyers étaient en attente d'adoption
en 2006. Selon un rapport de l'Ined publié en 2007, tandis que huit
mille nouveaux agréments étaient alors délivrés chaque année, seuls
quatre à cinq mille enfants avaient fait l'objet d'une adoption
plénière, la plupart nés à l'étranger (80 % en 2005).
« Il y a effectivement beaucoup moins d'enfants légalement
adoptables en France que de candidat-e-s à l'adoption »,
reconnaît SOS Homophobie, dans un jargon typique récusant la
valeur générique du masculin. Toutefois, prévient l'association, il
serait « parfaitement discriminatoire » -
et donc intolérable - de donner la priorités aux couples traditionnels
si les couples homosexuels obtenaient l'autorisation d'adopter.
Discriminations
Or, les inégalités semblent d'ores et déjà flagrantes -
quoiqu'elles ne procèdent pas nécessairement d'une injustice. Parmi les
couples candidats à l'adoption, « on compte seulement
19 % d'ouvriers [...], alors qu'ils représentent 35 %
de la population active du même âge », relève l'Ined. « À
l'inverse, 25 % des candidats sont cadres alors qu'ils
représentent seulement 16 % de la population active. Le revenu
médian des candidats à l'adoption est d'ailleurs supérieur de
20 % à la médiane nationale. »
Quant à l'agrément requis pour adopter, il est « plus
fréquemment refusé aux célibataires qu'aux couples, aux couples de plus
de quarante ans qu'aux couples plus jeunes, aux parents ayant déjà des
enfants biologiques qu'aux couples n'en ayant pas, et aux candidats de
milieux sociaux défavorisés qu'aux autres ». Il est délivré
par le président du Conseil général, à l'issue d'une procédure censée
garantir, conformément aux décrets en vigueur, que « les
conditions d'accueil offertes par les futurs parents correspondent aux
besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté ». Un refus
sanctionne moins de 10 % des procédures menées à
leur terme. Le cas échéant, les motifs invoqués pointent, le plus
souvent, « une perception insuffisante de la spécificité de
l'enfant adopté », un projet « prématuré »,
une attente différente de l'adoption par les deux conjoints, le deuil
du désir d'enfant biologique qui n'est pas fait.
Le pouvoir du psy
D'un département à l'autre, « il existe de fortes
différences [...] dans les taux d'abandon avant agrément et dans la
proportion de candidats qui réussissent à adopter après
agrément », comme le relève, dans ses conclusions pour l'Ined,
Mme Catherine Villeneuve-Gokalp. Les interventions des
psychologues, « animés par des conceptions différentes de
l'adoption », expliqueraient en partie ce constat, suscitant
« une présélection plus ou moins forte des
candidats ». De fait, lorsque les entretiens auxquels ils sont
soumis « deviennent dérangeants, voire conflictuels, certains
candidats refusent de les poursuivre ou anticipent un rapport
défavorable suivi d'un refus d'agrément et préfèrent renoncer à leur
projet ». L'Ined cite un refus d'agrément « opposé à
une célibataire pour manque d'image masculine empêchant l'enfant de
"faire son Œdipe" » : preuve qu'en dépit du droit, on
traîne parfois les pieds au plus près du terrain... « La
possibilité de demander que les investigations soient refaites par
d'autres personnes existe, mais elle est peu utilisée »,
précise l'Institut. Peut-être les homosexuels décidés à adopter
feront-ils preuve d'une opiniâtreté inédite ? En cas de
recours gracieux déposé auprès du président du Conseil général,
celui-ci revient sur sa décision « près d'une fois sur
deux ». À ce stade, les candidats malheureux ont tout intérêt
à entamer une nouvelle demande d'agrément, « plutôt que de tenter un
recours contentieux qui ne leur fera guère gagner de temps, risque de
leur être défavorable et leur attirera l'hostilité des services
d'adoption, hypothéquant ainsi leurs chances pour une nouvelle
demande ». Mais là aussi, peut-être des homosexuels
s'inscrivant dans une démarche militante seraient-ils tentés, le cas
échéant, d'agir différemment ?
Soutien associatif
À cet effet, ils bénéficieraient vraisemblablement d'un
soutien associatif qui s'avère d'ores et déjà déterminant. Du moins
pour l'adoption internationale. Celle-ci « dépend des réseaux
d'information et de leur facilité d'accès », explique
Mme Villeneuve-Gokalp. « En particulier, les
célibataires, surtout les hommes, sont souvent mal accueillis par les
associations de parents adoptifs. » Créée en 2006, l'Agence
française pour l'adoption (AFA) devait contribuer à « réduire
ces inégalités ». Quoi qu'il en soit, « les
variations annuelles du nombre d'enfants adoptés à l'étranger
rappellent, s'il en est besoin, que l'origine des différences se situe
aussi dans les réglementations des pays d'origine ». Or,
« seuls trois pays, les États-Unis, le Brésil et l'Afrique du
Sud pourraient potentiellement répondre aux demandes des couples
homosexuels », selon Arnaud Del Moral, chargé de la stratégie
et des procédures d'adoption à l'AFA. Celle-ci « appréhende
que les couples dont les dossiers ne seraient pas envoyés dans des pays
où ils n'ont aucune chance d'aboutir se retournent contre elle devant
les tribunaux administratifs », résume, dans Le Figaro,
notre consœur Agnès Leclair. Qu'en pense le Défenseur des droits, ayant
succédé à la Halde ?
Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent