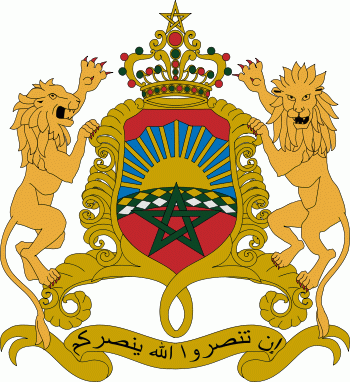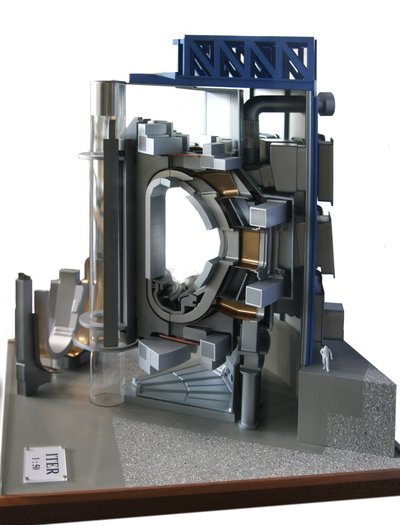18 mars 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelques mots sur le premier sommet UE-Maroc.
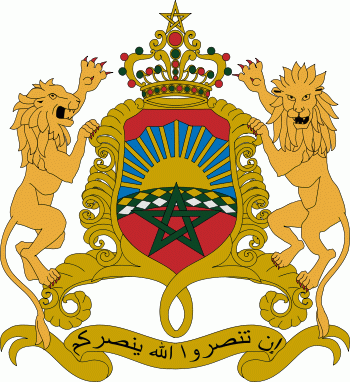
Grenade a accueilli les 6 et 7 mars le premier sommet
UE-Maroc. En marge de la réunion, Madrid n'avait pas manqué d'agiter
son étendard féministe, ouvrant un séminaire traitant des
« questions liées au genre [sic] au niveau local au Maroc et
en Espagne ».
Selon la déclaration conjointe adoptée à son issue,
« le sommet couronne une intense période d'accélération dans
les relations UE-Maroc, initiée par l'entrée en vigueur de l'Accord
d'association en mars 2000, renforcée par la mise en place du Plan
d'action, dans le cadre de la Politique européenne de voisinage, en
juillet 2005 et par l'adoption du document conjoint sur le Statut
avancé lors du Conseil d'association d'octobre 2008 ».
Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de mettre en
place, à terme, un espace économique commun. Cela implique, entre
autres, « le rapprochement du cadre législatif du Maroc à
l'acquis communautaire » et « la conclusion d'un
Accord de libre échange global et approfondi ». Une approche
« globale et équilibrée » des migrations, incluant
« une coopération pour le retour et la réadmission des
migrants en situation irrégulière », devrait en outre
constituer « un élément fondamental » du partenariat
entre l'UE et le Maroc.
Lequel aurait déjà réalisé un effort de réformes majeur, selon
Angel Lossada, le secrétaire d'État espagnol aux Affaires étrangères.
L'UE y répondrait en faisant de Rabat le plus grand bénéficiaire d'aide
du programme de voisinage. L'objectif serait de « partager, à
l'avenir, tout sauf les institutions ».
Publié dans Europe | 1 commentaire | Lien permanent
18 mars 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelques nouvelles sur le SEAE et la défense européenne.

Les quolibets cesseraient-ils de pleuvoir ? Le
Gymnich de Cordoue (réunion informelle des ministres des Affaires
étrangères), les 5 et 6 mars, a donné lieu à quelques signes
de soutien à Mme Catherine Ashton, Haut Représentant de
l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de
sécurité. Auparavant, celle-ci avait rencontré à Paris Hervé Morin –
lequel avait raillé publiquement son absence à la réunion informelle
des ministres de la Défense... Sans doute l'heure n'est-elle plus à
l'échange de phrases assassines, tandis que s'intensifient
vraisemblablement les négociations censées définir l'architecture du
Service européen pour l'Action extérieure (SEAE).
Diplomatie féministe
Un projet doit être présenté par Mme Ashton d'ici la
fin du mois d'avril. S'exprimant devant le Parlement européen le
mercredi 10 mars, le Haut Représentant a prétendu se
distinguer des sceptiques et autres réfractaires qui
« préfèrent minimiser les pertes apparentes plutôt que de
maximiser les gains collectifs ». La Britannique a annoncé,
par ailleurs, que le SEAE serait représentatif de l'Union quant à la
géographie et... l'égalité des sexes. « C'est la seule façon
acceptable de procéder », a-t-elle même affirmé.
Le 4 mars, le ministre britannique des Affaires
étrangères, David Miliband, et son homologue suédois, Carl Bildt,
avaient publié « une lettre ouverte exprimant leurs
inquiétudes face à certaines querelles interinstitutionnelles
évidentes », selon le résumé d'Euractiv (08/03/2010).
Bien que le traité de Lisbonne ait été signé le 13 décembre
2007, on ignore encore quelles responsabilités seront retirées à la
Commission. Les deux ministres estiment « qu'une
nouvelle culture pourrait être l'aspect le plus difficile à développer
pour le SEAE ». Un enjeu souligné par notre confrère Nicolas
Gros-Verheyde : « Entre civils et militaires, entre
fonctionnaires de la Commission – soumis à une forte hiérarchie et
davantage orientés vers la gestion de programme – et ceux du Conseil
– plus petite organisation, habituée à une hiérarchie courte
et plus politique, sans compter les diplomates nationaux, il y a aussi
un abîme et des cultures fort différentes qu'il va falloir marier, avec
harmonie. » (Bruxelles 2,
05/03/2010)
Flotte aérienne militaire
Pour seconder le Haut Représentant, la France aurait présenté
au poste de secrétaire général la candidature de Pierre Vimont, actuel
ambassadeur à Washington, ancien directeur de cabinet de Michel Barnier
puis de Philippe Douste-Blazy lors de leur passage au quai d'Orsay.
Signalons enfin la création imminente d'un commandement
européen du transport aérien (EATC pour European Airlift Transport
Command) entre la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas.
Selon les explications du ministère de la Défense, « il aura
pour mission de coordonner l'emploi des avions de transport militaires
des quatre nations membres, afin d'harmoniser leur planification. Cette
organisation permettra d'optimiser la rationalisation des coûts pour
l'acheminement du personnel et du fret par voie aérienne militaire.
[...] Lorsqu'une des nations membres dispose d'une capacité de
transport disponible, elle la propose aux autres nations. À l'inverse,
si elle est confrontée à un besoin urgent, elle peut solliciter les
moyens des partenaires. » C'est un pas significatif vers la
mutualisation des moyens militaires, dont la crise rend la tentation
d'autant plus pressante.
Publié dans Défense, Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
18 mars 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Les initiatives en faveur de l'éducation se sont multipliées
dans les "quartiers sensibles". Mais cela s'est fait de façon éparse,
sans que les pouvoirs publics soient en mesure d'évaluer l'incidence
des efforts consentis.

La loi d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine du 1er août 2003 avait inscrit l'éducation
parmi les orientations prioritaires de la politique de la ville. Aussi
la commission des Finances du Sénat s'est-elle interrogée sur
« l'émergence d'un domaine de compétences partagées »
avec l'Éducation nationale.
Prolifération
Dans un rapport publié le 2 mars, Philippe Dallier et
Gérard Longuet présentent quelques difficultés posées par « la
prolifération des interventions éducatives dans les quartiers
sensibles » : « méconnaissance des
dispositifs, effets de concurrence ou de redondance entre les
dispositifs, difficultés de coordination entre des intervenants
nombreux qui ne peuvent de surcroît agir que dans un laps de temps par
définition limité ».
Entre autres opérations censées contribuer « à
l'insertion sociale et à la prévention de l'exclusion, à l'éducation à
la citoyenneté et à l'environnement, mais également pour une part à la
prévention de la délinquance et à l'amélioration de la tranquillité
publique » : les Internats d'excellence ;
les Projets de réussite éducative, offrant un accompagnement
« sur toutes les dimensions » (scolarité, santé,
éducation, culture, sports...) ; les Écoles de la deuxième
chance, qui visent l'insertion professionnelle de jeunes sans diplôme
ou qualification ; le parrainage de lycéens par des étudiants
de grandes écoles ; le "busing" « destinée à "casser"
les ghettos scolaires en école élémentaire en organisant la poursuite
du cycle éducatif dans une autre école de la même
ville » ; l'École ouverte, qui consiste à ouvrir les
lycées et collèges les mercredis et samedis et pendant les vacances.
On compterait 800 000 bénéficiaires, âgés
principalement de onze à dix-huit ans. Évalué à 160 millions
d'euros, le coût de ces dispositifs apparaîtrait « sans
commune mesure avec les montants mis en place au titre de l'Éducation
nationale ». Selon la Rue de Grenelle, les établissements de
l'éducation prioritaire bénéficieraient de 15 % de moyens
supplémentaires par rapport aux établissements de droit commun.
Paradoxe
En pratique, on relève des situations paradoxales mises en
exergue par la Cour des comptes : « Les élèves sont
ainsi plus nombreux par classe (24 en moyenne) dans les écoles
primaires classées en éducation prioritaire dans l'académie de Créteil
qu'ils ne le sont dans la moyenne nationale des écoles primaires
classées hors éducation prioritaire (23,5) ! »
D'un façon générale, la déclinaison des politiques nationales
au niveau local ne serait pas réellement connue. Les parlementaires
fustigent une « approximation dans le recensement des moyens
publics » qui ne permettrait pas « de créer une
dynamique vertueuse entre la mise en œuvre de la politique, son
évaluation et l'ajustement financier et technique des actions en
fonction des résultats de performance ».
Sigles charmeurs
Tandis que la coordination « resterait tributaire de
la bonne volonté individuelle des acteurs locaux », les
pouvoirs publics paraissent réduits à faire du bricolage. « La
Cour des comptes relève que "le foisonnement et l'empilement des
dispositifs d'intervention éducative en direction des quartiers
sensibles induisent une complexité qui constitue un obstacle à
l'appropriation, et donc à l'efficacité et à l'efficience des
dispositifs". Ainsi huit configurations sont possibles selon que
l'élève est scolarisé, ou non, dans un établissement de l'éducation
prioritaire ou qu'il réside, ou non, dans le périmètre d'un CUCS
[contrat urbain de cohésion sociale] ou d'une ZUS [zone urbaine
sensible]... »
Une clarification s'impose, mais l'inertie semble de mise. La
première révision du "zonage" des quartiers bénéficiaires d'un soutien
particulier devait intervenir en 2009. « Son report témoigne
de la difficulté à entrer dans une logique évolutive qui s'écarte du
principe de la garantie des droits acquis », déplorent les
sénateurs. Dans ces conditions, « on peut douter de
l'efficacité d'un accroissement des moyens sans révision des modalités
de fonctionnement ».
Publié dans France | Pas de commentaire | Lien permanent
12 mars 2010
Un sénateur demande que la République instaure « une Journée
nationale de la laïcité et de la cohésion républicaine ».

Une
complice du député Jacques Myard sévit à la chambre haute.
Mme Sophie Joissains, sénateur des Bouches-du-Rhône, membre du
Parti radical, « demande que la République française instaure
une Journée nationale de la laïcité et de la cohésion
républicaine ». À cet effet, elle a déposé une
proposition de résolution, enregistrée à la présidence du
Sénat le 23 février.
« Force est malheureusement de constater
qu'aujourd'hui [la laïcité] est de plus en plus remise en question par
des mouvements communautaristes, corporatistes, intégristes ou
racistes », déplore-t-elle dans l'exposé des motifs.
« La France est, et doit rester, une et
indivisible », affirme-t-elle. Aussi le Sénat devrait-il
« proclamer solennellement son attachement à ce principe
constitutionnel ».
« Non fériée ni chômée », cette journée
serait fixée au 9 décembre, « date anniversaire de la
loi concernant la séparation des Églises et de l'État, du temporel et
de l'intemporel » [sic]. Elle permettrait « chaque année
de faire le point sur les différentes actions menées en la matière tant
par les ministères concernés que par les associations et les
sociétés ». Il serait même « judicieux »
qu'elle « devienne également le jour référent pour la Journée
défense et citoyenneté, reflet de l'attachement à notre pays et aux
valeurs républicaines qui sont les siennes ».
Fait remarquable, Mme Joissains a préféré
« que ce dispositif soit présenté dans le cadre d'une
résolution, conformément au souhait exprimé par la commission des Lois
du Sénat en février 2002 qui estimait que l'instauration d'une
journée nationale revêtait "un caractère plus symbolique que normatif" ».
Publié dans France | Pas de commentaire | Lien permanent
8 mars 2010
Le Conseil prétend éradiquer la violence à l'égard des femmes
dans l'Union européenne. Aperçu de ses conclusions.

En ce lundi 8 mars, décrété journée internationale de
la femme par l'Organisation des Nations unies, le Conseil a adopté des
conclusions « concernant l'éradication de la violence à
l'égard des femmes dans l'Union européenne ». Ce
document de sept pages s'inscrit dans la continuité de
l'abondante littérature consacrée à l'égalité hommes-femmes par les
institutions européennes, dont les ministres énumèrent moult références.
On relève quelques orientations concrètes :
« promouvoir l'introduction d'un numéro de téléphone commun et
gratuit [...] pour fournir des informations précises et actualisées et
une assistance aux femmes victimes de la violence » ;
« renforcer la protection des femmes victimes de la violence
lorsqu'elles exercent leur droit à la libre circulation au sein de
l'Union européenne » (des négociations sont en
cours) ; « prendre les premières mesures en vue de la
création d'un observatoire européen de la violence envers les femmes,
en s'appuyant sur les structures institutionnelles
existantes » (tel l'Institut européen pour l'égalité entre les
hommes et les femmes, fraîchement installé à Vilnius, en Lituanie).
Études et statistiques insuffisantes
« On ne dispose toujours pas de données à jour,
fiables, précises et comparables, tant au niveau national qu'au niveau
de l'UE », déplore le Conseil, « et le phénomène de
la violence à l'égard des femmes n'a toujours pas fait l'objet d'une
étude approfondie au niveau de l'UE, ce qui limite la perception que
l'on peut avoir de son ampleur véritable et empêche le développement de
stratégies et de mesures au niveau national ainsi qu'une réaction
efficace au niveau de l'UE ». En outre, il
serait « essentiel d'aborder sur un plan
international l'échange de connaissances, de méthodes et de meilleures
pratiques au sein de l'UE et avec des pays tiers ayant une certaine
expérience de la lutte contre les pratiques traditionnelles
préjudiciables (telles que les mutilations génitales féminines) et
contre la traite des êtres humains ».
Selon les ministres, « la lutte contre la violence à
l'égard des femmes passe par une participation active des hommes,
permettant de remettre en cause les idées reçues et les rôles dévolus
aux hommes et aux femmes afin de promouvoir des relations basées sur le
respect, l'égalité et les valeurs démocratiques ». Aussi
invitent-ils la Commission et les États membres à « réaliser
des campagnes de sensibilisation, d'éducation et de formation pour
lutter contre des normes culturelles discriminatoires et venir à bout
des stéréotypes sexistes très répandus et de la stigmatisation sociale
qui légitiment et perpétuent la violence à l'égard des
femmes ».
Manifestement, le Conseil exclut l'hypothèse selon laquelle la
violence masculine serait le « corollaire tragique et
inexcusable » de la « dévaluation de la
virilité » – thèse qui serait vraisemblablement celle
Mme Claude Habib. « Face à la multiplication des
viols, au développement des violences conjugales, à la perte du respect
dû aux femmes par des hommes déboussolés, qui semblent répondre par la
brutalité ou le mépris à l'agression symbolique du féminisme, elle veut
croire à un sursaut de cette générosité virile qui est au fond
l'essence de la galanterie », rapporte
Stéphane Blanchonnet. « Retrouver les voies de
l'apaisement, de l'amour et de la confiance entre les hommes et les
femmes, c'est d'abord cesser de dénier aux hommes leur rôle de
protecteurs naturels, rôle qu'ils souhaitent jouer spontanément à
l'égard de leur compagne mais qui est constamment moqué, tourné en
dérision, ringardisé (comme tout ce qui rappelle les différences, les
inégalités, les traditions) dans le discours médiatique, la fiction
télévisuelle ou la publicité. » Ainsi que dans les arcanes
européens.
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent
7 mars 2010
Nouveau pas vers la maîtrise de la fusion nucléaire, la mise
en œuvre du projet ITER s'inscrit dans un cadre juridique
original : contrairement à de nombreux réacteurs de recherche
internationaux, ITER sera considéré comme une "installation nucléaire
de base", dénomination recouvrant l'ensemble des centrales nucléaires
en activité en France.
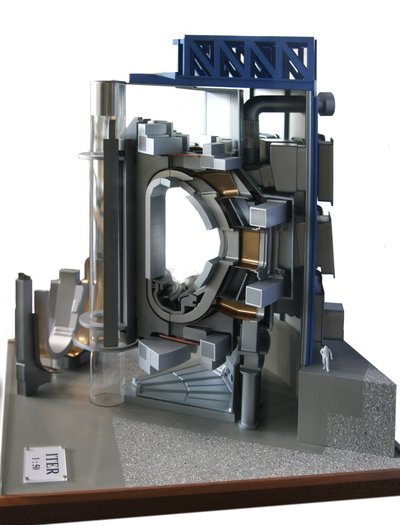
La chambre basse est saisie d'un projet de loi, adopté par le
Sénat, autorisant l'approbation d'un protocole « relatif au
rôle de l'inspection du travail sur le site de l'Organisation
internationale ITER et portant sur la santé et la sécurité au
travail ». Ce projet serait « l'un des plus
prometteurs pour l'avenir de l'énergie nucléaire » selon
Michel Destot, auteur d'un rapport
enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le
24 février. La construction, dans les Bouches-du-Rhône, de
l'International thermonuclear experimental reactor devrait permettre
des avancées significatives vers la maîtrise de la fusion nucléaire.
Les avantages de la fusion
« Les deux principales réactions nucléaires
permettant de produire de l'énergie sont la fission d'un noyau
atomique, et la fusion de deux noyaux », rappelle le
député-maire de Grenoble. « La réaction de fission est à
l'origine des premiers réacteurs nucléaires, et reste le seul processus
nucléaire actuellement utilisé pour produire industriellement de
l'électricité. Bien que plus difficile à provoquer et entretenir
artificiellement, la fusion nucléaire possède trois avantages
considérables sur la fission. En premier lieu, elle ne produit pas de
déchets radioactifs à haute radioactivité et à vie longue. [...] En
second lieu, la fusion recourt à des matières premières bien plus
abondantes que l'uranium ou le plutonium requis par les centrales à
fission actuelles. Théoriquement, la fusion de deutérium et d'hélium
est même un procédé permettant de créer de l'énergie sans limite, le
deutérium étant très abondant dans la nature. En pratique, les moyens
technologiques disponibles impliquent l'utilisation de tritium, extrait
du lithium, dont les ressources sont finies, mais sans commune mesure
avec celles actuellement disponibles pour l'uranium naturel. Enfin, la
fusion nucléaire permet, avec peu de matières premières, de produire
une quantité très importante d'énergie. On estime que la réaction de
fusion génère au moins quatre fois plus d'énergie par atome que la
réaction de fission. »
Ces perspectives justifient les investissements
consentis : 10 milliards d'euros sur quarante-cinq
ans. Lancé dès 1985 par Mikhaïl Gorbatchev, le projet ITER bénéficie de
l'implication de sept parties – l'Europe, la Chine, la Corée du Sud,
les États-Unis, l'Inde, le Japon et la Russie – dont la majorité des
contributions à la construction du réacteur seront fournies en nature.
« Afin de faire pencher la balance en faveur du site français
de Cadarache, soutenu par l'ensemble de l'Union européenne, celle-ci
accepta de prendre en charge une part importante des frais de
construction d'ITER (45,46 % contre environ 9,09 %
pour les autres) », poursuit le parlementaire. « La
contribution européenne est fournie par l'intermédiaire d'une agence
implantée à Barcelone, baptisée "F4E" (Fusion for energy), dotée d'un
budget de 4 milliards d'euros pour les dix premières années du
projet ITER. »
Forte implication française
« En plus de sa participation au financement de F4E,
la France assume également un certain nombre de charges financières au
titre d'État d'accueil. [...] L'ensemble des contributions françaises à
ITER est estimé à 871,5 millions d'euros, auxquels s'ajoutent
l'aménagement des voies d'accès au site de Cadarache et la construction
d'un lycée international à Manosque pour accueillir les enfants des
personnels de l'organisation ITER. » Des retombées économiques
positives sont escomptées à court terme : « L'arrivée
de 400 fonctionnaires internationaux, et les nombreux
chantiers qui seront lancés dans le cadre du projet, [devraient]
générer environ 3 000 emplois indirects pendant la
construction du réacteur, et 3 200 une fois celui-ci en état
de fonctionner. D'ores et déjà, les entreprises françaises se sont vues
attribuer 230 millions d'euros de contrats. »
« Ce réacteur de recherche est soumis aux mêmes
obligations de transparence et de sûreté que n'importe quelle centrale
électronucléaire sur notre territoire », souligne le
rapporteur. En effet, toutes les parties auraient convenu
« qu'il n'était pas pensable d'entretenir un soupçon d'opacité
pour un programme aussi important. C'est pourquoi l'applicabilité des
règles nationales régissant les activités nucléaires a été prévue dès
l'origine. » En conséquence, l'Autorité de sûreté nucléaire
sera autorisée à effectuer des contrôles sur le site. C'est une
première exception au regard du droit commun des organisations
internationales tel que prévu par la convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques de 1961. « Une deuxième série
d'exceptions est prévue, qui fait l'objet du présent protocole
additionnel. [...] L'accord du 7 novembre 2007 prévoit, à ses
articles 3 et 17, que l'inspection du travail peut contrôler le respect
par ITER des règles nationales en matière de santé et de sécurité au
travail. La signature d'un accord entièrement consacré à ce thème était
imposée par ce même article. »
Cela favorisera « l'acceptabilité par la population
d'un programme de recherche qui suscite un important espoir »
selon M. Destot, qui invite naturellement la commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée à adopter ce projet de loi.
Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaire | Lien permanent
5 mars 2010
Une "mission exploratoire" s'est rendue en
Polynésie française du 31 octobre au 6 novembre 2009.
Elle portait sur la création d'une agence d'urbanisme et la
redynamisation de sites de défense. Son
rapport a été publié par la Documentation française le
23 février. En voici un aperçu.

« Le modèle de développement de Tahiti [...] serait
proche d'une rupture », affirment Patrick Albrecht, Patrick
Cunin et François Wellhoff. Leur constat semble alarmant :
« L'île regroupe plus des trois quarts de la population
polynésienne sur une bande étroite entre la mer et la montagne. La
croissance démographique a été soutenue, due à un taux de natalité
élevé et à une migration depuis les autres archipels. Il en résulte une
urbanisation désordonnée et proliférante de l'ensemble de la plaine
côtière autour de Papeete, fruit d'un aménagement privé d'opportunités
foncières. Alors que les besoins fonciers restent forts, l'urbanisation
a atteint ses limites : étalement urbain y compris sur les
piémonts, asphyxie de la circulation automobile, quartiers d'habitat
insalubre, absence de réseaux collectifs d'assainissement... Une
difficulté supplémentaire pour la Polynésie est son étendue,
équivalente à celle de l'Europe. L'accès aux soixante-seize îles
habitées est problématique. La majorité des archipels n'ont pas de
réseau d'eau potable ni d'assainissement, l'habitat y est sans confort,
les zones agricoles ne sont pas équipées. »
Dans ce contexte, alors que la fréquentation touristique
aurait chuté d'un quart en 2009, une réduction de moitié des
effectifs militaires stationnés en Polynésie est programmée. Cela n'ira
pas sans conséquences économiques et sociales, préviennent les
rapporteurs. qui ont reçu les maires des six principales communes
affectées par les restructurations : Faa'a, Papeete, Pirae,
Arue, Mahina et Taiarapu-Est. Lesquels auraient des opportunités à
saisir. En effet, la « densification des sites
militaires » permet d'envisager la cession d'une vingtaine
d'hectares sur Tahiti à partir de 2011. Or, « le maire de
Mahina attend depuis fin 2007 un accord formel du ministère de la
Défense pour réaliser une station d'épuration communale ».
Plus généralement, de nouvelles voies s'ouvrent ainsi au développement
économique.
Reste à mettre en place la "gouvernance" adéquate.
« La récente instabilité politique du Pays n'a pas été
favorable à la mise en perspective des projets et a créé un obstacle à
la continuité de l'action publique », déplorent les
rapporteurs. « Pourtant dépasser le court terme est
indispensable pour affronter la triple crise économique, sociale et
écologique (pollutions) qui menace l'avenir de ce "paradis
terrestre". » Cela suppose « un fort partenariat
entre les responsables du Pays (défenseurs, vis-à-vis de l'État, de
leur large autonomie), les élus communaux (détenteurs de peu de leviers
d'intervention mais proches de leurs concitoyens) et l'Etat représenté
par le Haut-Commissariat ».
Saluant une « nouvelle volonté de
coopération », la mission se veut optimiste. Mais il ne faudra
pas décevoir, « car un échec des dispositifs envisagés
alimenterait une fois de plus le scepticisme des acteurs publics et des
citoyens sur la possibilité de mener en Polynésie des démarches
durables ». Affaire à suivre.
Publié dans Outre-mer | Pas de commentaire | Lien permanent
4 mars 2010
Madrid continue d'agiter son étendard féministe sur la scène
internationale.

« Les droits de la femme et la lutte contre la
violence à caractère sexiste » sont « au centre des
activités des Nations Unies cette semaine », a annoncé la
présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne.
Devant la commission de l'ONU sur la condition juridique et
sociale de la femme, le ministre espagnol de l'Égalité « a
réitéré ce lundi [...], au nom de l'UE, l'engagement des États membres
envers la déclaration et la plateforme d'action de Pékin, à l'occasion
de son quinzième anniversaire. [...] Mme Aído a de plus
affirmé qu'"il est urgent d'entreprendre de nouvelles actions" afin de
répondre aux besoins des jeunes filles et des femmes après des conflits
armés et a jugé "essentiel" [...] d'élargir l'accès à l'information sur
la santé sexuelle et reproductive. » Signalons au passage que
l'ONU s'apprête à regrouper, sous la houlette d'une direction commune,
ses différentes composantes censées œuvrer en faveur de l'égalité
hommes-femmes.
Dès demain, Madrid réaffirmera son volontarisme féministe par
la voix de Miguel Lorente, délégué du gouvernement espagnol en charge
des questions liées à la violence sexiste. En marge du premier sommet
UE-Maroc, celui-ci doit ouvrir un séminaire de deux jours portant sur
les sujets suivants : « genre et participation politique à
l’échelle locale » ; « questions liées au
genre au niveau local au Maroc et en Espagne » ;
« perspectives d’intégration de l’égalité des sexes dans les politiques
publiques locales ».
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | 1 commentaire | Lien permanent
4 mars 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Les propositions de loi présentées à l'Assemblée nationale
revêtent parfois un caractère insolite.

Parmi les textes enregistrés le 24 janvier à la
présidence de la chambre basse, on remarque celui signé par Lionel
Lucas et treize autres députés, « visant à modifier le statut
juridique du cheval en le faisant passer d'animal de rente à animal de
compagnie ». À ce jour, déplorent les parlementaires, le
cheval est « toujours assimilé à un animal de rente dont le
destin final est l'abattoir ».
Jean-Claude Bouchet, Jacques Remiller et Bernard Reynès, quant
à eux, voudraient « valoriser la qualité et l'origine des
fruits et légumes produits sur le territoire national ». À cet
effet, ils proposent « d'introduire l'obligation d'apposer une
pastille autocollante tricolore sur tous les fruits et légumes produits
sur le territoire national ».
Contre l'obésité
Prenant les citoyens par la main, un groupe de députés affirme
que « dans un contexte d'accroissement de l'obésité en France,
l'éducation à la nutrition et à l'alimentation dans les établissements
d'enseignement des premier et second degrés paraît plus que jamais
nécessaire ».
Un autre promeut « l'installation de distributeurs
automatiques de produits sains dans les lieux publics et les
entreprises ». Selon ces parlementaires, « rendre
indissociable l'installation de distributeurs automatiques de produits
de "snacking" de l'installation de distributeurs de produits sains est
un moyen de permettre aux consommateurs de ne pas uniquement avoir
accès à des produits qui peuvent contribuer au déséquilibre
alimentaire. [...] Cette proposition de loi prévoit que toute
administration publique, toute entreprise publique ou privée doit
installer des distributeurs automatiques de fruits et légumes ou de
boissons non sucrées là où existent déjà des distributeurs automatiques
de boissons sucrées et de produits alimentaires à forte teneur en
sucre, en sel ou en matière grasse. »
Intentions louables, dont on se demande toutefois si
la poursuite ne contribue pas à entretenir l'obésité de l'État – qui se
mêle de tout – et les lourdeurs administratives.
Publié dans France | Pas de commentaire | Lien permanent
4 mars 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Le congé maternité en débat au Parlement européen.

L'UE s'achemine vers l'allongement de la durée minimale du
congé de maternité. La Commission européenne avait proposé qu'elle soit
portée de quatorze à dix-huit semaines (contre seize en France). Un
progrès jugé insuffisant par la commission des Droits de la femme du
Parlement européen, qui s'est prononcée le mardi 23 février
pour une durée minimale de vingt semaines. Par dix-neuf voix pour,
treize contre et une abstention, elle a adopté le rapport sur la santé
et la sécurité des travailleuses enceintes rédigé par la Portugaise
Edite Estrela, membre du groupe de l'Alliance progressiste des
Socialistes et Démocrates (S&D).
En vertu de la directive actuellement en vigueur, les femmes
sont déjà tenues de prendre deux semaines de repos, avant ou après
l'accouchement. Le projet de révision imposerait six semaines après la
naissance de l'enfant, dont l'allaitement se trouverait ainsi facilité.
Dans un communiqué, le Parlement européen souligne que « les
États membres devraient encourager l'octroi de congé dans cette
perspective ». Selon la commission parlementaire, ils
devraient également « veiller à ce que les pères soient
habilités à prendre un congé de paternité entièrement payé d'au moins
deux semaines » (onze jours dans l'Hexagone).
Cela tranche avec le féminisme auquel nous avaient habitués
les arcanes européens. Le secrétaire national de l'UMP s'en est
ému : selon Philippe Juvin, ces propositions
« stigmatisent les femmes dans leur rôle de mère. Ce texte
n'est que l'aboutissement d'un lobbying des
intégristes de tout crin et ne permettra pas de promouvoir
l'émancipation des femmes dans nos sociétés ». « Avec
le rapport Estrela, ajoute-t-il, la gauche réenferme la femme dans le
modèle opprimant de la maternité exclusive. »
Que la "droite" se rassure : rien n'est encore joué.
Le 25 mars, les députés seront appelés à s'exprimer en session
plénière. Il faudra ensuite solliciter l'accord du Conseil des
ministres, où la Grande-Bretagne affichera vraisemblablement ses
réticences. « La directive devrait mettre en place des
standards minimum au niveau européen pour la santé et la sécurité des
femmes enceintes et ne pas ajouter de coûts supplémentaires sur la
feuille de paye pour les entreprises déjà surtaxées et les systèmes de
santé nationaux », a indiqué le directeur de la chambre de
commerce britannique cité par AP (Euractiv,
26/02/2010).
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent