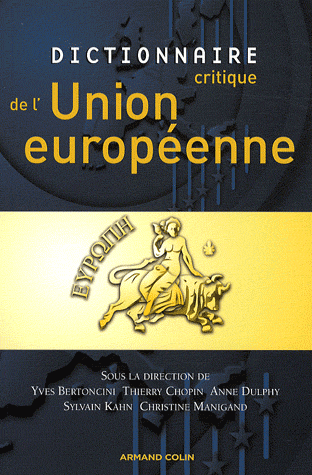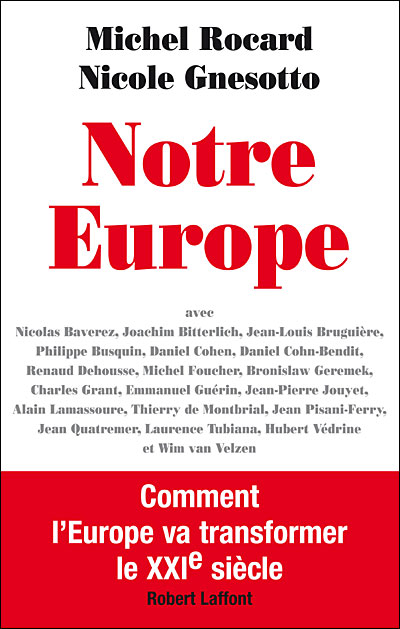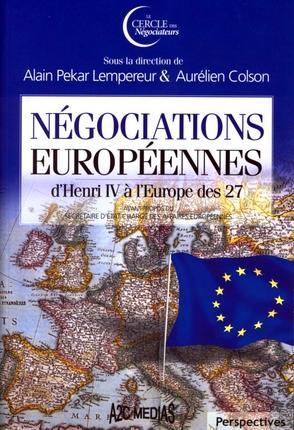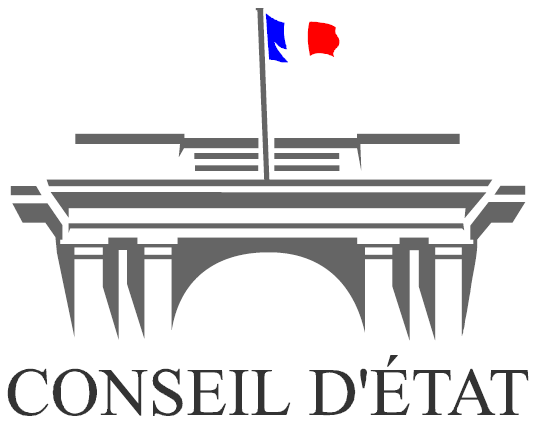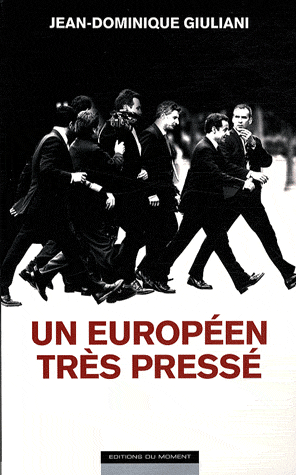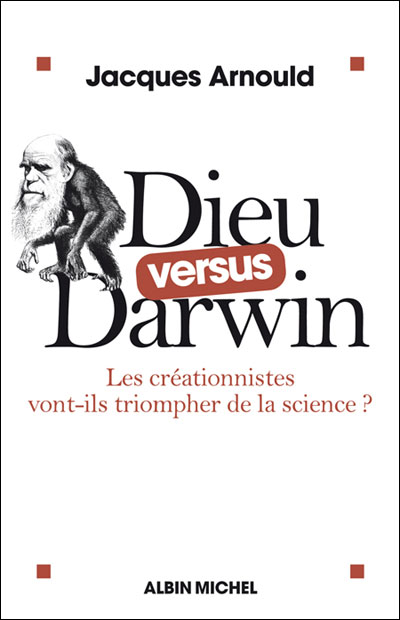20 novembre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Europe présentée à travers 236 notes synthétiques.
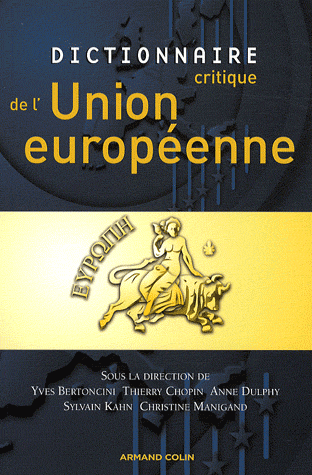
Les éditions Armand Colin ont publié le mois dernier un Dictionnaire
critique de l'Union européenne dont la lecture distille
mises au point historiques (voire historiographiques), juridiques
(arrêts déterminants de la Cour de Justice), politiques (présentation
des mouvements "pro-européens") ou théoriques (analyse fonctionnaliste
ou intergouvernementaliste de l'intégration européenne), ainsi que
quelques chiffres significatifs : par exemple, selon l'estimation
d'Yves Bertoncini, le droit communautaire dérivé représenterait 10 à 20 % de l'ensemble du droit en vigueur en France.
Au fil des 493 pages, écrites selon "l'esprit du temps", on
pourra discuter certains jugements, mais le caractère "universitaire"
de l'ouvrage le préserve des inepties politiciennes les plus désolantes
; l'article consacré au souverainisme, présenté par Justine Lacroix
comme « une identification de la nation à la démocratie » - plus
généralement au politique, diraient les souverainistes d'AF - témoigne
d'une relative impartialité.
Inévitablement, on sera frustré par les questions laissées
apparemment en suspens, comme le bilan économique du marché commun ou
les enjeux géopolitiques de la candidature d'Ankara... Ces 236 notes
synthétiques, complétées par des cartes et une chronologie, apportent
néanmoins un éclairage appréciable sur différentes facettes de l'UE,
faisant de ce dictionnaire un compagnon utile – quoique un peu coûteux
(39,50 euros) - au profane décidé à se documenter peu à peu sur le
"machin" européen.
Publié dans Europe, Livres | Pas de commentaire | Lien permanent
2 octobre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
De Daniel Cohn-Bendit à Hubert Védrine, vingt et une personnalités s'expriment sur la construction européenne.
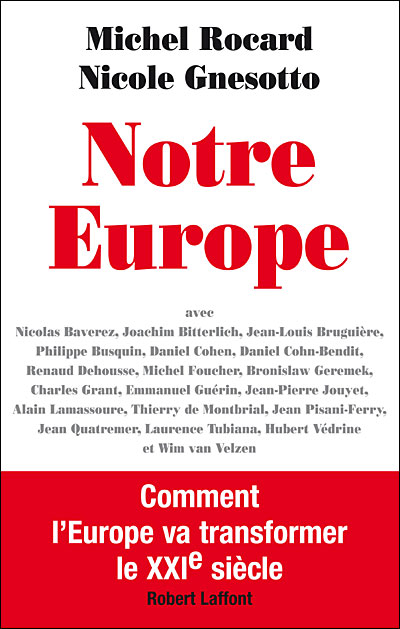
Un ouvrage paru en septembre, dirigé par Michel Rocard et
Nicole Gnesotto, rassemble les contributions de personnalités
éclectiques censées « rendre à Bruxelles ce qui revient à Bruxelles »
et « appréhender la construction européenne [...] comme une réalité
vivante ».
"Réalisme"
On y relève moult banalités. Ainsi Michel Rocard affirme-t-il
que « l'édification d'une institution commune [...] a comme résultat
majeur la réconciliation et la paix ». Une ineptie à laquelle Hubert
Védrine apporte un démenti cinglant : « Ce n'est pas
l'intégration de l'Europe de l'Ouest qui va l'empêcher [la guerre],
mais l'équilibre des forces [...] de l'OTAN et du Pacte de Varsovie...
»
Fidèle à son "réalisme", constatant la difficulté de conclure
un accord à vingt-sept, l'ancien ministre des Affaires étrangères
estime qu'on arrive « au point ultime de l'intégration politique pour
l'Europe dans son ensemble ». Il ne cache pas son relatif
euroscepticisme : s'appuyant sur des textes juridiques, « certains ont
attendu la naissance presque miraculeuse d'une politique étrangère
européenne. [...] Mais on le voit bien : cela ne conduira pas à une
politique étrangère européenne unique... » Appelant les Européens à «
dépasser l'irrealpolitik », caractérisée par « une fatigue historique
[...], une aspiration helvétique à une grande Suisse à l'abri des
turbulences de la mondialisation » - y compris chez certains
nationalistes, serions-nous tentés d'ajouter ! -, il plaide pour
l'autonomisation progressive des Européens au sein d'un pôle
occidental. Il se démarque ainsi de l'"esbroufe gaulliste" stigmatisée
implicitement par Thierry de Montbrial, et se montre bienveillant à
l'égard du président de la République, dont la politique pourrait être,
selon lui, le levier de cette transformation. Affaire à suivre.
Ultimes frontières
Dans l'immédiat, Michel Foucher lève le voile sur un « secret
de polichinelle », celui des frontières ultimes de l'UE : « Dans le
scénario d'expansion au fil de l'eau que Washington nourrit, celui qui
a effectivement cours, l'Union devra s'étendre à l'ensemble des États
membres du Conseil de l'Europe, à la seule exception de la Russie, mais
la Turquie incluse. » Dans ces conditions, sans identité
forte, quid de l'Europe politique ? Loin d'en entretenir l'illusion, la
plupart des auteurs parient plutôt sur la puissance de l'"empire
normatif". Renaud Dehousse en révèle une vision plus "morale" que
politique : il salue cette Europe ayant « dépassé le stade primitif où
les rapports entre États sont avant tout des rapports de force ».
Quitte à s'intéresser aux critiques de la realpolitik,
on préférera les analyses de Zaki Laïdi, beaucoup plus fouillées.
Jean Quatremer prétend briser un mythe, celui des 60 % de lois
d'émanation communautaire. « Le raisonnement en termes de pourcentage
est délicat, observe-t-il : le droit ne se prête guère à ce genre de
pesée. » Se livrant à son propre calcul, il estime néanmoins que ce
sont « seulement 25 % des lois adoptées en 2007 qui étaient d'origine
européenne ». De son point de vue, « tout ne se décide pas à Bruxelles,
[...] loin s'en faut ». Le sujet – controversé – aurait mérité de plus
amples développements. Le journaliste se veut catégorique : « Les États
sont non seulement à l'origine des traités par lesquels ils décident
d'exercer en commun leur souveraineté, mais ils en contrôlent à chaque
instant l'application. Ils sont aux deux bouts de la chaîne et décident
donc toujours en dernier ressort. » C'est oublier l'influence de la
Cour de Luxembourg, dont Renaud Dehousse rappelle que les juges « loin
de s'en tenir à l'intention [...] des parties contractantes [...], se
sont abondamment inspirés des objectifs ultimes de l'intégration,
énoncés de façon générale dans le préambule du traité de Rome ».
Le pragmatisme de Jean-Louis Bruguière tranche avec
l'idéologie inspirant bien des contributions. Tout en promouvant le
mandat d'arrêt européen, il s'insurge contre certaines dérives : « Une
coopération bien gérée est un facteur d'efficacité. Mais vouloir aller
trop vite ou négliger, dans une démarche politique ou doctrinaire, des
réalités opérationnelles peut avoir l'effet inverse de celui recherché.
C'est ce qui se passe [...] avec les tentatives d'intégration du
renseignement. Celui-ci ne se partage que dans une situation donnée et
dans une démarche bilatérale... »
Basses attaques
Daniel Cohn-Bendit se distingue par une intervention rédigée
sur un ton plus "politicien", où il attaque notamment le souverainisme
: une « nécrose », dont les « poussées xénophobes » ne seraient pas «
les moindres dégâts » ; par-delà la basse polémique, on relève cette
observation de bon sens : « La souveraineté demeure une
coquille vide sans l'efficience de l'action politique. »
Au final, on s'interroge sur le public auquel s'adresse un tel
ouvrage. Parfois rébarbatif et redondant, il ne présente pas de "vertus
pédagogiques" manifestes, véhicule des lieux communs sans franchement
ouvrir le débat, et présente des analyses trop superficielles pour
satisfaire un lecteur averti. On y trouvera éventuellement
une introduction à d'autres études traitant plus spécifiquement de tel
ou tel aspect de la construction européenne, à lire avec un regard
critique.
Sous la direction de Michel Rocard et Nicole Gnesotto : Notre
Europe ; Robert Laffont, 394 p., 22 euros.
Publié dans Europe, Livres | Pas de commentaire | Lien permanent
4 septembre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
Aperçu d'un ouvrage traitant des négociations européennes d'Henri IV à l'Europe des Vingt-Sept.
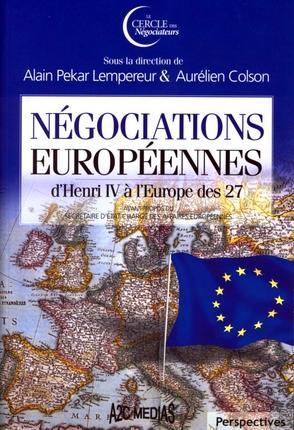
Comment les négociations internationales ont-elles été menées
en Europe depuis le XVIIe siècle ? La question a fait l'objet
d'un ouvrage collectif paru en avril dernier.
La première partie est historique. On y rencontre d'abord Jean
Hotman de Villiers, qui est, en 1603, le premier à disserter en
français sur La charge et la dignité de l'ambassadeur ; «
composé par un homme [...] dont la science et l'érudition sont
fortement imprégnées par l'esprit de la Renaissance et les références à
l'Antiquité, [ce traité] n'en est pas moins en prise directe avec son
temps », dont bien des aspects sont révolus : imaginerait-on qu'un
ambassadeur s'appauvrisse aujourd'hui au service de l'État ?
Vers 1640, le cardinal de Richelieu développe dans son
Testament politique « une conception éminemment nouvelle de la
négociation », qui devient permanente, « s'ordonnant [...] en vue de la
réalisation d'un dessein plus général, ce que l'on appellera la
politique étrangère... » En 1716, François de Callières s'intéresse à
l'éloquence dans La Manière de négocier avec les souverains ; son
existence témoigne d'« une capacité rare d'alterner vie active de
diplomate et vie contemplative du penseur ». Un article publié en 1770
dans l'encyclopédie d'Yverdon est reproduit intégralement ; Barthélémy
Fortuné de Félice y souligne le poids des passions et lance quelques
piques à l'encontre de Mazarin (dont les intrigues ne feraient pas
honneur à la diplomatie française selon lui).
En 1757, dans ses Principes des négociations, Gabriel Bonnot
de Mably conteste l'aptitude du système de l'équilibre à garantir la
paix ; il juge vicieux l'ordre européen assimilant la politique à "la
chose privée des rois", et se fait l'apôtre de la transparence. La
Révolution française s'y essaiera, transformant bientôt « la
"diplomatie de la transparence" en une "diplomatie de l'arène" » ; «
détruisant sans chercher à reconstruire, l'expérience tourne au chaos
», aboutissant selon Frank Attar à « la diplomatie du vide ».
Multilatéralisme
La seconde partie traite de l'« actualité de la négociation,
de la souveraineté française au consensus européen », esquissant
quelques comparaisons avec les siècles passés. Marie-Christine Kessler
identifie des vecteurs de stabilité : « En France [...], il y a eu très
vite une institutionnalisation et une professionnalisation du métier de
diplomate. » Mais l'influence des opinions, ainsi que l'émergence du
multilatéralisme, ont bouleversé la donne. Des contributions évoquent
la représentation permanente de la France aux Nations Unies – dont le
Conseil de Sécurité se réunit tous les jours – et l'engagement de la
Commission européenne dans des négociations internationales. Une
expérience de « multilatéralisme au carré », selon l'expression
d'Hubert Védrine, le mandat des négociateurs européens étant lui-même
issu d'une négociation entre les États membres de l'UE. Observant les
réticences des États-Unis à l'égard d'un multilétaralisme qu'ils
avaient jadis encouragé, l'ancien ministre des Affaires étrangères
conclut ainsi sa postface : « Selon qu'il s'agit [...] d'un mouvement
conjoncturel [...] ou durable, les conséquences n'en seront pas du tout
les mêmes pour l'art de la négociation. »
En définitive, l'ouvrage semble quelque peu "bricolé".
Rassemblant des contributions inégales, il constitue moins l'« histoire
vivante de la négociation » annoncée en quatrième de couverture qu'un
aperçu des œuvres des ses théoriciens classiques, complété par quelques
considérations d'actualité. On s'agace en outre de l'inclination de
certains auteurs à dénicher dans le passé les sources supposées de leur
européisme un peu naïf... C'est une étude originale dont on regrettera
qu'elle ne tienne pas toutes ses promesses.
Sous la direction d'Alain Pekar Lempereur et Aurélien Colson :
Négociations européennes - D'Henri IV à l'Europe des 27 ;
A2C Medias, avril 2008, 284 p., 25 euros.
Publié dans Europe, Histoire, Livres | Pas de commentaire | Lien permanent
17 juillet 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
Le Conseil d'État confirme le refus d'accorder la nationalité française à une Marocaine adepte d'un islam trop radical.
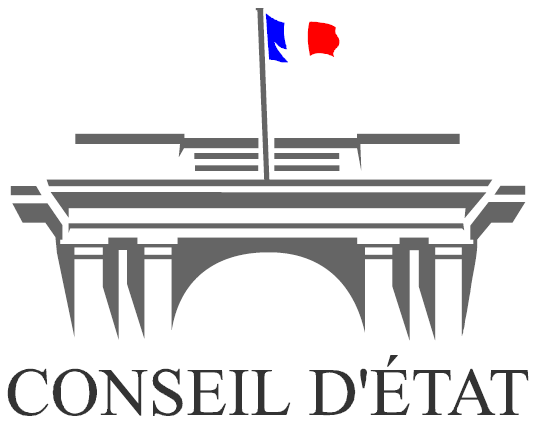
Mme Fazia M. a trente-deux ans. Elle est mariée à un Français et mère
de trois enfants. En dépit de sa maîtrise de la langue, le 16 mai 2005,
le gouvernement s'est opposé par décret à sa naturalisation, arguant,
conformément au Code civil, d'un « défaut d'assimilation ». À juste
titre selon le Conseil d'État, dont la décision du 27 juin a été
révélée par Le Monde vendredi dernier.
La presse a monté en épingle le port de la burqa, dont le juge
administratif aurait proclamé l'incompatibilité avec l'obtention de la
nationalité française. Mais le verdict n'y fait aucune mention. Il
stipule que la requérante a « adopté une pratique radicale de sa
religion, incompatible avec les valeurs essentielles de la communauté
française, et notamment avec le principe d'égalité des sexes ;
qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'assimilation ».
Effectivement, Fazia M. ne cache pas les attaches salafistes de son
foyer, où elle vivrait « presque recluse » selon le commissaire du
gouvernement cité par Le Monde. On s'interroge sur l'objectivité des
motifs invoqués. Sans doute est-il impossible d'échapper tout à fait à
l'arbitraire en la matière... D'autant qu'une législation tatillonne
instaurerait une véritable "idéologie d'État". Il appartient à
l'exécutif de faire bon usage de son pouvoir discrétionnaire.
Laïcisme, islamisme, même combat !
Après l'annulation du mariage d'un couple musulman dont
l'épouse avait menti sur sa virginité, cette affaire confirme
l'évolution des "bonnes consciences médiatiques", enfin débarrassées
de leur angélisme islamophile. Faut-il s'en réjouir ? En partie
seulement, car les ressorts de cette réaction sont douteux. « La France
se doit de rester l'avant-garde du combat laïque, seul rempart contre
les dérives fanatiques dont les femmes sont les premières victimes »,
affirme l'association Ni Putes ni Soumises. Méfions-nous du laïcisme,
dont les adeptes sont des alliés objectifs des islamistes, tant ils
sont prompts à fouler aux pieds notre identité nationale – influencée
certes par deux siècles de république, mais façonnée surtout par plus
d'un millénaire de christianisme ! Quant aux slogans égalitaires
inspirés par une idéologie féministe, ils mènent à une
impasse. C'est dans la valorisation des différences qu'on enseignera à
nos petits sauvageons le respect dû aux femmes : en effet, qui voudra
leur faire croire qu'elles sont des hommes comme les autres ?
Publié dans France, Islam | Pas de commentaire | Lien permanent
3 juillet 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelles sont les grandes lignes de la politique européenne de Nicolas Sarkozy ? Jean-Dominique Giuliani – président de la Fondation Robert Schuman – tente de les identifier dans un ouvrage publié en mai dernier, où il brosse le portrait d'« un Européen très pressé ».
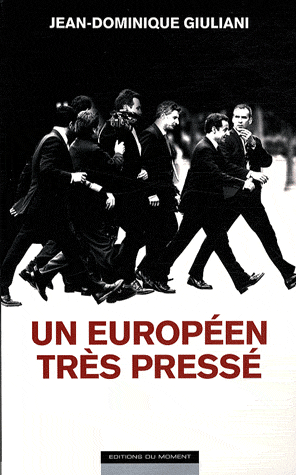
L'auteur souligne l'importance – relative, certes, mais
inédite – que le candidat Sarkozy avait accordée à la construction
européenne pendant sa campagne, annonçant la négociation du traité de
Lisbonne et sa ratification par voie parlementaire. Un choix «
courageux » selon Jean-Dominique Giuliani, mais qui nous paraît
finalement peu coûteux, étant donné l'indifférence de nos concitoyens.
Ont-ils été abusés par l'esbroufe présidentielle ? En tout cas, le
numéro d'équilibriste de Nicolas Sarkozy semble avoir touché son public
: nuancés par un zeste d'euroscepticisme, ses discours ont rassuré les
nonistes, ouvrant la voie au "retour de la France en Europe" proclamé
le soir de sa victoire électorale.
Symboles
Dès son entrée en fonction, le chef de l'État multiplie les
symboles, « comme autant de gestes en direction de l'Union européenne »
: pour sa photographie officielle, par exemple, il pose devant la
bannière bleue étoilée. Jean-Dominique Giuliani revient sur la façon
parfois houleuse dont se sont nouées les relations avec Angela Merkel.
En dépit d'une main tendue au Royaume-Uni, la collaboration privilégiée
avec l'Allemagne serait « inévitable » de toute façon... Une
observation tout juste étayée par quelques considérations économiques.
Le lecteur avide d'analyses géopolitiques pointues passera son chemin.
Retour à l'Est
L'auteur signale toute l'importance que le Président accorde à
la Méditerranée, mais insiste aussi sur ses efforts visant à resserrer
les liens avec les pays de de l'Europe de l'Est, vilipendés par Jacques
Chirac à la veille de leur entrée dans l'Union. Le rapatriement des
infirmières bulgares retenues en Libye, orchestré triomphalement par
Nicolas Sarkozy, aurait largement contribué au succès de son
entreprise. Le « passage obligé » par Washington rassure également les
États fraîchement libérés du joug soviétique. L'objectif est clair : le
président de la République espère développer un pôle de sécurité
européen, et, plus généralement, conférer à l'UE le rôle d'un véritable
acteur politique.
En matière économique et monétaire, son ambition de
"repolitiser" l'Europe apparaît manifeste. Ainsi a-t-il réclamé un
assouplissement de la politique de concurrence – nécessaire à la
préservation de nos intérêts industriels –, ou une réaction face à la
menace des fonds souverains. Ses homologues sont disposés à le suivre
sur ce point. En revanche, ils ne sauraient cautionner ses critiques
formulées à l'encontre de la Banque centrale européenne, qui se sont
certes assagies depuis son élection. Une fois n'est pas coutume,
Jean-Dominique Giuliani exprime ici quelque réserve, rappelant cette
évidence, vraisemblablement négligée par un politicien en campagne : «
La revendication d'un "gouvernement économique" n'a [...] de chance
d'aboutir que le jour où certains pays accepteront de se concerter
avant de prendre leurs grandes décisions économiques internes. » En
attendant, aucune alternative à l'indépendance de la BCE n'est
envisageable, à moins d'abandonner la monnaie unique évidemment.
Identité chrétienne
Telle que nous la dépeint Giuliani, l'Europe rêvée par Nicolas
Sarkozy bénéficierait d'une forte identité, inspirant la fierté de
citoyens conscients d'appartenir à une communauté de civilisation. « Il
replace le projet européen dans une perspective historique, morale et
politique, dont l'ont éloigné le temps, la bureaucratie et les
habitudes. Pour lui, l'Europe doit désormais avoir pour objectif d'être
une puissance nouvelle sur la scène internationale. À ce titre, elle a
droit à un territoire.. » Le chef de l'État veut en finir avec la fuite
en avant de l'élargissement, qui s'oppose au projet
d'approfondissement. De son point de vue, l'adhésion de la Turquie
serait une perspective d'autant moins acceptable qu'elle saperait les
fondements de l'unité européenne, brouillant les repères tant
géographiques que culturels. À l'inverse, la reconnaissance officielle
des racines chrétiennes de l'Europe lui semblerait indispensable ; leur
négation constituerait à ses yeux « une insulte à l'histoire » et même
une « faute politique ».
Un vieux fantasme
Un faute, sans doute, mais qui apparaîtrait bien minime
comparée à celle qu'il commettrait si, d'aventure, il privait la France
de son siège de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Fort heureusement, Jean-Dominique Giuliani ne lui prête pas
cette intention. Bien au contraire, il s'interroge sur son inclination
à « abandonner sa capacité à décider seul au profit d'institutions
européennes » supposées plus efficaces ; « s'il y a des contradictions
dans les discours européens de Nicolas Sarkozy, c'est ici qu'il faut
les chercher », précise-t-il. Cédant à un vieux fantasme européiste, il
l'appelle pourtant à « partager » son siège avec l'UE, au moins
provisoirement, pendant que la France assure la présidence de l'Union.
On s'agace pareillement de son aversion naïve pour la Realpolitik,
et de sa posture "bien pensante" qui le conduit à ériger en vérités
universelles des opinions ou des valeurs – telle la "parité" – qui sont
loin d'emporter notre adhésion. On lui reprochera enfin de se complaire
dans une relative apologie, son ouvrage s'approchant d'avantage de la
paraphrase que de l'analyse approfondie.
Jean-Dominique Giuliani : Un Européen très pressé.
Éditions du Moment, 22 mai 2008, 277 p., 19,95 euros.
Publié dans Europe, France, Livres | Pas de commentaire | Lien permanent
3 juillet 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
La présidence française de l'Union européenne est lancée !

L'Europe est-elle en crise, voire en panne ? Sans doute dans
l'esprit des européistes. Pour eux, l'échec de la ratification du
traité de Lisbonne par l'Irlande est un nouveau camouflet. Depuis la
signature du traité de Nice en 2001 – toujours en vigueur – l'Union
s'est élargie à douze nouveaux États, rendant d'autant plus délicate la
négociation d'une révision, et a fortiori sa ratification, soumise
parfois aux aléas des référendums... La réforme institutionnelle se
trouve manifestement dans l'impasse.
La tâche de la France en est-elle bouleversée, alors qu'elle
assure pour six mois, depuis le 1er juillet, la présidence du Conseil
de l'Union ? Le chef de l'État tentera vraisemblablement de sauver son
traité. Mais s'ils le souhaitent, les gouvernements « peuvent avancer
exactement comme avant », remarque Hubert Védrine. Selon l'ancien
ministre des Affaires étrangères, « nous attendons "trop des traités" »
; l'essentiel « dépend de la volonté des gouvernements". [...] Nous
pouvons donc "faire énormément de choses même avec des traités
imparfaits" » (Toute l'Europe, 16/06/08).
Nicolas Sarkozy, dont l'ambition serait « de redonner à
l'Union une direction politique » selon Jean-Dominique Giuliani,
devrait en avoir conscience. Les européistes les plus virulents
gagneraient à s'y résoudre : sans admettre la nécessité de "construire
l'Europe par la preuve", comment pourraient-ils reconquérir les
opinions publiques ?
La France entend donner la priorité à quatre dossiers :
l'ouverture des discussions sur la Politique agricole commune, la
conclusion d'un accord sur l'immigration, le renforcement de la
politique européenne de défense, l'aboutissement des négociations sur
le paquet énergie-climat. Sa mission sera d'organiser les débats. Si
les Conseils des ministres sont financés par l'UE, ce n'est pas le cas
des conseils informels, par exemple... 190 millions d'euros sont
affectés à l'événement (trois fois plus qu'en 2000). Tous les
ministères sont mobilisés, ainsi, bien sûr, que le Secrétariat général
des Affaires européennes et la Représentation permanente de la France à
Bruxelles. Le personnel, redéployé, est d'ores et déjà confronté à une
surcharge de travail...
Que rapporte une présidence du Conseil de
l'Union ? « Rien sur le plan financier, mais beaucoup en
termes d'image, de promotion des idées françaises et de mise en valeur
du savoir-faire français », explique un fonctionnaire cité par Euractiv
(19/06/08). « "C'est de l'ordre de l'immatériel", conclut-t-il. » La
République saura-t-elle en tirer profit ?
Publié dans Europe, France | Pas de commentaire | Lien permanent
5 juin 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
Une véritable fatwa contre la liberté des femmes, selon Sihem Habchi.

Révélée par les médias le 29 mai, la décision du tribunal de
grande instance de Lille rendue le 1er avril, annulant un
mariage alors que l'épouse avait menti sur sa virginité, a provoqué un
véritable tollé. Sihem Habchi, au nom de l'association Ni putes ni
soumises, s'est insurgée contre l'instauration d'« une véritable fatwa
contre la liberté des femmes ». Le PS, quant à lui, s'est offusqué d'un
jugement « atterrant » qui « bafoue le droit des femmes à disposer de
leur corps ». Ils ont beau jeu de dénoncer la soumission de la Justice
aux préceptes islamistes, ceux-la même qui sont si prompts à accueillir
sur notre sol des immigrés porteurs de valeurs qui nous sont
étrangères... À la lecture de l'énoncé du verdict, en tout cas, on
nuance leurs réactions.
Héritage manifeste du mariage religieux, la reconnaissance de
nullité est une procédure quasiment tombée en désuétude : « elle n'est
plus enseignée à la faculté que comme une curiosité », précise Eolas
dans son Journal d'un avocat (1). Elle s'appuie sur l'article 180 du Code
civil : « Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des
deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux,
ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le
ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un
d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant,
constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la
personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre
époux peut demander la nullité du mariage. »
« Qualité essentielle »
« Mais la loi se garde de définir ces qualités essentielles,
remarque Eolas, et la jurisprudence de la cour de cassation laisse le
juge décider si, selon lui, les qualités invoquées sont ou non
essentielles. [...] Seules exigences de la jurisprudence : l'erreur
doit être objective et déterminante, c'est-à-dire reposer sur un fait
et être telle que, sans cette erreur, l'époux ne se serait pas marié. »
De fait, la Justice admet que la virginité d'une femme puisse
constituer une « qualité essentielle » aux yeux de son futur mari.
Aussi Sihem Habchi s'inquiète-elle d'« un glissement vers
l'institutionnalisation du relativisme culturel ». Le jugement n'en
reste pas moins « conforme à la jurisprudence classique » selon
Philippe Lemaire, procureur de la République de Lille : «
c'est le mensonge qui motive la décision du juge » (Le Monde, 29/05/2008).
Ni pute ni soumise réclame que « les législateurs
rétablissent cette faille de la loi ». En admettant que ses
valeurs soient effectivement partagées par la République, celle-ci se
retrouvera confrontée à un dilemme insoluble : comment pourrait-elle
garantir le libre consentement des époux tout en en restreignant les
motifs légaux ? Pour l'heure, c'est la femme dont on déplore la
"répudiation" qui fait les frais de ces polémiques. Selon son avocat,
Me Charles-Édouard Mauger, cité par l'AFP, elle aurait été «
traumatisée » par la médiatisation de l'affaire, et depuis
l'appel du procureur de la République de Lille, « elle va très, très,
très mal ». En définitive, le sort de la malheureuse, ainsi que la
crainte – à bien des égards légitime – d'une "islamisation" de la
France sont en partie instrumentalisés au service d'un certain
féminisme. C'est une réponse bien insuffisante aux outrances inspirées
par l'islam : on n'imposera pas le respect dû aux femmes par de
vulgaires revendications libertaires.
(1) http://www.maitre-eolas.fr/
Publié dans Féminisme & Genre, France, Islam | Pas de commentaire | Lien permanent
20 décembre 2007
Article publié dans L'Action Française 2000
La partie n'est pas encore gagnée pour les promoteurs du traité de Lisbonne.

L'absence du Premier ministre britannique n'aura pas empêché
la signature du traité de Lisbonne le 13 décembre dernier, dans le
cloître du monastère des Jeronimos datant du XVIe siècle, où le
Portugal avait déjà signé son traité d'adhésion à l'Union européenne en
1985. Programmée pour le 1er janvier 2009, l'entrée en vigueur de ce
texte n'est pas acquise : une nouvelle période d'incertitude vient de
s'ouvrir, celle de la ratification par les vingt-sept États membres de
l'UE.
Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et
européennes, l'avait rappelé le 11 décembre devant les députés : « La
France souhaite montrer l'exemple [...] : dès le lendemain de la
signature, le Conseil constitutionnel sera saisi. » Finalement, cela
aura été fait le jour même. Un projet de loi constitutionnelle devrait
être présenté en Conseil des ministres début janvier, puis examiné par
l'Assemblée nationale et le Sénat, respectivement, les 14 et 28 janvier
2008, avant une adoption par le Congrès le 4 février, à la majorité des
trois cinquièmes. Ce préalable est rendu nécessaire par la référence
explicite de la Constitution française au défunt traité constitutionnel
européen : paradoxalement, bien qu'il consacre la primauté "effective"
du droit communautaire, le traité de Lisbonne reste soumis à
notre loi fondamentale, qui ne saurait s'en accommoder sans une
énième révision... L'Assemblée et le Sénat devraient entériner
la ratification par une loi votée entre les 5 et 8 février.
Sarkozy tient ses promesses
Ce processus arrivera vraisemblablement à son terme sans
encombre. Confronté à la fronde des "nonistes", qui sont prompts à
dénoncer un « coup d'État », le gouvernement pourra s'abriter derrière
les promesses de campagne du président de la République. Le 21 février
2007 à Strasbourg, Nicolas Sarkozy avait clairement proclamé ses
intentions : « Débloquer l'Europe
institutionnellement, ce sera le sens de ma première initiative
européenne si je suis élu. Dans ce but je proposerai à nos partenaires
de nous mettre d'accord sur un traité simplifié qui reprendra les
dispositions du projet de traité constitutionnel. [...] Je proposerai
notamment de mettre fin à la règle de l'unanimité. [...] Ce traité
simplifié, de nature institutionnelle, sera soumis pour ratification au
Parlement. » Dans ces conditions, comment prétendre que la démocratie a
été bafouée ? Les électeurs ont librement renouvelé leur soutien à ceux
dont ils avaient apparemment désavoué la politique par référendum deux
ans plus tôt... Point de putsch derrière tout ça ! Ce phénomène
illustre simplement le conservatisme du suffrage universel et témoigne
des aberrations inhérentes à la démocratie. Les souverainistes
républicains finiront par en tirer les conséquences... De toute façon,
il est vain de courir après une souveraineté privée de souverain !
À la limite, on reprochera à Nicolas Sarkozy d'avoir parlé
abusivement d'un traité « simplifié ». Alors que la Constitution
européenne se proposait de réintégrer les traités existants dans un
nouveau texte, le traité de Lisbonne amende les traités en vigueur
(Rome, Euratom, Maastricht) pour y apporter – à quelques détails près,
exception faite des symboles – les mêmes innovations. Il en résulte un
document beaucoup moins lisible, mais c'était l'objectif poursuivi si
l'on en croit Valéry Giscard d'Estaing. « Quel est l'intérêt de cette
subtile manœuvre ? D'abord et avant tout d'échapper à la contrainte du
recours au référendum, grâce à la dispersion des articles, et au
renoncement au vocabulaire constitutionnel. » (Le Monde, 26/10/2007)
Le traité de Lisbonne supprime les "Communautés européennes"
appelées à se fondre dans l'Union, et met à jour quelques termes
dépassés, en remplaçant par exemple la mention de l'écu par celle de
l'euro. La lecture de la version consolidée des traités ainsi modifiés
s'en trouvera un peu moins confuse... Tout au plus s'agit-il d'un
traité légèrement "simplificateur".
Qui sera le mouton noir ?
À l'étranger, la ratification s'annonce parfois plus délicate.
En République tchèque, par exemple, le Premier ministre Mirek Topolanek
a prévenu que cela ne serait « pas si simple » ; l'ODS, sa formation
politique, a déjà signalé qu'elle ferait examiner la conformité du
nouveau traité avec la loi fondamentale tchèque par le Conseil
constitutionnel. Selon Radio Prague (www.radio.cz, 14/10/2007), « pour certains analystes, ce serait également une manière de ne pas
ratifier "trop tôt", pour ne pas compromettre la présidence tchèque de
l'UE au premier semestre 2009 » ; en effet, l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne mettrait fin à la présidence tournante du
Conseil européen réunissant les chefs d'État et de gouvernement.
Gordon Brown, quant à lui, devra compter avec
l'euroscepticisme partagé par l'opinion britannique et nombre de ses
parlementaires : les dérogations obtenues par Londres – sur la
Charte des droits fondamentaux ou le renforcement de la coopération
judiciaire et policière – n'ont pas suffi à les rassurer. Le Sun, qui
milite en faveur d'un référendum, met en garde le Premier
ministre, qui doit s'attendre « à une âpre révolte à la
Chambre des Communes lorsqu'il tentera de faire passer en force le
traité au Parlement » (cité par letemps.ch, 14/12/2007).
En Irlande, la tenue d'un référendum sera inévitable. Au
préalable, suivant la terminologie consacrée, un actif travail de
"pédagogie" devra être entrepris : un sondage réalisé par l'institut
TNS pour le quotidien Irish Times avait révélé le 5 novembre 2007 que
seuls 25 % des Irlandais pensaient voter "oui", tandis que 12 %
seraient certains de voter "non", les indécis représentant 62 % des
sondés. En 2001, l'Irlande avait déjà perturbé le processus de
ratification du traité de Nice, rejeté lors d'un premier référendum.
Qu'adviendra-t-il, enfin, si la crise se poursuit en Belgique,
ou si le pays éclate ? « L'arrivée d'un cabinet provisoire mené par Guy
Verhofstadt, l'ancien Premier ministre, ne fait que déplacer la
question selon Sylvain Lapoix (marianne2.fr, 06/12/2007) : en
droit constitutionnel, un gouvernement provisoire ne peut en effet
traiter que des questions relevant des "affaires courantes". D'où le
débat qui, depuis le retour en fonction de Verhofstadt, agite les pages
du quotidien Le Soir : l'adoption d'un traité européen
est-elle une affaire courante ? Entre juristes, la bataille fait
d'autant plus rage qu'un précédent existe : le 2 février 1992, le
traité de Maastricht fut signé alors que le gouvernement issu des
élections du 24 novembre 1991 n'avait pas été formé. La situation est
ici sensiblement différente dans la mesure où ce n'est pas le délai de
formation du nouveau gouvernement qui retarde la mise en place d'un
cabinet mais une crise politique majeure qui empêche tout accord... »
La partie n'est pas encore gagnée pour les promoteurs du traité de
Lisbonne !
D'ailleurs, comment est-elle censée se dérouler ? Le 14
décembre, lendemain de la signature du traité, le Conseil européen
s'est à nouveau réuni. Il a salué l'entrée, le 21 décembre, de neuf
États membres dans l'espace Schengen (Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie). À
la demande de la France, il a décidé la création d'un "groupe de
réflexion" présidé par l'ancien Premier ministre espagnol Felipe
Gonzalez, chargé d'examiner l'avenir de l'Union à l'horizon 2020-2030.
Ce "comité de sages" ne traitera pas des questions institutionnelles ou
budgétaires ; et contrairement au souhait du président de la
République, son mandat ne mentionnera pas explicitement la question des
frontières. Il devrait commencer ses travaux au second semestre 2008,
et rendre ses conclusions en 2010.
Gouvernement des juges
D'ici là, au cours du second semestre 2008, la présidence
française de l'UE aura pour tâche, entres autres, de mener les
discussions sur la définition du rôle du futur président du Conseil
européen, ou sur la mise en œuvre de l'action du représentant pour la
politique étrangère. Dans son rapport d'information, le
sénateur Hubert Haenel souligne que l'incertitude
demeure quant aux modalités d'application du nouveau traité :
« On ne peut pas, par exemple, savoir a priori comment se fera
le partage des responsabilités entre le président du Conseil européen,
le Haut Représentant et le président de la Commission. On ne peut pas
savoir non plus jusqu'où ira le Parlement européen dans l'usage de ses
nouveaux pouvoirs. Le nouvel équilibre institutionnel se dégagera
avec le temps. »
La révision des objectifs assignés à l'Union suscite également
des interrogations, comme l'explique Nicolas Gros dans le numéro
spécial d'Europolitique : « Ce renversement de valeurs
pourrait ne pas être cosmétique. Placer les valeurs sociales,
d'environnement et de développement durable au même niveau que les
valeurs d'économie libérale, voire légèrement au-dessus est un geste
politique fort. [...] Les conséquences pourraient être juridiques,
estiment plusieurs analystes. Elles pourraient donner aux magistrats de
la Cour, l'occasion de d'opérer une hiérarchisation entre les valeurs
sociales et les principes de la libre circulation. » Autrement dit, la
balle est dans le camp des juges. Un comble pour un traité qui se veut
davantage politique !
À défaut de se plonger dans la lecture du traité de Lisbonne,
particulièrement ardue pour un profane, les plus curieux pourront se
référer au numéro spécial d'Europolitique (www.europolitique.info)
ainsi qu'au rapport d'information du Sénat (n° 76, déposé le
8 novembre 2007, www.senat.fr). En dépit d'une relative
complaisance à l'égard du texte présenté, ces synthèses en donnent un
aperçu plutôt objectif.
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
19 avril 2007
Article publié dans L'Action Française 2000
Un frère dominicain veut réconcilier foi et raison.
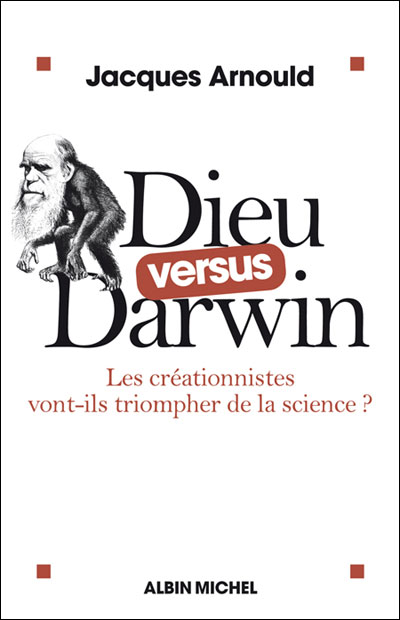
Le créationnisme est en vedette dans les librairies. Selon les
cas, l'ouvrage que lui a consacré Jacques Arnould (1) – un
frère dominicain – est classé en science ou en religion. Cette
ambiguïté est à l'image d'un objet d'étude dont M. Glauzy affirme qu'il
est une « science biblique ».
Les créationnistes « refusent la vision
évolutionniste [...] selon laquelle les espèces vivantes et, plus
largement, l'ensemble de la réalité seraient le résultat du lent
travail des forces naturelles » ; pour eux,
« au contraire, Dieu en est le seul auteur, d'une manière
directe et indépendante des lois de la nature ».
Parmi les créationnistes stricts, certains observent un rejet
catégorique du discours scientifique, mais d'autres ne le condamnent
pas dans tous les cas. Ces derniers se divisent en deux écoles, selon
leur appréciation de l'âge de la Terre : les young-earth
creationists « pratiquent une lecture littérale des
onze premiers chapitres du livre de la Genèse », tandis que l'old-earth
creationism s'accommode de quelques exégèses. Moins
radicaux, les partisans du créationnisme progressif
« acceptent l'existence de différences, voire
d'incohérences, entre le texte de la Bible et les données de la
science », tout en prétendant que « l'évolution ne
permet pas d'expliquer les événements de l'histoire de la vie ».
Considéré parfois comme un néocréationnisme, le courant du dessein
intelligent s'appuie sur l'« irréductible
complexité » du vivant pour récuser la responsabilité du
hasard dans sa constitution.
Un lobby influent
La majorité des scientifiques se montrent sévères à l'égard du
mouvement créationniste. Citons par exemple Jean Chaline, directeur de
recherche émérite au CNRS (2) – qui condamne parallèlement le
néoscientisme : « Pour les créationnistes, la méthode
consiste à découvrir les failles scientifiques potentielles dans les
hypothèses, de façon à les couvrir de ridicule, ou à montrer leurs
incertitudes. Ils recourent sans état d'âme à la falsification, à la
manipulation des données scientifiques et de certains principes de la
physique... » Passant en revue quelques sujets de controverse,
il s'indigne notamment de cette réponse faite aux évolutionnistes,
selon laquelle « Dieu pourrait avoir donné une apparence de
vieillesse à l'univers qui tromperait les astronomes ». Une
hypothèse évidemment irréfutable, qui transgresse en cela les principes
élémentaires de la science.
En France, bien qu'elles comptent quelques défenseurs, ces
thèses se heurtent à une société fortement laïcisée, ainsi qu'à la
prédominance historique de l'Église catholique. La situation est tout
autre aux États-Unis, où le créationnisme est né dans des milieux
presbytériens et évangélistes pendant la seconde moitié du
XIXe siècle. Jacques Arnould rend compte de son immixtion dans
les programmes scolaires et des batailles judiciaires qui l'ont
accompagnée. Outre-Atlantique, le créationnisme s'attire les sympathies
des plus hautes personnalités politiques, tel le président Bush qui
déclara en août 2005 : « Ces deux théories
[l'évolution et l'intelligent design] doivent être
correctement enseignées de manière que les gens saisissent la nature du
débat. »
Est-il légitime de traiter les deux approches sur un pied
d'égalité ? « Le concept de théorie prend en compte
les faits, les hypothèses et les lois pour tenter d'expliquer la
réalité », rappelle Jacques Arnould ; par conséquent,
« une théorie ne peut pas être testée en dehors de la
science ». Or, celle-ci est « athée a priori
et par
méthode ». Bien que croyant, l'auteur ne s'en offusque pas,
car il a conscience « qu'il ne faut pas confondre origine
ultime et origine immédiate », Cause première et causes
secondaires.
« L'œuvre du démon »
Il entend cantonner la science à son domaine. Et aussi sa
foi : « Je dois rassurer ceux qui se demandent si je
crois [...] en Darwin. Je réserve la croyance à la religion, aux
relations humaines, voire à l'intelligence, mais pas à la
science. » Jacques Arnould constate que « les
théories héritées de Darwin sont celles sur lesquelles une majorité de
biologistes se fondent pour travailler » ; comme
nous, il reconnaît n'avoir « ni la compétence ni l'autorité
pour les critiquer ».
S'il ne leur accorde aucune caution scientifique, le frère
Arnould ne traite pas les créationnistes avec mépris :
« Il existe sans aucun doute de la bonne foi [...] de part et
d'autre. » On perçoit le désarroi que lui inspire une foi
fondée sur une lecture littérale de la Bible... Sans doute a-t-il à
l'esprit l'enseignement de Saint Paul : « La lettre
tue et l'esprit vivifie. »
Bien des auteurs abordant le sujet auraient versé dans
l'anticléricalisme. On tremble à la lecture d'un sermon prononcé jadis
dans le Tennessee par un prédicateur assimilant la découverte des
dinosaures à « l'œuvre du démon ». Jacques Arnould
tient son propos à l'écart des polémiques, mais nous observerons que
les dépositaires de cet héritage fanatique, trop prompts à tout
analyser à travers le prisme de la christianophobie, dénoncent
volontiers l'évolution comme un « montage » contre
la foi, au mépris des travaux scientifiques. L'auteur reste conscient,
néanmoins, que ces théories « ne sont pas exemptes
d'idéologies a priori, ni d'ailleurs de
récupérations a posteriori ». Par sa
mesure, il redore un peu
l'image de la religion, dévalorisée par des "champions" déniant la
rationalité.
Il apporte sa pierre au débat entre foi et raison. De son
point de vue, « s'il convient de ne pas confondre ces deux
sphères, il ne faudrait pas non plus les maintenir totalement
séparées ». Ainsi souligne-t-il que « la quête
obstinée du commencement et de l'origine se trouve au fondement même de
notre conscience d'être humain ».
Dans une société laïcisée, largement dominée par la
technologie, les croyants pourront difficilement esquiver ce débat, à
moins de se replier dans leurs communautés. Quant aux politiques,
peut-être y seront-ils bientôt régulièrement confrontés ? On
se souvient qu'en début d'année, un "atlas de la création" avait été
massivement envoyé dans les établissements de l'Éducation nationale
afin de réfuter l'évolution au nom du Coran. En réaction, le ministère
avait diffusé un « message de vigilance » auprès des
recteurs.
(1) Jacques Arnould : Dieu versus Darwin ;
Albin Michel, 317 p., janvier 2007, 20 euros.
(2) Jean Chaline : Quoi de neuf
depuis Darwin ? Ellipses, 479 p., novembre 2006,
26,50 euros.
Publié dans Livres, Obscurantisme | Pas de commentaire | Lien permanent
17 novembre 2005
Article publié dans L'Action Française 2000
Critique de la reconnaissance institutionnelle de
l'homosexualité.

Depuis la parodie de mariage orchestrée par Noël Mamère, les
partisans de la "cause homosexuelle" semblent peut-être moins
pressants, mais leur résolution n'a pas faibli. Le retour de leurs
revendications sur le devant de la scène politique sera-t-il l'occasion
d'un débat plus réfléchi ? Le dernier ouvrage du prêtre et
psychanalyste Tony Anatrella, Le Règne de Narcisse,
devrait nous aider à en cerner les enjeux.
Dans une première partie, l'auteur se propose de définir
l'homosexualité. Il y voit la conséquence d'un manque d'intériorisation
de la différence des sexes, le résultat d'une identification au même
que soi. Cette « fixation narcissique » donnerait
parfois des personnalités très imbues d'elles-mêmes ; à
l'opposé, elle pourrait aussi encourager les individus à se
dévaloriser. Dans tous les cas, elle ne serait pas une option
équivalente à l'hétérosexualité, mais un échec dans le processus normal
du développement psychique de l'individu.
Principe de précaution
Représente-t-elle une image de la sexualité à partir de
laquelle la société doit s'organiser ? Dans une seconde
partie, Tony Anatrella expose les motifs de son opposition à la
reconnaissance institutionnelle de l'homosexualité. Il décrypte la
"théorie du gender", selon laquelle la masculinité et la féminité
seraient déterminées par la culture. Ses implications sont
profondes : le déni de la différence sexuelle pourrait
notamment amener la société à dissocier la procréation de la sexualité,
brouillant ainsi les repères de la filiation.
L'auteur s'inquiète des conséquences de ce bouleversement
symbolique. Selon lui, l'amour ne suffit pas à combler les besoins de
l'enfant, qui risque d'être perturbé. Il en appelle donc au principe de
précaution pour justifier son refus d'ouvrir le mariage et l'adoption
aux « duos homosexuels ».
Imposture
Reste à convaincre nos compatriotes... La troisième partie est
consacrée à la dénonciation d'un concept désormais consacré par la loi,
l'"homophobie". Ce n'est qu'une « imposture » pour
Tony Anatrella. Sa fonction ne serait pas seulement de discréditer
l'opposition aux revendications homosexuelles, par analogie avec le
racisme. Ce concept pourrait également contribuer à occulter certains
phénomènes.
La détresse des jeunes homosexuels, particulièrement enclins
au suicide, est connue de tous, mais quelle en est l'origine ?
La mise en accusation de la société est une explication naïve aux yeux
de l'auteur. Considérée comme « le résultat d'un complexe
psychologique », l'homosexualité suscitera un trouble
indépendamment du regard porté sur elle par la société. Quant à la
réaction des parents découvrant l'homosexualité de leur enfant, parfois
vive, elle témoigne « d'une angoisse existentielle et non pas
d'une quelconque "homophobie", comme on veut le prétendre dans un excès
d'interprétation psychologique moralisante ».
Bons sentiments
S'il est démuni de toute connaissance en psychologie, le
lecteur ne se sentira peut-être pas à son aise, et dans ce cas il
regrettera d'autant plus que l'ouvrage ne soit pas construit d'une
façon plus rigoureuse. Trop d'idées sont avancées ici alors qu'il faut
chercher l'explication ailleurs ; d'autres reviennent comme un
leitmotiv sans être suffisamment argumentées : le déni de la
différence sexuelle est peut-être dénoncé à chaque page, mais aucune
n'est consacrée à la définition de cette réalité jugée fondamentale.
On comprend néanmoins combien la question de l'homosexualité
et de sa reconnaissance institutionnelle est abordée de façon
superficielle dans les médias. Sa dimension psychologique est écartée,
les possibles conséquences sociales sont ignorées... Sous « le
règne de Narcisse », les intelligences sont dévoyées par les
bons sentiments. Ce constat est inquiétant à plus d'un titre, car il
est symptomatique d'une société où le bien commun n'a plus sa place.
Tony Anatrella, Le Règne de Narcisse – Les Enjeux
du déni de la différence sexuelle, Presses de la
Renaissance, 250 p., 18 euros.
Publié dans Livres, Société | Pas de commentaire | Lien permanent