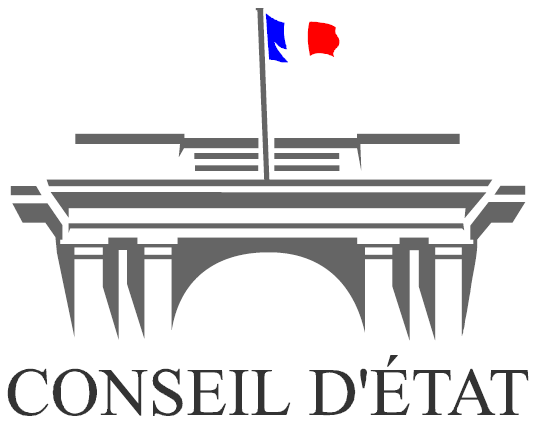7 janvier 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Espagne assure pour six mois la présidence du Conseil de
l'UE. Ses dirigeants devront cohabiter avec de nouveaux responsables
européens... Rappels historiques et résumé des priorités affichées par
Madrid.

Depuis le 1er janvier, l'Espagne assure la présidence
du Conseil de l'Union européenne. C'est la quatrième fois que cette
responsabilité lui incombe depuis son entrée dans la Communauté
européenne en 1986. Madrid avait frappé à sa porte dès les années
soixante, obtenant seulement qu'elle lui soit entrouverte, avec la
souscription d'un accord préférentiel en 1970. Formalisée en 1977,
moins de deux ans après le décès du général Franco, sa demande
d'adhésion avait été accueillie avec réticence par la France...
Un pays europhile
Elle suscitait en revanche un consensus national. L'adhésion
fut approuvée à l'unanimité par le parlement. « L'appui de
l'Espagne au processus d'intégration européenne a toujours été
supérieur à la moyenne européenne », constate Lorenzo Delgado
Gomez-Escalonilla. « L'entrée dans l'Europe n'est pas associée
à la perte de la souveraineté ou de l'identité nationale comme cela se
produit dans d'autres États. » (Dictionnaire
critique de l'Union européenne, Armand Colin)
En vingt ans, bénéficiant largement des fonds structurels
européens, l'économie espagnole s'est radicalement transformée. Cela
n'est pas allé sans douleur, mais le "revenu par tête" est passé de
8 000 euros annuels en 1985 à
23 000 euros en 2005. Il y a quatre ans, le traité
établissant une constitution pour l'Europe ayant fait l'objet d'un
référendum, le "oui" l'avait emporté à la faveur de 77 % des
voix.
Animant pendant six mois les travaux des ministres européens
(à l'exception de ceux touchant aux affaires étrangères, désormais
coordonnés par le Haut Représentant), l'Espagne revendique quatre
priorités : « application fidèle et résolue du
nouveau traité ; une plus grande coordination des politiques
économiques afin de garantir la relance économique et d'asseoir les
bases d'une croissance européenne durable ; renforcement de
l'Union en tant qu'acteur politique décisif dans la
mondialisation ; veiller constamment aux intérêts des citoyens
européens et au respect de leurs droits dans toutes les nouvelles
initiatives ».
« Nous voulons que le président Van Rompuy et la
Haute Représentante [sic] Ashton puissent, dès le début, exercer
pleinement leurs fonctions », assure José Luis Rodríguez
Zapatero. Sa fidélité à l'"esprit de Lisbonne" est pourtant mise en
doute. Le chef du gouvernement espagnol parviendra-t-il à se faire une
place aux côtés du président du Conseil européen ? En pleine
période de transition institutionnelle, on guettera les incidents.
Mais, de part et d'autre, on se satisfera vraisemblablement de quelques
arrangements. Dorénavant, par exemple, un délégué du Haut Représentant
est censé présider le COPS (Comité politique et de sécurité) ;
aussi Mme Ashton a-t-elle assigné cette mission à l'ambassadeur
espagnol, tout simplement (Bruxelles 2,
19/12/2009).
L'Espagne devrait porter un intérêt tout particulier au
Parlement européen. Elle y sera plus souvent confrontée que ses
prédécesseurs en raison des pouvoirs accrus de l'assemblée. En outre,
elle s'attachera à faire adopter aussi vite que possible le protocole
permettant de réviser sa composition sans attendre les prochaines
élections européennes. Parmi les douze États bénéficiant de sièges
supplémentaires, elle est en effet celui qui en gagne le plus (quatre
députés).
Questions pour un champion
Naturellement, il appartiendra à Madrid d'accompagner la mise
en œuvre du Service européen pour l'Action extérieure (SEAE). Catherine
Ashton voudrait en faire « un vrai service, pour mener la
diplomatie de l'Union [...] avec les moyens budgétaires nécessaires,
non pas pour remplacer la diplomatie des États membres mais pour [s'] y
ajouter » (Bruxelles 2,
16/12/2009). « Je pense que nous pouvons obtenir beaucoup de
la "diplomatie tranquille" », a-t-elle déclaré. Affichant un
optimisme bien naïf, elle espère « réunir les représentants
les plus talentueux de tous les États membres de l'UE » (Le Figaro,
18/12/2009).
À moins qu'une grève des fonctionnaires européens ne perturbe
le calendrier, le Parlement entamera lundi prochain,
11 janvier, les auditions des nouveaux membres de la
Commission. Mme Ashton sera la première soumise à ce "grand oral"
minuté à la seconde près, où les questions s'enchaîneront pendant trois
heures à un rythme infernal (Bruxelles 2,
17/12/2009). Curieuse façon d'évaluer des compétences sur un sujet
aussi complexe que les relations internationales.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
29 décembre 2009
Depuis Dublin, un commissaire européen prononce un éloge
dithyrambique de la diplomatie française. Charlie McCreevy a-t-il perdu
la tête ?

Le président de la République n'a pas manqué de fanfaronner,
tandis qu'il venait d'obtenir pour la France le portefeuille de
commissaire européen en charge du Marché intérieur. Ce faisant, il
aurait « enterré une fois pour toutes le mythe selon lequel
les commissaires européens, et tout particulièrement les Français,
arrivant à Bruxelles, sont supposés laisser de côté les intérêts
nationaux ». C'est en tout cas l'opinion formulée le
18 décembre par le commissaire irlandais Charlie McCreevy,
auquel Michel Barnier doit justement succéder. Selon lui, l'influence de
la France à Bruxelles serait
« impressionnante » : « On oublie
que la bureaucratie de Bruxelles a été conçue par la France. [...] Au
fil des années, cela a donné aux Français un énorme avantage pour
savoir comment actionner les leviers de pouvoir. » En
conséquence, il a salué l'« habileté extraordinaire »
de la diplomatie française.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
3 décembre 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Les commentaires vont bon train depuis la désignation du
premier président "stable" du Conseil européen. On en fait volontiers
le président « de l'Union européenne ». Un simple
abus de langage ?

Les Vingt-Sept se sont accordés pour désigner le Belge Herman
Van Rompuy à la tête du Conseil européen. « Cela s'est passé
relativement facilement, en tout cas rapidement », selon le
témoignage du président de la République. Rappelons que le Conseil
européen réunit les chefs d'État ou de gouvernement des États membres
de l'UE. Selon les traités, il « donne à l'Union les
impulsions nécessaires à son développement et en définit les
orientations et les priorités politiques générales ». Il en
est devenu une institution à part entière avec l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne le 1er décembre. Cette consécration nourrit
d'ailleurs quelque inquiétude en l'exposant au contrôle de la Cour de
Justice de Luxembourg.
Quels pouvoirs ?
Évoquant le Premier ministre belge sortant, nombre de nos
confrères se sont empressés d'en faire le président non pas du Conseil
européen, mais de « l'Union européenne » tout
entière. C'est méconnaître ses responsabilités. Officiellement, il
« préside et anime les travaux du Conseil européen ;
assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen
en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des
travaux du Conseil des Affaires générales ; œuvre pour
faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil
européen ; présente au Parlement européen un rapport à la
suite de chacune des réunions du Conseil européen ».
Le 12 novembre, Herman Van Rompuy se serait paraît-il
prononcé « lors de la réunion du groupe Bilderberg, à
Bruxelles, pour un fédéralisme européen sur le modèle de celui des
États-Unis » ; il aurait « plaidé en faveur
d'un financement direct du budget européen par l'impôt, en l'occurrence
une taxe environnementale » (Coulisses de Bruxelles,
29/11/2009). Tout juste désigné à la tête du Conseil européen, il a
prononcé une déclaration bien plus consensuelle :
« Je veillerai à respecter les sensibilités et les intérêts de
tout un chacun. [...] Chaque pays a son histoire, sa culture et sa
façon de faire. Sans respect pour notre diversité, nous ne
constituerons jamais notre unité. Ce principe sera toujours présent
dans mon esprit. »
Son influence dépendra de l'habileté avec laquelle il
dessinera les contours de sa fonction. Mais il ne saurait convoiter un
pouvoir exécutif. « Il ne s'agissait pas d'élire George
Washington à la tête des États-Unis d'Amérique », proclame
Pierre Lellouche, le secrétaire d'État en charge des Affaires
européennes : « Son rôle sera non pas de faire de la
représentation et de donner des conférences de presse, mais d'être
capable de poser les bonnes questions au Conseil européen, puis, une
fois qu'un accord aura été dégagé, d'en assurer le suivi. »
Jacques Delors balaie lui aussi les utopies giscardiennes :
« Il n'a jamais été question [...] d'avoir une personne qui
serait président de l'Europe, les États ne l'auraient pas supporté.
[...] Au bout de six mois, les tensions entre les différentes
institutions auraient été telles que tout aurait été
paralysé. » (Le Monde, 30/11/2009)
Un vrai ministre
Haut Représentant pour les Affaires étrangères et la Politique
de sécurité, la Britannique Catherine Ashton est quant à elle promue
« ministre des Affaires étrangères » par certains
journalistes, qui empruntent l'expression au défunt traité établissant
une constitution pour l'Europe. Ce titre apparaît moins usurpé que le
précédent : Mme Ashton présidera le Conseil des
ministres des Affaires étrangères ; elle s'appuiera à terme
sur le Service européen pour l'Action extérieure qu'il lui appartient
de mettre en place. Aussi Paul-Marie Coûteaux annonce-t-il d'ores et
déjà la « suppression » des ambassades nationales.
Avant d'en arriver là, l'UE devra unifier son embryon de diplomatie,
scindée entre ses piliers communautaire et intergouvernementaux. À
titre d'exemple, elle a entrepris il y a seulement quelques mois
d'unifier sa représentation en Afghanistan, où le délégué du Conseil
cohabitait avec celui de la Commission ; ainsi, bien sûr, qu'avec les
représentants des États membres maintenus à leur poste.
Cristal opaque
La nationalité du Haut Représentant pourrait en outre tempérer
l'inquiétude des souverainistes. « C'est assez intéressant de
prendre [...] une femme qui vient d'un pays qui a parfois plus de
difficultés avec l'Europe », souligne Nicolas Sarkozy. Sans
doute sera-t-elle confrontée à quelques tiraillements. Parmi les
premiers dossiers qu'elle aura à traiter figure ainsi le déploiement,
en Ouganda, d'un dispositif européen de formation des soldats
somaliens ; une opération dont les préparatifs sont accueillis
avec réticence par le Royaume-Uni.
Les approximations sémantiques observées dans la presse
s'expliquent par des motifs idéologiques. Elles illustrent également ce
travers par lequel des schémas institutionnels nationaux sont calqués
sur la réalité européenne, où ils s'avèrent inopérants. La mise en
œuvre du traité de Lisbonne rendra-t-elle le fonctionnement de l'UE
plus intelligible aux yeux des profanes ? La présidence de la
Commission n'est pas subordonnée à celle du Conseil européen, et celle,
tournante, du Conseil des ministres est maintenue... Tandis qu'on lui
demandait quel était désormais le visage de l'"Europe", le président de
la République lâcha cet aveu : « Tout n'est pas d'une
pureté de cristal. »
Publié dans Europe | Pas de commentaires
19 novembre 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Le Conseil d'État reconnaît désormais "l'effet direct" des
directives européennes.
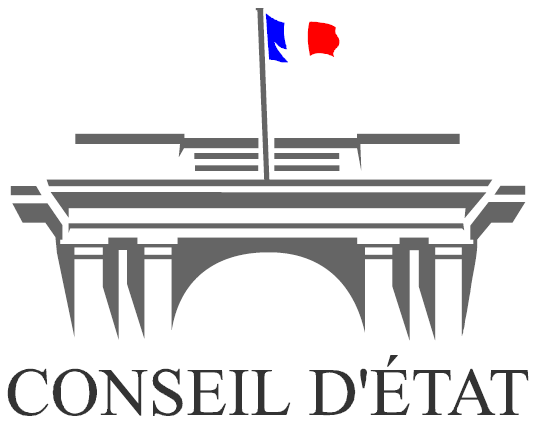
En 1975, Daniel Cohn-Bendit demanda l'abrogation de l'arrêté
d'expulsion dont il avait fait l'objet le 25 mai 1968. Confronté, dans
un premier temps, au refus du ministre de l'Intérieur, il fit valoir,
en vain, que sa décision était contraire à la directive adoptée par le
Conseil des Communautés européennes le 25 février 1964.
À la différence des règlements, rappelons que les directives
requièrent une "transposition" par les autorités nationales.
À l'époque, le Conseil d'État considéra que les États membres
étaient les seuls destinataires des directives, et que celles-ci
« ne sauraient être invoquées par [leurs] ressortissants [...]
à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif
individuel ». Sa position tranchait avec celle de la Cour de
Justice de Luxembourg, dont il se rapprocha toutefois en pratique par
la suite, jusqu'à revenir sur cette jurisprudence le 30 octobre dernier.
Un revirement
Appelé à statuer sur une affaire de discrimination,
l'Assemblée du contentieux – la formation juridictionnelle la plus
élevée du Conseil d'État – a jugé, suivant les termes du communiqué
officiel, « que tout justiciable [pouvait] se prévaloir, à
l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif même non
réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une
directive lorsque l'État n'a pas pris, dans les délais impartis par
elle, les mesures de transposition nécessaires. » "L'effet
direct" des directives européennes se trouve ainsi reconnu. Et la
prégnance du droit communautaire confirmée, bien que son primat fût
admis de longue date : depuis 1984, par exemple, le Conseil d'État
pouvait annuler les dispositions de tout acte réglementaire contraire à
une directive.
Pour expliquer son revirement, la juridiction administrative
invoque l'« obligation constitutionnelle » que
revêtirait désormais la transposition en droit interne des directive
communautaires. Depuis 1992, en effet, la constitution de la
Ve République affirme la participation de la France aux
Communautés et à l'Union européennes, dans les conditions fixées par
les traités européens successifs. Aux yeux des juristes, l'influence
des normes communautaires puise donc sa légitimité dans notre propre
constitution.
Publié dans Europe, France | Pas de commentaires
19 novembre 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Souverainistes et européistes s'offusquent de l'opacité des
négociations européennes.
Les tractations allaient bon train à l'approche du Conseil
européen du 19 novembre, où les chefs d'État et de
gouvernement devaient désigner celui qui présiderait leurs réunions
pendant deux ans et demi, en application du traité de Lisbonne.
Les candidats potentiels à ce genre de poste n'ont pas
l'habitude de se déclarer. Jean-Claude Juncker, le Premier ministre du
Luxembourg, a certes rompu avec la tradition ; gageons que c'était
moins dans l'espoir de satisfaire ses ambitions qu'afin de faire échec
à Tony Blair.
Quoi qu'il en soit, le président du Conseil européen reste
désigné sous l'empire de négociations diplomatiques. Pour les
européistes, cela témoigne de l'empreinte insupportable que les États
continuent d'imprimer sur l'UE. « Ces tractations secrètes
donnent des arguments à ceux qui plaident pour l'élection au suffrage
universel d'un "président de l'Union" », clame Jean Quatremer (Coulisses
de Bruxelles, 11/11/2009). C'est le cas de Ségolène Royal,
qui renouvelle son vœu de « créer les États-Unis
d'Europe » dans un entretien accordé à La Tribune
le 10 novembre. Sans doute aurait-elle mieux fait de se
taire : l'utopie apparaît selon nous trop manifeste pour
berner l'électeur moyen en quête d'un projet mobilisateur.
Comme en URSS...
De son côté, Yves Daoudal a fait écho aux déclarations de Mme Vike-Freiberga, dont le nom était parfois avancé pour prendre la tête
du Conseil européen. L'ancien président de la Lettonie fustige les
nominations décidées « comme toujours dans l'obscurité,
derrière des portes closes » : « Il y en a
assez que l'Union européenne fonctionne comme l'ancienne Union
soviétique. » Le Salon Beige a lui aussi
relayé ses propos, qui semblent réjouir les souverainistes. La
comparaison puise ses racines dans l'histoire, comme le rappelle
L'Encyclopédie de l'Agora : « En 1985, Mikhaïl
Gorbatchev, alors premier secrétaire du Parti communiste au pouvoir en
Union soviétique, fit l'annonce d'une nouvelle politique fondée sur la
Glasnost, mot que l'on traduisit par transparence en français. C'est
ainsi que l'on put connaître les faits sur les grandes purges de
Staline et le massacre de Katyn... »
Cela dit, la blogosphère réactionnaire se fourvoie en versant
apparemment dans l'apologie de la "transparence". En effet, sa
revendication participe d'un libéralisme forcené, tandis que son
application revêt une incontestable dimension totalitaire.
Publié dans Europe, Souverainisme | Pas de commentaires
5 novembre 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Privé du soutien de la cour constitutionnelle tchèque, Vaclav
Klaus jette l'éponge. Le traité de Lisbonne pourrait entrer en vigueur
dès le 1er décembre. D'ici là, les Vingt-Sept devront
s'accorder sur les nominations aux postes clefs.

Les derniers espoirs des nonistes s'évanouissent :
mardi 3 novembre, la cour constitutionnelle tchèque a rejeté
l'ultime recours déposé contre le traité de Lisbonne. Résigné, le
président Vaclav Klaus considère que « sa probable entrée en
vigueur ne va pas être la fin de l'histoire » (Coulisses
de Bruxelles, 17/10/2009). A-t-il vraiment envisagé de lui
faire obstacle ? Un rappel de ses responsabilités passées
permet d'en douter : il dirigeait le gouvernement tchèque
quand celui-ci déposa sa demande d'adhésion à l'UE ; élu chef
de l'État en février 2003, il assista depuis à l'entrée de son pays
dans l'Union, à la négociation du traité établissant une constitution
pour l'Europe, puis à celle du traité de Lisbonne qui s'acheva le
13 décembre 2007.
« Une discussion assez vive »
Quoi qu'il en soit, ce trublion souverainiste peut se targuer
d'avoir fait plier l'Europe. Le 29 octobre, à l'issue d'« une
discussion assez vive », selon le témoignage du président de
la République, les chefs d'État ou de gouvernement des Vingt-Sept sont
convenus d'un arrangement dissipant sa crainte – réelle ou prétendue –
d'une remise en cause des décrets Benes par lesquels furent expulsés de
Tchécoslovaquie trois millions d'Allemands des Sudètes. La République
tchèque sera ajoutée aux États mentionnés dans le protocole stipulant
que la Charte des droits fondamentaux « n'étend pas la faculté
de la Cour de justice de l'Union européenne, ou de toute juridiction de
la Pologne ou du Royaume-Uni, d'estimer que les lois, règlements ou
dispositions, pratiques ou action administratives de la Pologne ou du
Royaume-Uni sont incompatibles avec les droits, les libertés et les
principes fondamentaux qu'elle réaffirme ». Le droit primaire
européen sera amendé en ce sens à la faveur d'un protocole inclus dans
le prochain traité d'élargissement. Encore une fois, il s'agit moins
d'une véritable dérogation que d'une "explication de texte".
Ainsi peut-on « tourner la page de dix ans de débats
institutionnels stériles », se félicite Nicolas
Sarkozy ; « raisonnablement, on peut dire que le
traité de Lisbonne entrera bien en vigueur d'ici à la fin de l'année,
sans doute dès le 1er décembre », a-t-il annoncé.
Dans l'immédiat, les responsables européens s'affairent sur deux
chantiers. Le premier recouvre des aménagements règlementaires, voire
quelques clarifications politiques, avec, par exemple, la mise en place
du Service européen pour l'action extérieure, ou la répartition des
responsabilités entre, d'une part, le Haut Représentant pour les
Affaires étrangères et la Politique de sécurité et, d'autre part, le
gouvernement continuant d'assurer la présidence semestrielle de
l'Union. Le second chantier est plus médiatisé : les
tractations s'accélèrent afin de distribuer les postes.
Qui sera le nouveau Washington ?
Pour amuser la galerie, on insiste sur la "parité" ou le degré
d'engagement "européen" des candidats potentiels. Plus sérieusement, on
souligne également la nécessité de respecter un certain "pluralisme
politique" : c'est une exigence du Parlement européen, dont
l'accord sera indispensable pour installer la nouvelle Commission.
L'attention se focalise plus particulièrement sur la désignation du
président du Conseil européen – l'instance réunissant les chefs d'État
ou de gouvernement – élu pour deux ans et demie, dont le mandat sera
renouvelable une fois. C'est un choix capital selon Valéry Giscard
d'Estaing : « l'Europe doit rechercher et inventer
son George Washington », rien de moins, avait-il lancé en
2008 ! Jacques Delors se montre plus réaliste :
« Je n'étais pas partisan de la création d'un tel poste, mais
si c'est ainsi, ce doit être un facilitateur et non un président à la
française. Si c'est un président exécutif, qui veut représenter
l'Europe partout, il y aura des conflits avec les autres chefs d'État
et à l'intérieur des institutions. Cela amènerait plutôt une paralysie
de l'ensemble qu'une avancée. » (Toute l'Europe,
22/10/2009) « Il y a un débat », reconnaît le
président de la République, qui préférerait manifestement un
« leader charismatique ». Nostalgique des six mois
qu'il a passés à la tête de l'UE, il nourrit selon nous quelques
illusions.
Convoitise
« Nous nous sommes mis d'accord avec Mme Merkel pour
[...] soutenir le même candidat le moment venu », a-t-il
révélé lors d'une conférence de presse. Aucun Français ne serait sur
les rangs. Paris ne semble pas convoiter davantage la fonction de Haut
Représentant. « Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la
France de revendiquer ce poste », a déclaré Hubert Védrine (Europe 1,
12/10/2009). « Dans le système de Lisbonne, il y
a un poste en tout pour la France et je comprends la position des
autorités françaises, notamment du président, qui voudraient que la
France ait le poste de commissaire pour le marché intérieur, y compris
les services financiers. » Le chef de l'État entend confier ce
portefeuille à Michel Barnier ; peut-on compter sur lui pour
défendre les intérêts de la France ?
Publié dans Europe | Pas de commentaires
22 octobre 2009
Hubert Haenel consacre un rapport parlementaire « à
la fonction de contrôle du Sénat sur les questions
européennes ». Une fonction « en pleine mutation pour
le parlement français, en raison de la révision constitutionnelle du
23 juillet 2008 et de la réforme des règlements des
assemblées qui vient d'en tirer les conséquences ».

La chambre haute s'appuie désormais non plus sur une délégation,
mais sur une véritable commission en charge des
Affaires européennes. « Cette disposition a mis fin à une
anomalie : au sein de l'Union, les assemblées françaises
étaient les seules (avec le parlement maltais) à ne pas être dotées
d'un tel organe. L'évolution a été radicale puisque, aujourd'hui, la
commission "chargée des affaires européennes" est la seule dont
l'Assemblée nationale et le Sénat soient constitutionnellement obligés
de se doter. »
D'ores et déjà, le Sénat serait l'assemblée ayant adressé à la
Commission « le plus grand nombre d'"observations" sur la
subsidiarité et la proportionnalité. Cela dans le cadre d'une procédure
informelle introduite par José Manuel Barroso après l'échec des
référendums français et néerlandais de 2005, officialisée et renforcée
par le traité de Lisbonne.
Passons sur l'examen détaillé des dispositions réglementaires
propres au Sénat ; leur complexité a eu raison de notre
curiosité. En conclusion, Hubert Haenel souligne que les institutions
européennes « apparaissent souvent lointaines, difficilement
compréhensibles et malaisément contrôlables ». Force est de
constater, à la lecture de ce rapport, que l'appréhension des
institutions françaises n'est pas une sinécure... L'UE se distingue
surtout par son originalité, à laquelle se heurte le mimétisme des
analystes de bas étage.
Publié dans Europe, France | Pas de commentaires
20 octobre 2009
La hantise du "plombier polonais" avait gagné l'opinion
française en 2005, contribuant au rejet du "traité constitutionnel"
européen. Il s'agissait bien d'un épouvantail, si l'on en croit des
statistiques à la fiabilité certes discutable.

« Les chiffres publiés par Eurostat sont [...] à
prendre avec précaution », prévient
Euractiv. Ils méritent toutefois d'être
cités : « Dans le cas de la Pologne,
15 000 travailleurs ont été recensés en France en
2005 contre 14 000 en 2007. Contrairement à la déferlante
annoncée, on s'orienterait donc plus vers une stabilité voire un léger
déclin. [...] La comparaison avec la Grande-Bretagne se révèle [...]
éclairante : en 2005, 88 000 travailleurs polonais
ont été recensés outre-Manche. Trois ans plus tard, ce chiffre est
porté à 370 000, soit quatre fois plus. [...] Autant dire que
la France ne joue pas dans la même cour. La part dérisoire de
travailleurs polonais présents sur son territoire au regard des
effectifs accueillis en Grande-Bretagne [résulterait] de l'application
[...] d'une politique migratoire relativement stricte à l'égard des
derniers pays ayant rejoint l'UE. »
Étonnant, n'est-ce pas ?
Publié dans Europe | Pas de commentaires
15 octobre 2009
En provenance de Prague, des échos médiatiques dessinent le
portrait d'un trublion tchèque dont l'irresponsabilité apparaît à la
mesure de ses provocations : que vaut la parole d'un État dont
le chef monnaie soudainement sa signature, au mépris des institutions
de son propres pays et des engagements souscrits auprès de vingt-six
partenaires ?

Non content de se réfugier derrière l'ultime recours déposé
par ses complices sénateurs, qui lui imposerait de patienter jusqu'à la
décision de la Cour constitutionnelle pour apposer son paraphe, le
président tchèque a demandé jeudi dernier (8 octobre)
« à ce qu'une note de bas de page de deux lignes soit ajoutée
en lien avec la charte des droits fondamentaux », selon le
témoignage du Premier ministre suédois, président en exercice du
Conseil européen. Autrement dit, Vaclav Klaus suggère la réouverture
des négociations bouclées le 13 décembre 2007. Il a certes
« convenu que le procédé était "peu habituel" »,
rapporte Jean Quatremer. Bel exemple de désinvolture !
Son outrecuidance forcerait l'admiration s'il n'était pas
censé représenter dix millions d'habitants. Les aléas de la
cohabitation française semblent insignifiants comparés au sabotage qui
sévit en Tchéquie. Là-bas, le président s'attaque ouvertement à son
gouvernement, dont il observe pourtant de longue date, depuis le
château de Prague, le déploiement de la politique européenne. Élu par
les parlementaires en février 2003, Vaclav Klaus se trouvait
déjà dans son fauteuil présidentiel quand fut organisé, quatre mois
plus tard, le référendum autorisant l'adhésion de son pays à l'Union
européenne le 1er janvier 2004. Il y était toujours installé quand
furent négociés le traité établissant une constitution pour l'Europe,
puis le traité de Lisbonne.
Un traité dont la portée nous semble largement exagérée par
les souverainistes. Cela n'est pas sans incidence sur l'accueil que
nous réservons à l'édification des barricades tchèques.
Apporteront-elles quoi que ce soit à la France ? Les
responsables politiques ayant bien d'autres chats à fouetter, autant
souhaiter qu'elles s'écroulent au plus vite. Cette conviction nous rend
d'autant plus enclins à fustiger le nationalisme de posture pratiqué
par Vaclav Klaus. Cela dit, nos compatriotes l'ayant choisi
pour coqueluche devraient s'interroger : apparemment, certains
seraient tout disposés à porter à la tête du pays un agitateur qui
en saperait la crédibilité internationale ; cela au nom de
l'intérêt de la France. Nouveau paradoxe.
Publié dans Europe, Souverainisme | Pas de commentaires
15 octobre 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Seul contre tous, le président tchèque Vaclav Klaus bataille
pour retarder l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, désormais
ratifié par tous les États membres de l'Union européenne à l'exception
de son pays. Les négociations en cours s'en trouvent d'autant plus
délicates...

Après avoir franchi le barrage irlandais, le traité de
Lisbonne se heurte aux barricades tchèques. Depuis le château de
Prague, où il n'a jamais laissé flotter le drapeau bleu étoilé, le
président Vaclav Klaus orchestre l'exaspération de ses homologues
européens, réfugié derrière l'ultime recours déposé le 30 septembre par
ses complices sénateurs : « Je ne peux rien signer
avant la décision de la Cour constitutionnelle », a-t-il
affirmé le 3 octobre (Euractiv,
05/10/2009). « Il est difficile de dire combien de temps cela
prendra », proclame son conseiller politique Ladislav Jakl (La Croix,
06/10/2009). Peut-être plusieurs mois.
Klaus exige une dérogation
Le président Klaus s'est entretenu par téléphone le
8 octobre avec le Premier ministre suédois Fredrik Reinfeldt,
dont le pays assure actuellement la présidence de l'Union. Un pas en
avant ? Depuis juillet dernier, il refusait tout contact avec
les responsables européens (Coulisses de Bruxelles,
08/10/2009). Au
cours de la conversation, selon le témoignage de son correspondant, il
demanda « à ce qu'une note de bas de page de deux lignes soit
ajoutée en lien avec la charte des droits fondamentaux »
annexée au traité. Prudent, le Suédois répondit qu'il s'agissait
« d'un mauvais message envoyé au mauvais moment pour
l'UE ». C'est le moins que l'on puisse dire. Cette requête
serait motivée par la crainte d'encourager les revendications des
Allemands expulsés après la Seconde Guerre mondiale – une inquiétude
que récuse le gouvernement tchèque. En échange de sa signature,
M. Klaus exige une dérogation dont la concession supposerait
la modification d'un traité négocié de longue date, signé le
13 décembre 2007 par les représentants de vingt-sept
États, et ratifié depuis par vingt-six d'entre eux (le processus s'est
achevé en Pologne samedi dernier).
Les Tchèques pourraient en être scandalisés : que vaut la
parole d'un État dont le chef joue ainsi les trublions, au mépris de
son gouvernement et de son propre parlement ? Jean-Louis Bourlanges
fustige « une manifestation d'égocentrisme extrêmement
immorale »... Bataillant seul contre tous, Vaclav Klaus
s'attire pourtant moult sympathies dans son pays : il y serait
« très populaire » selon Christian Lequesne,
directeur du Centre d'études et de recherches internationales,
« car il plaît pour sa capacité de résister. Il résiste sur le
traité de Lisbonne, sur le débat mondial sur le changement climatique,
il capitalise en interne son côté "Astérix". Mais paradoxalement, les
gens qui approuvent sa politique ne sont pas contre
l'Europe. » (Euractiv, 12/10/2009) En
France, il est devenu la
coqueluche des souverainistes. Alain Bournazel, secrétaire général du
Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France
(RIF), a pris la tête d'un comité de soutien informel. Il faut tenir
jusqu'aux élections britanniques de juin 2010 ! David Cameron,
le chef de file des Tories, est pressenti pour succéder à Gordon Brown
au 10 Downing Street. Le cas échéant, si le traité de Lisbonne
n'était pas encore appliqué, il organiserait un référendum ;
du moins l'a-t-il laissé entendre à ses électeurs potentiels.
Du bricolage
Le Premier ministre tchèque, Jan Fischer, se trouve dans
l'embarras. Son gouvernement souhaiterait permettre l'entrée en vigueur
du traité « d'ici la fin de l'année ». Lundi dernier,
il a fait part de son intention de « négocier avec ses
partenaires européens une solution possible ». Le Conseil
européen réunira les chefs d'État ou de gouvernement des Vingt-Sept les
29 et 30 octobre. Peut-être s'accordera-t-il pour annexer au
traité d'adhésion de la Croatie un nouveau protocole susceptible de
satisfaire le président Klaus. Encore du bricolage
institutionnel !
En attendant, ce climat d'incertitude complique les
négociations en cours, portant sur la répartition des postes,
mais aussi, à travers elle, sur l'équilibre des institutions
européennes. En filigrane se heurtent les intérêts divergents des
États ; ainsi les pays les moins peuplés chercheront-ils
vraisemblablement à privilégier la Commission, censée les protéger de
l'influence de leurs partenaires les plus puissants.
Tony Blair est-il disqualifié ?
Le mandat de la Commission arrive à son terme le
31 octobre. Si elle devait intervenir dès maintenant, sous
l'égide du traité de Nice, la désignation d'un nouveau collège
susciterait de vives discussions. « L'Allemagne a d'ores et
déjà fait savoir que si le traité de Lisbonne ne pouvait être appliqué,
elle plaiderait pour un exécutif européen restreint à quinze ou
dix-huit commissaires », rapporte Euractiv
(06/10/2009). On
devine que les États batailleraient ferme pour retarder la perte de
leur commissaire.
La semaine dernière, la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, suivis par l'Autriche, sont partis en croisade contre Tony
Blair. « Il a plus souvent divisé que rassemblé »,
déplore le chef de la diplomatie du Grand Duché, faisant allusion au
soutien qu'il apporta aux velléités guerrières de George W.
Bush. Fort de l'appui de Paris, l'ancien Premier ministre britannique
était pressenti pour assurer la présidence du Conseil européen pendant
deux ans et demi. « L'idée d'une présidence stable était une
proposition uniquement française qu'il a fallu, au début, défendre avec
acharnement », raconte Jean-Pierre Jouyet. Toutes les
réticences de nos partenaires n'ont pas été dissipées, et certains
préféreraient sans doute confier ce poste à une personnalité dotée
d'une moindre stature internationale ; pour la cantonner,
éventuellement, à la préparation des réunions des chefs d'État ou de
gouvernement.
Dix ans de travail
Quoi qu'il en soit, sous le régime de Lisbonne, le président
du Conseil européen devrait compter avec le maintien d'une présidence
tournante, les États membres continuant d'assurer tour à tour, pour une
durée de six mois, la présidence des différentes formations du Conseil
des ministres (à l'exception du Conseil des Affaires étrangères). Sur
la scène internationale, il devrait se faire une place aux côtés du
Haut Représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la
Politique de sécurité (HR), dont les pouvoirs seraient accrus par
rapport à ceux dont dispose aujourd'hui Javier Solana (lui aussi
maintenu à son poste pour le moment).
« Dans l'accomplissement de son mandat »,
précise le traité sur l'Union européenne, « le Haut
Représentant s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure.
Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques
des États membres et est composé de fonctionnaires des services
compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi
que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux.
L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure sont fixées par une décision du Conseil. »
Autrement dit, tout reste à construire. « C'est un nouveau
travail de dix ans qui s'engage », commente Nicolas
Gros-Verheyde (Bruxelles 2, 9/10/2009).
Concurrence des institutions
Afin d'en jeter les bases, les ambassadeurs du
Coreper II (Comité des représentants permanents à Bruxelles)
vont plancher sur le sujet au moins deux fois par semaine à l'approche
du Conseil des Affaires étrangères du 26 octobre. S'appuyant
sur des éléments issus des administrations existantes, le Service
européen pour l'action extérieure (SEAE) leur fera inévitablement de
l'ombre. Sa mise en place agace naturellement les Britanniques, les
Français témoignant quant à eux du plus grand enthousiasme.
« Le HR est un "objet" non encore identifié, assez
hétéroclite : un peu commissaire, un peu ministre (puisqu'il
préside le Conseil des Affaires étrangères), et toujours diplomate en
chef de l'UE et chef de la défense de l'UE. » Se demandant où
il logera, l'animateur du blog Bruxelles 2
soulève une question qui n'a
rien d'anodine, en ce sens qu'elle illustre la proximité qu'il
entretiendra soit avec les "nationalistes" du Conseil, soit avec les
"apatrides" de la Commission...
On le voit, Vaclav Klaus est loin de tenir entre ses mains
tout le destin du continent. S'il se résout à signer, l'Europe s'en
trouvera-t-elle transfigurée ? Les européistes veulent croire
qu'elle parlera enfin d'une seule voix grâce à Lisbonne. On mesurera
leur manque de réalisme à la lumière des tractations accompagnant la
mise en œuvre du traité... On se souvient de l'interpellation d'Henry
Kissinger : « L'Europe, quel numéro de
téléphone ? » L'ironie de Jean-Louis Bourlanges nous
semble de circonstance : tout au plus l'UE disposera-t-elle
bientôt d'un « standard téléphonique ».
Publié dans Europe | Pas de commentaires