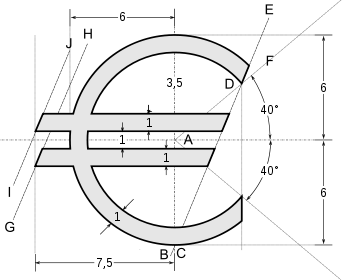20 janvier 2011
Article publié dans L'Action Française 2000
Malmenée par la crise des dettes souveraines, la monnaie
unique suscite des prises de positions ambiguës, où s'entremêlent
parfois les arguments chers à chacun des "camps" souverainiste et
européiste.
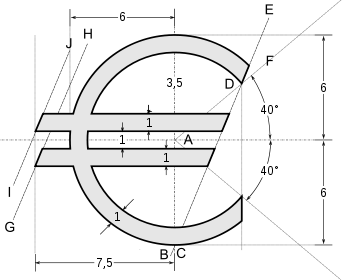
28 % des Français souhaiteraient en finir avec
l'euro, selon un sondage Ifop réalisé pour France Soir
les 5 et 6 janvier. Bien que cette proportion soit en recul
par rapport à novembre, un tabou a manifestement été brisé. Emmanuel
Todd s'en félicite : « L'acquis du dernier trimestre
de 2010, c'est qu'on est arrivé au bout de la croyance en l'euro comme
horizon spécifique pour l'Europe », a-t-il déclaré, pariant
sur la disparition de la monnaie unique sous sa forme actuelle d'ici la
fin de l'année (Le Soir, 04/01/2010).
Deux opposants résignés
Sur la rive droite du souverainisme, Nicolas Dupont-Aignan
s'en donne à cœur joie ; à gauche, en revanche, Jean-Pierre
Chevènement se montre timoré : « Je ne propose pas de
sauter par le hublot », a-t-il expliqué (France Inter,
06/01/2010). Rendant hommage à Philippe Séguin, Henri Guaino a tenu un
discours similaire, soutenant que ce dernier « avait tout
anticipé, tout prévu, et notamment qu'une fois que ce serait fait, il
serait impossible de revenir en arrière » (Les Échos,
06/01/2011). Selon le "conseiller spécial" de Nicolas Sarkozy, en
effet, « sortir de l'euro aurait un coût colossal ».
Allusion, peut-être, au renchérissement de la dette – libellée en euros
– qui résulterait de l'adoption d'une monnaie dévaluée.
Quoi qu'il en soit, selon la "vulgate médiatique" dont le
président de la République se fait ici l'apôtre, « on ne peut
avoir une même monnaie et partager des stratégies économiques
différentes », ni « parler convergence économique
sans convergence des systèmes fiscaux » (Euractiv,
13/01/2010). Outre les souverainistes, des libéraux contestent cette
"surenchère européiste", tel Alain Madelin, pour qui « de
telles propositions, si elles étaient suivies, conduiraient assurément
à l'explosion et de l'euro et de l'Europe ». « Il est
chimérique d'imaginer un budget fédéral européen organisant des
transferts financiers massifs pour compenser les différences de
compétitivité », proclame l'ancien ministre de l'Économie.
« Tout comme il est chimérique de vouloir forcer la solidarité
par l'émission d'obligations européennes communes. » Quant au
projet d'harmoniser les politiques fiscales et sociales « au
travers d'un gouvernement économique », il se heurte, selon
lui, « tant à l'exigence de souplesse et de concurrence de la
zone euro qu'à la nécessité de faciliter les ajustements des
différences nationales par des variations relatives de prix et des
politiques budgétaires autonomes ».
Flatter l'opinion
De son côté, le Premier ministre cultive l'ambiguïté, arguant
de son passé eurosceptique pour légitimer son discours :
« N'ayant pas voté pour le traité de Maastricht, je crois
[...] ne pas pouvoir être suspecté de dogmatisme en la
matière », a-t-il déclaré en présentant ses vœux à la presse.
« Cette crise n'est pas la crise de l'euro », a-t-il
assuré, prenant le contre-pied d'Alain Bournazel (suivre ce
lien). « C'est avant tout la crise de pays qui ont
été affaiblis par la récession économique qui a révélé et qui a
amplifié les lacunes de leurs modèles de croissance. »
François Fillon en viendra-t-il à fustiger l'État-providence ?
Pour l'heure, cet écho à la campagne de Maastricht semble
participer d'un positionnement plus général de l'exécutif, soucieux,
sans doute, de flatter une opinion publique critique à l'égard du
"machin européen", mais soumis, également, à la pression des
circonstances, les périodes de crise soulignant, inévitablement, la
faiblesse des mécanismes communautaires. « Si la volonté
politique [...] est bien présente, "l'esprit européen" ne l'est
toujours pas », déplorait récemment notre confrère Éric Le
Boucher (Les Échos, 14/01/11). Sont-ils
seulement compatibles ?
Publié dans Économie et Industrie, Europe | 1 Commentaire
12 janvier 2011
Intervenant dans la "bataille de l'euro", Alain Madelin se distingue en
fustigeant les velléités fédéralistes dont s'honorent moult défenseurs
de la monnaie unique.
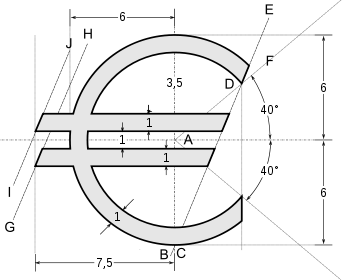
« L'euro a-t-il besoin de plus de
fédéralisme budgétaire et fiscal pour survivre à la
crise ? » Certainement pas aux yeux d'Alain Madelin.
Dans une
tribune publiée le mois dernier (en décembre 2010), l'ancien
ministre de l'Économie conteste vigoureusement les poncifs
européistes : « Plutôt qu'à des surenchères
ultra-irréalistes voire dangereuses, nous ferions mieux de revenir aux
fondamentaux », affirme-t-il : « une stricte
discipline budgétaire et une plus grande flexibilité économique,
assorties d'une police indépendante ».
« Le problème originel de l'euro, c'est
l'hétérogénéité des pays qui l'ont adopté », explique Alain
Madelin. De fait, « nos vieux pays européens ne peuvent guère
être comparés aux États américains de par leurs langues, leurs
cultures, leurs modèles sociaux et familiaux, leurs structures
économiques et démographiques, leurs choix collectifs, leurs niveaux de
dépenses publiques... » Cependant, poursuit-il, « une
telle diversité ne fait pas obstacle à l'adoption d'une même monnaie en
l'absence de véritable État fédéral. L'étalon or hier, le franc CFA ou
le dollar de Hong Kong aujourd'hui montrent que des liens monétaires
fixes peuvent unir des pays fort différents sans besoin d'un
gouvernement commun. » Mais « la solidarité au sein
de l'Europe n'a rien de comparable avec celle qui permet la coexistence
dans une même nation de l'ile-de-France et la Guadeloupe, de l'Italie
du Nord et du Mezzogiorno ou celle qui unit les États américains. Une
solidarité d'ailleurs complétée par la mobilité interne de la
population facilitée par l'usage d'une même langue. »
En conséquence, affirme Alain Madelin, « il est
chimérique d'imaginer un budget fédéral européen organisant des
transferts financiers massifs pour compenser les différences de
compétitivité. Tout comme il est chimérique de vouloir forcer la
solidarité par l'émission d'obligations européennes communes. [...]
Quant à l'idée d'harmoniser [...] les politiques fiscales et sociales
au travers d'un gouvernement économique, il est clair qu'elle se heurte
tant à l'exigence de souplesse et de concurrence de la zone euro qu'à
la nécessité de faciliter les ajustements des différences nationales
par des variations relatives de prix et des politiques budgétaires
autonomes. »
Et Madelin de conclure que « de telles propositions,
si elles étaient suivies, conduiraient assurément à l'explosion et de
l'euro et de l'Europe ».
Publié dans Économie et Industrie, Europe | Pas de commentaires
9 janvier 2011
Commentaire du rapport sur la gouvernance économique
européenne remis au président de la République jeudi dernier,
6 janvier 2011.

À la demande du président de la République, « un
chemin pour un "pilotage économique européen" » a été tracé
par Constance Le Grip et Henri Plagnol, respectivement député
au Parlement européen et député du Val-de-Marne. Leur
rapport reprend moult propositions ouvertement soutenues par
Paris, sinon d'ores et déjà mises en œuvre par l'Union ou ses États
membres. En marge des banalités, on relève un appel à développer les
capacités d'emprunt de Bruxelles, un plaidoyer en faveur d'une gestion
commune des dettes souveraines, et la volonté de réviser en profondeur
le budget communautaire.
Tétanisés par « une montée inquiétante [...] des
mouvements populistes et nationalistes dans l'ensemble de
l'Union », les rapporteurs préviennent « que le
gouvernement économique européen n'est pas le cheval de Troie du
fédéralisme ». « Au cœur de notre
problématique », expliquent-ils, « il y a la défiance
des peuples et des États vis-à-vis de l'Union ». Arguant de
« la complexité institutionnelle de l'Union » (qui
s'avère davantage affectée par son originalité en réalité), ils
martèlent que « seul le Conseil européen constitué des chefs
d'État et de gouvernement peut impulser une dynamique
efficace ». Considérant que « l'Union n'a de raison
d'être que si les États membres ont des intérêts communs à défendre
dans la nouvelle donne mondiale », ils proclament que
« c'est évidemment le Conseil européen qui est la seule
instance légitime pour définir ces intérêts et décider de la meilleure
stratégie pour les promouvoir » - cela en dépit des traités
selon lesquels « la Commission promeut l'intérêt général de
l'Union et prend les initiatives appropriés à cette fin ».
L'implication de la Commission est contestée jusque dans ses missions
les plus traditionnelles : ainsi les rapporteurs
préféreraient-ils confier à un "Conseil des sages", créé à cet effet,
la surveillance des écarts de compétitivité et la responsabilité
d'identifier « des seuils de divergence acceptables ou non en
matière salariale ou sociale ».
S'agit-il d'un tournant ? Pas vraiment. Comme le
rappellent Constance Le Grip et Henri Plagnol, « sous la
pression de la crise, la répartition des rôles a [...]
changé ». Sans doute la personnalité des dirigeants européens
et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ont-ils également
contribué à renforcer le poids du Conseil européen. En pleine
controverse autour des Roms, alors qu'il était encore secrétaire d'État
en charge des Affaires européennes, Pierre Lellouche aurait tenté de
justifier, auprès
de notre confrère Jean Quatremer, la défiance de Paris à
l'égard de l'Europe communautaire. L'Élysée ayant commandité ce
rapport, celle-ci se trouverait-elle délibérément confirmée ?
Publié dans Europe | Pas de commentaires
7 janvier 2011
Bruxelles affiche de timides velléités protectionnistes.

« Il convient [...] de protéger notre propriété
intellectuelle et nos marchés des biens non conformes à nos règles en
matière de protection des consommateurs », a affirmé l'Italien
Antonio Tajani commissaire européen en charge de l'Industrie et de
l'Entreprenariat, dans un
discours diffusé, cette fois-ci, par le service de presse de
Bruxelles.
« Je suis également en train d'envisager
l'opportunité de prendre des initiatives pour protéger nos actifs
stratégiques », a-t-il déclaré, évoquant l'autonomie spatiale,
les terres rares (dont
la Chine a décidé de réduire les exportations), et la
conservation des savoir-faire technologiques.
« Il nous faut prendre acte du fait que les marchés
sont devenus mondiaux, avec des chaînes de valeur disséminées autour du
globe », a-t-il encore observé. Arguant de ce constat
inévitable, il s'est dit « convaincu qu'il n'est plus possible
de réfléchir en termes de marchés nationaux et de politiques
économiques nationales ». Sur ce point au moins, sans doute y
a-t-il matière à discussion !
Publié dans Europe | Pas de commentaires
6 janvier 2011
Article publié dans L'Action Française 2000
Puissant moteur de l'intégration européenne, la Cour de
Justice de Luxembourg (CJUE) a failli à sa réputation le mois dernier.

Ainsi a-t-elle jugé « conforme au droit de
l'Union » l'interdiction d'admettre des non-résidents dans les
coffee-shops néerlandais. De son point de vue,
« l'introduction de stupéfiants dans le circuit économique et
commercial de l'Union étant interdite, un tenancier d'un coffee-shops
ne saurait se prévaloir des libertés de circulation ou du principe de
non-discrimination, en ce qui concerne l'activité consistant en la
commercialisation du cannabis ». Aussi la décision du conseil
communal de Maastricht lui apparaît-elle « justifiée par
l'objectif visant à lutter contre le tourisme de la drogue et les
nuisances qu'il draine, objectif se rattachant tant au maintien de
l'ordre public qu'à la protection de la santé des citoyens ».
Des patronymes non reconnus
Par ailleurs, toujours selon la Cour de Justice de l'Union
européenne, « un État membre peut refuser de reconnaître le
nom d'un ressortissant contenant un titre de noblesse, tel qu'il a été
obtenu dans un autre État membre ». Affirmant « que
l'Union respecte l'identité nationale de ses États membres »,
la Cour estime que « la forme républicaine de
l'État » en fait aussi partie. « Elle admet donc que,
dans le contexte de l'histoire constitutionnelle autrichienne, la loi
d'abolition de la noblesse peut être considérée comme une justification
d'ordre public et, par conséquent, être mise en balance avec le droit
de libre circulation des personnes reconnu par le droit de
l'Union. » D'autant que cette loi constitue à ses yeux
« la mise en œuvre du principe plus général de l'égalité en
droit de tous les citoyens autrichiens, principe que l'ordre juridique
de l'Union tend à assurer en tant que principe général du
droit ».
Publié dans Europe | Pas de commentaires
4 décembre 2010
Relevé de quelques approximations.

Annonçant l'entrée probable de la Bulgarie et la Roumanie dan
l'espace Schengen en mars 2011, le site du Figaro
avait
affirmé qu'à partir de cette date, Paris ne pourrait plus
expulser certains Roms. Ce faisant, le quotidien confondait la
suppression des contrôles aux frontières avec celle des restrictions à
la liberté d'installation, applicables jusqu'au 1er janvier
2014.
Si
l'on en croit Jean-Philippe Chauvin, Le Monde
prétendrait quant à lui que les rémunérations des fonctionnaires
européens seraient fixées par les traités, négligeant l'existence d'un
statut ad hoc voté par le Conseil.
Enfin, tout
en reprenant l'illustration, Le Salon Beige
n'a pas lu notre
article consacré aux divorces transfrontaliers, contribuant à
diffuser l'erreur commise par Ouest France, qui
attribue au traité de Lisbonne, et non à celui d'Amsterdam,
l'introduction des coopérations renforcées dans le droit primaire
européen.
Peut-être les lecteurs de L'Action Française 2000
sont-ils d'ores et déjà mieux informés que ceux des titres plus
diffusés ! 😉
Publié dans Europe | 1 Commentaire
3 décembre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Union européenne va-t-elle entamer la nouvelle année sans
être parvenue à se doter d'un budget ? Soumis au chantage du
Parlement européen, trois États lui ont résisté jusqu'à maintenant.

La négociation du budget européen pour 2011 se heurte aux
rivalités institutionnelles. Réunis au sein d'un "comité de
conciliation", les représentants des gouvernements et du Parlement
européen ont échoué à s'accorder dans les délais impartis. Aussi la
Commission a-t-elle travaillé « au pas de course »
afin de présenter un nouveau projet susceptible d'être adopté d'ici la
fin de l'année.
Des exigences politiques
« Extrêmement déçu », José Manuel Barroso a
regretté « qu'un petit nombre d'États membres n'ait pas été
disposé à négocier dans un esprit européen ». Les Pays-Bas, le
Royaume-Uni et la Suède sont-ils coupables d'avarice ? Disons
plutôt que leurs gouvernements se montrent jaloux de leurs
prérogatives. « La discussion ne porte pas sur la question
d'avoir davantage d'argent, mais sur la direction que prend
l'UE », a expliqué l'Allemand Martin Schulz, chef de file des
députés socialistes et démocrates. « Nous n'avons pas demandé
un euro de plus par rapport à ce que le Conseil propose », a
confirmé le Polonais Jerzy Buzek, président du Parlement européen. En
effet, le différend tient aux conditions politiques dont l'assemblée
européenne prétend assortir son approbation du budget.
Entré en vigueur il y a tout juste un an ce
1er décembre, le traité de Lisbonne a conforté son contrôle
sur les dépenses planifiées chaque année. Lesquelles dépendent
toutefois d'un "cadre financier pluri-annuel", ainsi que du montant des
ressources affectées à l'UE. Or, le droit primaire européen demeure
assez flou quant aux modalités d'implication du Parlement dans leur
définition. Aussi les eurodéputés cherchent-ils à tirer le meilleur
profit du rééquilibrage institutionnel en cours. De fait,
« les négociations sur le budget de l'année prochaine ont
échoué à cause de l'ambition de ce Parlement d'obtenir davantage de
pouvoirs sur le budget », a résumé la Britannique Marta
Andreasen, qui siège dans le groupe Europe libertés démocratie, et se
trouve bien isolée dans l'hémicycle.
L'assemblée réclame « un accord sur une procédure et
un ordre du jour » qui lui assureront « d'être
impliqué[e] dans les discussions sur de nouvelles sources de revenus
pour l'UE ». Ce faisant, les députés espèrent diminuer la part
des contributions directes des États dans le budget européen – prétexte
régulier à des querelles de chiffonniers il est vrai. Le Parlement se
défend néanmoins de plaider en faveur d'un "impôt européen" :
« La plupart des députés estiment qu'un impôt de l'UE
représenterait une perspective complètement irréaliste »,
a-t-il observé dans un communiqué. « Pour créer cet impôt, non
seulement l'unanimité au Conseil serait nécessaire, mais également une
adoption dans tous les parlements nationaux, soit une "double
unanimité". »
Douzièmes provisoires
Si aucun budget n'est adopté d'ici le 1er janvier,
l'Union s'appuiera sur un système autorisant pour chaque chapitre des
dépenses mensuelles correspondant au douzième du budget correspondant
de l'année précédente. « Ce système ne tient pas compte du
fait que les paiements sont plus élevés certains mois de l'année que
d'autres », a prévenu le Parlement. Sur proposition formelle
de la Commission, le Conseil peut toutefois décider, à la majorité
qualifiée, d"autoriser des dépenses excédant le douzième ; le
Parlement européen doit alors approuver ou réduire ce montant dans les
trente jours.
La mise en œuvre du Service européen pour l'Action extérieure,
des nouveaux organes de supervision financière et du projet ITER se
trouverait tout particulièrement affectée. « Surtout dans le
domaine de l'agriculture, il y aura urgence. Les États membres ont
avancé des paiements directs aux agriculteurs pour un montant de
30 milliards d'euros et la Commission européenne doit les
indemniser en janvier 2011. » Or, sur la base des douzièmes
provisoires, elle ne disposerait que de 6 milliards d'euros.
Des chiffres qu'on ne manquera pas de rappeler lors du Conseil européen
des 16 et 17 décembre, où les chefs d'État ou de gouvernement
des Vingt-Sept se saisiront directement de la question.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
3 décembre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Aperçu des derniers rappels à l'ordre en provenance de
Bruxelles et Luxembourg.

De nouvelles remontrances ont été rendues publiques par
Bruxelles le 24 novembre. Les avis motivés et autres
poursuites concernant la France portent sur des sujets
divers : le maintien des taxes locales sur
l'électricité ; le défaut de transposition d'une directive
harmonisant les crédits aux consommateurs ; le refus de
traiter les demandes d'autorisation de mise sur le marché de deux
médicaments vétérinaires ; les entraves au commerce du lait de brebis
ou de chèvre établies par crainte de la tremblante.
Tandis que la Lituanie est priée de lever les obstacles à la
commercialisation des véhicules avec conduite à droite, la Grèce est
mise en cause pour un marché portant sur des équipements militaires
(des batteries pour sous-marins). « L'appel d'offre exigeait
que 35 % des matériels utilisés pour les batteries soient
fabriqués en Grèce », explique la Commission. « Les
autorités grecques justifiaient cette exigence particulière par des
intérêts en matière de sécurité nationale, ce qui, selon elles,
rendrait inapplicables les règles de l'UE en matière de passation de
marchés publics. » Toutefois, estime Bruxelles, « les
États membres ne peuvent déroger de manière discrétionnaire aux règles
générales en matière de marchés publics lorsqu'ils achètent des
équipements militaires. De l'avis de la Commission, les autorités
grecques enfreignent la réglementation de l'UE en ne fournissant pas
d'arguments détaillés et raisonnés pour démontrer que l'application des
règles générales de l'UE en matière de passation de marchés publics
mettrait en péril les intérêts de la Grèce en ce qui concerne sa
sécurité. » Quid de la confidentialité
associée traditionnellement aux contrats militaires ?
Désireux de réduire de 3,7 à 1,85 % la hausse des
rémunérations des fonctionnaires européens, les gouvernements des
Vingt-Sept se sont heurtés aux règles qu'ils avaient eux-même édictées,
que viennent de leur rappeler les juges de Luxembourg :
« En examinant la fonction de l'annexe XI du statut
des fonctionnaires [...] la Cour conclut que [...] le Conseil a pris la
décision autonome de se lier, pour la durée de la validité de ladite
annexe, dans l'exercice de son pouvoir. » Caricaturale
illustration de la "servitude
volontaire" consentie par les responsables nationaux afin de
se prémunir des infractions de leurs pairs.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
1 décembre 2010
La crise des dettes souveraines suscite l'attente d'une
"divine surprise". Mais l'enthousiasme des souverainistes appelle selon
nous quelques nuances.
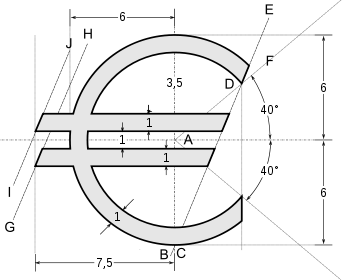
Emboîtant le pas a la Revue critique,
le Centre royaliste d'Action française ouvre son blog à François Renie,
qui
annonce le « crépuscule de l'euro ». De
fait, la l'éclatement de l'Union économique et monétaire (UEM) n'est
plus un tabou. Depuis quelque temps, les analystes se succédant au
micro de BFM Radio (devenue BFM Business) évoquent
ouvertement cette perspective.
Cela dit, l'auteur a-t-il dressé un tableau fidèle du
mécontentement social attisé par la crise et les mesures
d'austérité ? Les rues d'Athènes « accueillent
toujours les mêmes foules imposantes », affirme-t-il,
signalant que « le gouvernement socialiste de
M. Papandréou vient de subir un échec aux élections
locales ». À l'opposé, Jean
Quatremer estime que « les Grecs sont
résignés » : « Non seulement les
manifestations ne font pas le plein, mais le PASOK, le parti socialiste
grec, au pouvoir depuis octobre 2009, vient de remporter haut la main
les élections municipales et régionales dont le second tour a eu lieu
le 14 novembre. [...] Sur treize régions, huit (dont
l'Attique, région la plus peuplée) vont au PASOK qui réussit même
l'exploit d'arracher à la droite Athènes et Thessalonique, les deux
principales villes du pays. » Certes, l'abstention refléterait
la grogne populaire, « mais pas au point de remettre en cause
la rigueur ». D'ailleurs, « en Attique, deux
candidats (un de droite, un de gauche) ayant mené campagne contre le
mémorandum UE-FMI ont été éliminés ». Notre confrère nous
aurait-il menti ?
Nous sommes peu enclin à le croire, étant donné le manque de
mesure – voire les relatives approximations – dont semble témoigner son
détracteur. Selon lui, « la Commission et le directorat
européiste de l'Union » auraient annoncé « une
prochaine révision des traités européens, dans le sens, naturellement,
d'un durcissement des critères de convergence ». Or, le projet
de révision, officialisé
à l'issue du Conseil européen des 28 et 29 octobre,
porte uniquement sur la pérennisation du Fonds européen de
stabilisation financière. L'institution d'un "semestre budgétaire", par
exemple, s'inscrit dans le cadre du droit primaire existant.
Enfin, bien que l'euro soit plus au moins calqué sur le mark,
l'influence de l'Allemagne n'est pas sans limite. Berlin
« détient [...] tous les pouvoirs de fait au sein de la
BCE », soutient François Renie. Or, Axel A. Weber, le
président de la Bundesbank, est entré en conflit ouvert avec
Jean-Claude Trichet, après qu'il fut mis en minorité par le Conseil des
gouverneurs de la Banque centrale européenne décidant le rachat de
titres obligataires. L'auteur promet encore « une offensive
sans précédent de Berlin [...] pour mettre l'ensemble de l'économie
européenne sous contrôle », annonçant que la France,
« selon son habitude, suivra les injonctions allemandes [sans]
broncher ». C'est oublier l'accueil qui fut réservé outre-Rhin
au compromis franco-allemand arrêté à Deauville le 18 octobre.
« Le gouvernement allemand a spectaculairement échoué dans sa
volonté de faire du Pacte de stabilité un nouvel instrument de
discipline budgétaire », commentait alors le Financial
Times Deutschland. Il est vrai que la stricte automaticité des
sanctions a été refusée par Paris. Quant à la suspension des droits de
vote au Conseil, elle a été renvoyée aux calendes grecques par le
Conseil européen. C'était prévisible et, pour cette raison, le soutien
français accordé à cette revendication n'apparaît pas forcément comme
un reniement idéologique.
Cela étant, la France est-elle bien inspirée de négocier les
marges de manœuvre qui la précipiteront vers la banqueroute ?
En pratique, le poids de la dette entrave le pays bien davantage que le
carcan juridique européen, qui n'est somme toute qu'un outil dont la
pertinence de l'emploi devrait être évaluée en fonction d'objectifs
préalablement définis.
PS - Au lieu de cela, on nous propose un vague projet institutionnel,
dont l'auteur regrette certes qu'il ne soit pas davantage abouti. Ce
serait « une Europe des ingénieurs et des créateurs, des
producteurs et des artistes et non plus l'Europe des énarques et des
juristes que nous connaissons aujourd'hui ». Comme si l'une
était exclusive de l'autre ! Tandis qu'il imagine que l'UE se
fonde « sur la chimère d'un "État européen" »,
l'auteur néglige la multiplicité des coopérations internationales
d'ores et déjà mises en œuvre sans l'intervention de Bruxelles. Parmi
celles que nous avons croisées récemment figurent la convention
Schengen originelle, le Triangle de Weimar, l'Initiative
5 + 5 Défense, Eurogendfor, le Commandement européen
de transport aérien (EATC), l'Agence spatiale européenne... Autant de
projets échafaudés indépendamment les uns des autres, ce qui rend
d'autant plus inconséquentes les incantations en faveur d'une
« Europe des nations ».
Publié dans Europe, Souverainisme | Pas de commentaires
5 novembre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Afin de pérenniser le fonds européen de stabilisation
financière bricolé dans l'urgence – le "FMI européen" –, les Vingt-Sept
sont convenus d'un accord dont les ambiguïtés reflètent les divergences
franco-allemandes.

Moins d'un an après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
les chefs d'État ou de gouvernement des vingt-sept pays de l'UE sont
convenus, à l'issue de leur réunion des 28 et 29 octobre,
d'une nouvelle révision du droit primaire européen. Il s'agira d'une
« révision light », selon
l'expression du président de la République, censée pérenniser le fonds
européen de stabilisation financière. Mis en place dans l'urgence pour
répondre à la crise de la dette souveraine, celui-ci se heurterait
vraisemblablement au juge constitutionnel allemand s'il était maintenu,
au-delà de 2013, en l'état des traités, vis-à-vis desquels il s'est
autorisé quelques accommodements.
Diktat franco-allemand
L'affaire semblait pliée dès la semaine précédente. Du moins
Nicolas Sarkozy et Angela Merkel l'avaient-ils laissé entendre en
exposant leur position commune arrêtée le 18 octobre,
suscitant la colère de Viviane Reding. « Les décisions de
l'Union européenne ne sont pas prises à Deauville », a-t-elle
protesté. Dans un entretien accordé au quotidien allemand
Die Welt, elle a jugé « complètement irresponsable de
mettre sur la table des chimères à propos de nouveaux
traités » (Euractiv, 28/10/2010). Le
risque est grand d'ouvrir la boîte de Pandore. Or, le processus de
ratification sera d'autant plus hasardeux que la réforme sera
substantielle : le spectre d'un nouveau référendum irlandais
hante les arcanes européennes.
Le chef de l'État a balayé les commentaires du commissaire
luxembourgeois. « Je ne la connais pas personnellement et je
n'attache pas plus d'importance à ce qui a été dit », a-t-il
lancé à un journaliste qui l'interpellait à ce sujet. « En
revanche, a-t-il poursuivi, j'attache beaucoup d'importance à la
décision unanime du Conseil européen. Cela a un autre poids. »
Du moins, à ses yeux. Derrière les anathèmes se dessinent, encore une
fois, des rivalités institutionnelles. Les chefs d'État ou de
gouvernement ont confié à "leur" président, celui du Conseil européen,
Herman Van Rompuy, la tâche de mener les consultations préalables à la
révision des traités. Dans un entretien accordé au Monde,
Jean-Luc Sauron a souligné « une dépossession de la Commission
sur ce volet-là ». Cela confirmerait un rééquilibrage de la
mécanique européenne au profit des rouages intergouvernementaux si,
parallèlement, le Parlement européen ne poursuivait pas sa montée en
puissance.
La quadrature du cercle
Une fois n'est pas coutume, l'assemblée devrait se satisfaire
d'une procédure de révision accélérée, à laquelle elle se contentera
d'acquiescer. On imagine mal les eurodéputés, adeptes des postures
morales, freiner l'institution d'un mécanisme symbolisant la solidarité
européenne. Cela dit, les considérations nationales sont toujours de
mise, au point de se mêler dans un compromis plein d'ambiguïtés.
Paris prétend dissiper la méfiance des investisseurs à l'égard
des obligations émises dans la zone euro... avec le risque de
contribuer à l'entretien du laxisme budgétaire honni par Berlin. Aussi
le Conseil européen a-t-il souligné, dans ses conclusions,
« la très stricte conditionnalité à laquelle doit être
subordonnée l'action menée dans le cadre de ce type
d'instrument ». Concrètement, les États bénéficiant de son
soutien pourraient être conduits à restructurer leur dette, aux dépens
de leurs créanciers. Jean-Claude Trichet, le président de la Banque
centrale européenne, se serait vigoureusement opposé à cette annonce,
craignant de déclencher la panique sur les marchés financiers.
Esquissant une solution à la quadrature du cercle, il appelait à des
sanctions plus fermes à l'encontre des États manquant à leurs
obligations budgétaires. C'était oublier le fossé séparant les cultures
politiques de part et d'autre du Rhin...
Les droits de vote maintenus au Conseil
Finalement, le duo franco-allemand a convaincu ses partenaires
d'adopter des sanctions "semi-automatiques". Sanctions financières,
mais non politiques, le projet de suspendre le droit de vote des États
défaillants étant rangé dans un tiroir. « Le président du
Conseil européen entend examiner par la suite, en consultation avec les
États membres, la question du droit des membres de la zone euro de
participer à la prise de décisions [...] en cas de menace permanente
pour la stabilité de la zone euro dans son ensemble »,
stipulent les conclusions du sommet. « Les oppositions à cette
idée ont été virulentes, voire très virulentes », aurait
déclaré Jean-Claude Juncker (Euractiv,
29/10/2010). Étant donné la complexité juridique de sa mise en œuvre,
on se demande si Berlin ne l'a pas agitée, avec le soutien de Paris,
dans l'espoir d'obtenir la satisfaction d'autres exigences (une
hypothèse formulée notamment par l'Irish Times).
Ce projet reviendra-t-il sur la table ? Les paris sont ouverts.
Publié dans Europe | Pas de commentaires