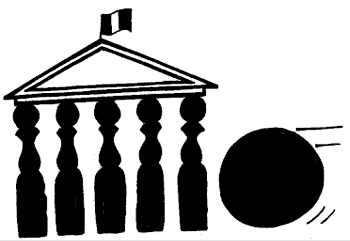20 décembre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Dans la continuité du rapport Védrine, Laurent Fabius entend
préserver le statut de la France dans l'Otan, tout en construisant
l'"Europe de la Défense".

La France continuera de jouer les empêcheurs de tourner en
rond : telle est, en substance, la promesse formulée par
Laurent Fabius dans l'International Herald Tribune
du 5 décembre 2012. Évoquant les relations de Paris avec
l'Alliance atlantique, le ministre des Affaires étrangères martèle que
« la France est un allié exerçant sa responsabilité de membre
fondateur, engagé au service de valeurs communes, mais qui n'hésite
pas, si nécessaire, à faire valoir loyalement ses
différence ». Autrement dit : « allié oui,
aligné non ». La France n'en demeurera pas moins au sein du
commandement intégré de l'Otan : « il n'est pas
question d'organiser un va et vient permanent », prévient
M. Fabius.
Chantre de « l'Europe de la défense », qu'il
juge « indissociable du projet d'Union politique » -
et donc tout aussi vaine selon nous -, le ministre des
Affaires étrangères soutient que « c'est l'Union européenne,
en tant que telle, qui devrait agir lorsque les intérêts de sécurité
des Européens sont d'abord en jeu ». Dès à présent, il nous
faudrait « agir en ce sens, alors que notre pays, mobilisé ces
dernières années par son retour dans le commandement intégré de l'Otan,
s'est montré plutôt parcimonieux dans les moyens consacrés à l'Europe
de la défense. Nous allons poursuivre le travail de conviction auprès
des institutions et de l'ensemble de nos partenaires européens, y
compris britanniques. »
Ceux-ci se sont farouchement opposés à toute revalorisation du
budget de l'Agence européenne de défense, fût-ce pour compenser
l'inflation. C'est dire l'ampleur de la tâche que prétend s'assigner le
gouvernement français. En revanche, Londres demeure ouvert aux
coopérations bilatérales. À ce titre, un niveau d'intégration inédit a
été atteint avec l'embarquement pour plusieurs mois d'un détachement
aéronautique britannique à bord d'une frégate de la Marine française.
Ironie de l'histoire, c'est depuis le Surcouf
qu'opère, ces jours-ci, un hélicoptère Lynx de Sa Majesté.
Publié dans Défense | Pas de commentaire | Lien permanent
6 décembre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Un commentaire du rapport Védrine écrit pour L'Action
Française 2000, où il ne s'agissait pas de faire
l'apologie de lAlliance Atlantique !

Au cours de la campagne électorale, prenant le contre-pied de
son rival, François Hollande avait annoncé qu'il évaluerait les
conséquences du retour de la France dans le commandement intégré de
l'Otan, décidé par Nicolas Sarkozy, s'il lui succédait à l'Élysée.
Devenu président de la République, il a confié à Hubert Védrine la
mission de solder l'affaire. Dans son rapport, remis le mois dernier,
celui-ci exclut tout retour en arrière : « une
(re)sortie française du commandement intégré n'est pas une
option », écrit-il. « Elle ne serait comprise par
personne ni aux États-Unis ni en Europe, et ne donnerait à la France
aucun nouveau levier d'influence. [...] Au contraire cela ruinerait
toute possibilité d'action ou d'influence pour elle, avec tout autre
partenaire européen, dans quelque domaine que ce soit. »
D'ailleurs, observe-t-il, « de 1966 à 2008, soit en plus de
quarante ans, aucun pays européen n'a rejoint la ligne d'autonomie
française ».
Un bilan provisoire
De toute façon, trois ans après la réintégration, il est trop
tôt pour en dresser le bilan, proclame, en substance, l'ancien ministre
des Affaires étrangères. Son évaluation, qui se veut
« provisoire », mentionne « une influence
réelle ou faible, variable selon les sujets ; un surcoût, plus
faible que prévu ; des opportunités économiques ou
industrielles, liées ou non à ce retour, mais aussi beaucoup de risques
potentiels ». Plus concrètement, Hubert Védrine rappelle qu'un
Français a pris la tête du Commandement allié pour la Transformation
(ACT). En conséquence, la France a pu « participer aux
réflexions prospectives sur l'Alliance, et à la définition du nouveau
concept stratégique de 2010 », soutient le rapporteur. Selon
lui, Paris « a joué un rôle moteur depuis 2009 pour
hiérarchiser les priorités, refondre les procédures, ramener le nombre
des agences de quatorze à trois (en en espérant une économie de
20 %), réduire la structure de commandement (réduction des
personnels de - 35 % en 2013), diminuer de onze à sept
les états-majors et donc faire faire des économies ».
En revanche, déplore-t-il, la France a donné son aval au
développement d'une défense antimissile territoriale « sans
influencer, ralentir ou modifier » ce projet « qui
comporte un potentiel de bouleversement stratégique ». À la
suite d'Hubert Védrine, « il faut le dire
clairement : l'Otan restera une alliance autour de la première
puissance militaire du monde, les États-Unis ». Selon que l'on
ait eu ou non la naïveté de croire au Père Noël, le verre apparaîtra à
moitié vide ou à moitié plein : « Le retour de la
France dans le commandement intégré [...] a élargi l'opportunité de
marchés pour l'industrie française mais ne s'est pas traduit à ce stade
par un accroissement marqué des contrats obtenus. » Hubert
Védrine appelle à définir « une stratégie industrielle [...]
avec un repérage précoce des perspectives de contrat [...] sur la base
d'une répartition préalable claire des programmes entre l'Otan et
l'Agence européenne de défense » (AED). Il propose de
« consolider le mécanisme informel mais essentiel de
consultation entre le commandant suprême chargé de la transformation,
SACT, et la directrice exécutive de l'AED » - en l'occurrence
deux Français, le général Paloméros et Mme Claude-France
Arnould. « Bien évidemment, aucun allié ne marchera dans cette
proposition », commente le géopolitologue Olivier Kempf, sur
son blog Egea. Paris n'en aurait pas moins une
carte à jouer selon lui : « s'associer avec des
petits ou moyens sur tel ou tel projet, de façon à développer une
influence politique et des projets industriels, labellisés Otan, qui
auront du coup des perspectives ailleurs ». Une piste à
explorer ?
Appel à la vigilance
Appelant à la « vigilance », Hubert Védrine
pointe « le risque de "phagocytage" conceptuel et
théorique ». « Il faudra que notre armée préserve sa
capacité propre d'analyse des menaces, de réflexion et de prévision sur
les scénarios et même de planification », prévient-il. À
l'inverse, l'intégration recèle un potentiel d'émulation souligné par
Catoneo sur le blog Royal Artillerie :
« Le travail en Afghanistan [...] mené en coalition [...] ne
souffrait pas d'excuses ou le camouflage des insuffisances car il n'y
avait rien à "expliquer" à quelque supérieur hiérarchique ayant la main
sur la carrière. Tout se sait, immédiatement, à haut niveau, se corrige
immédiatement (en théorie). Le résultat obtenu est un rehaussement
qualitatif sensible des aptitudes au combat. »
Par ailleurs, poursuit Védrine, « nous devrons
veiller » à ce que l'Otan « reste une alliance
militaire, recentrée sur la défense collective, et le moins possible
politico-militaire dans son action ». Il y a deux ans,
l'amiral Giampaolo di Paola, président du Comité militaire de l'Otan,
n'avait-il pas déclaré que « la dimension de genre devrait
faire partie intégrante des activités de chaque division, de chaque
opération » ? Cela dit, Hubert Védrine s'inquiète
plutôt d'une immixtion de l'Otan dans le domaine "civilo-militaire", là
où l'Union européenne « a potentiellement une vraie capacité
globale de traitement des crises : économique, civile et
militaire ».
De fait, selon Védrine, UE et Otan sont « les deux
faces d'une même médaille ». On peine toutefois à les
distinguer clairement l'une de l'autre. « Dans le domaine
politique, pour autant que nos partenaires européens se prêtent à une
concertation en amont sur les questions relatives à l'Otan, il pourrait
être envisagé en parallèle que les États-Unis soient consultés, voire
associés, à certaines délibérations européennes par exemple celle du
COPS » (le Comité politique et de sécurité). Peut-être cela
supposerait-il de régler au préalable le différend chyprio-turque....
Vaste programme ! « Par ailleurs, il pourrait être
mis un terme à l'opération Ocean Shield de l'Otan contre la piraterie
au large de la Somalie (à l'issue de son mandat fin 2014), qui fait
double emploi » avec l'opération européenne Atalante.
« La logique opérationnelle et rationnelle commanderait de
fermer cette opération », confirme notre confrère Nicolas
Gros-Verheyde, animateur du blog Bruxelles 2.
« Mais il faudrait trouver une solution pour associer les
marines turque et danoise, ou canadienne, à l'opération européenne, par
exemple. Ce qui n'est pas évident – le processus d'association de
partenaires extérieurs à des opérations de l'UE est plutôt lourd. Et il
se heurte à deux obstacles politiques de taille : l'opt-out
danois en matière de défense d'une part ; le blocage
turco-chypriote qui trouble les relations Otan-UE de l'autre. [...]
Pour un pays, comme la Turquie, cette opération [...] permet aussi de
continuer à faire croiser des navires dans une zone régionale qu'il
considère stratégique. »
Europe puissance
Toujours circonspect quant aux perspectives ouvertes par
"l'Europe de la défense", Hubert Védrine se garde toutefois de la
définir, cultivant l'ambiguïté à son propos : s'il semble en
exclure les coopérations bilatérales, il y inclut apparemment les
initiatives mulilatérales lancées en marge de l'UE, tel le Commandement
européen du transport aérien (EATC). Pourtant, souligne-t-il,
« les mots doivent être employés à bon escient. "Europe de la
défense" et encore moins "défense européenne" ne signifient [...] la
défense militaire de l'Europe contre des menaces militaires, ce dont
seule l'Alliance, avec les moyens américains, serait capable, si par
malheur, l'Europe était attaquée. [...] Pour ne pas alimenter des
espérances chimériques et donc des déceptions, ou des craintes hors de
propos chez nos Alliés, il faut réserver ce terme à des initiatives ou
à des actions extérieures de l'Union en matière militaire ou
civilo-militaire, ou à des coopérations en matière d'industrie de
défense. »
Dissipant des illusions, Hubert Védrine entretient néanmoins
le mythe de l'Europe puissance. Un vieux tropisme gaullien ?
Peut-être bien. À l'image du Général, quoique sur un mode beaucoup plus
modéré, Hubert Védrine maintient la distance à l'égard de l'oncle Sam
sans envisager la rupture. Loin s'en faut. D'autant que « les
Américains voient [...] la France comme un partenaire européen sûr du
fait de la réduction visible des capacités militaires du Royaume-Uni,
des inhibitions politiques de l'Allemagne, et du décrochage de
capacités chez les autres Alliés. Ils espèrent donc vivement que la
France ne va pas réduire davantage ses capacités. Cette "disponibilité"
américaine, réelle à la Maison-Blanche [...] sera quand même fonction
des capacités militaires des Européens, et de leur volonté
politique. » Autrement dit : la balle est dans notre
camp. Saurons-nous la saisir ? « Depuis la fin de
l'URSS [...], ce sont les "dividendes de la paix", "du social" et de
l'augmentation de pouvoir d'achat ou de l'affirmation de droits
individuels qu'attendent les Européens. On est très loin de la
dialectique menaces sécuritaires-réponses militaires, même dans le
domaine du terrorisme, ou de la vision américaine des risques et des
menaces stratégiques. » Quoi qu'on pense de l'intervention
française en Libye, il n'est pas inutile de rappeler que celle-ci
n'aurait pu s'effectuer sans le soutien américain, faute de moyens
suffisants pour ravitailler les avions de combat. C'est dire l'ampleur
de la tâche qu'il faudrait accomplir pour s'émanciper de l'Alliance
Atlantique.
Publié dans Défense | 1 commentaire | Lien permanent
15 novembre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Mesure phare du "pacte de compétitivité" présenté par
Jean-Marc Ayrault, le crédit d'impôt promis aux entreprises est un
succédané de la "TVA sociale" promue par la majorité précédente afin
d'enrayer les délocalisations.

François Hollande et son gouvernement pratiquent le reniement
avec une remarquable habileté. Tant mieux, aux yeux du
patronat : abrogée par la nouvelle majorité, après avoir été
votée par la précédente, la "TVA sociale" figure parmi les trente-cinq
mesures du "Pacte national pour la croissance, la compétitivité et
l'emploi" présenté le 6 novembre 2012.
Projet alambiqué
D'une législature à l'autre, les modalités ont évolué ; le
projet socialiste s'avère quelque peu alambiqué : la taxation
accrue de la consommation devrait contribuer à financer non pas une
baisse formelle des charges, mais une crédit d'impôt indexé sur la
masse salariale des entreprises. De cette façon, explique notre
confrère Vincent Collen, « les entreprises vont intégrer
l'effet bénéfique dans leurs comptes dès 2013, alors que le coût pour
les finances publiques n'interviendra qu'en 2014. Ce qui permet
d'éviter toute mesure récessive supplémentaire l'année
prochaine. » Par ailleurs, précise-t-il dans Les Échos,
« le financement de la protection sociale n'est pas affecté,
ce qui a permis à l'exécutif de trancher sans attendre les résultats
d'une longue concertation ».
C'est un geste bienvenu à l'intention des entreprises,
vis-à-vis desquelles le gouvernement avait manifesté peu d'égards
jusqu'à présent. En outre, cette initiative semble participer de la
mise en œuvre du "patriotisme économique" cher à
M. Montebourg, étant donné que le transfert opéré pèsera
notamment sur les produits importés. L'économie nationale pourrait en
tirer profit... à moins que nos compatriotes renoncent à l'achat de
quelque produit "made in France" pour compenser le surcoût de leur
téléviseur fabriqué en Corée. Concrètement, selon l'estimation de notre
confrère Yann Philippin, calculée pour Libération,
« le dispositif ferait chuter le prix de revient d'une
[Peugeot] 208 assemblée à Poissy (Yvelines) de seulement
1,3 % ». Pas de quoi bouleverser la donne.
La France hors jeu
Selon un rapport du Sénat, « à la fin de 2009, le
coût de la main d'œuvre roumaine ou bulgare était dix fois moins élevé
qu'en France, celui de la Pologne et de la Slovaquie cinq fois moins
élevé et celui du Portugal ou de la Grèce respectivement trois et deux
fois moins élevé que celui de la France ». Dans ces
conditions, il serait illusoire de vouloir affronter les pays "à bas
coûts" sur leur propre terrain. Autant vider l'océan à l'aide d'une
cuillère à café ! Taxé d'immobilisme, soucieux de répondre à
la hantise des délocalisations, la peur du plombier polonais, la
terreur de l'invasion chinoise, le gouvernement s'y essaie néanmoins,
timidement. Au risque, selon nous, d'entretenir un certain défaitisme,
nourri d'une conception malthusienne de l'emploi – celle d'un gâteau
que nous devrions nous résoudre à partager, plutôt que de nous mettre
aux fourneaux. De fait, le coup de pouce gouvernemental sera découplé
des plus hauts salaires. Alors que Louis Gallois proposait de fixer un
seuil à 3,5 fois le Smic, celui-ci devrait être cantonné à
2,5 Smic. Patrick Kron, le P-DG d'Alstom, s'en
désole : « Tout le monde s'accorde à dire que la
France doit innover, monter en gamme », a-t-il rappelé à La Tribune.
« Va-t-on monter en gamme avec des salariés payés au Smic ?
Est-ce totalement logique et totalement cohérent ? »
Dévaluation fiscale
Quoi qu'il en soit, « une politique de compétitivité
suppose une action dans la durée », comme l'a déclaré le
président de la République. Thomas Philippon, professeur à l'université
de New York, met en garde contre le recours aux "solutions miracles".
« Croire que la France va régler son problème de compétitivité
par la magie d'un transfert de charges sociales vers la CSG ou la TVA
n'est pas réaliste », a-t-il déclaré à Acteurs
publics. « D'un point de vue macroéconomique, une
telle opération aura à peu près le même effet qu'une dévaluation.
C'est-à-dire que l'avantage compétitif durera le temps que l'ensemble
des prix et salaires s'ajustent. Ce n'est pas une solution
structurelle. » Son analyse rejoint celle du FMI, selon lequel
« transférer le coût des allégements de cotisations patronales
vers les revenus [...] n'aurait probablement que des effets temporaires
si elle n'est pas accompagnée par des gains de productivité qui
permettent aux salaires réels de compenser progressivement la perte de
pouvoir d'achat ». Les colonnes de L'Action
Française 2000 sont ouvertes au débat sur les
dévaluations. Un constat s'impose néanmoins : quoique les
responsables politiques se disent déterminés à "sauver" l'euro, ils
semblent nostalgiques des facilités que leur assurait le contrôle d'une
monnaie nationale.
Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaire | Lien permanent
15 novembre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Renault va ressusciter Alpine, une marque sportive qui sera le
fer de lance de sa montée en gamme à moyen terme.

L'affaire a tenu en haleine tous les passionnés d'automobiles
un tantinet chauvins. Finalement, l'annonce a été officialisée le
5 novembre 2012, en présence d'Arnaud Montebourg, ministre du
Redressement productif : Renault va bel et bien ressusciter
Alpine. Créée par Jean Rédélé en 1955, au sommet de sa gloire dans les
années soixante-dix, où la berlinette A110 enchaînait les victoires en
rallyes, la marque avait sombré au milieu des années quatre-vingt-dix.
Mondialisation oblige, sa renaissance s'inscrira dans le cadre d'un
partenariat. Renault va s'associer au Britannique Caterham, avec lequel
il collabore d'ores et déjà en Formule 1. C'est un
constructeur réputé pour ses modèles à la légèreté exemplaire, produits
de façon quasi artisanale. Renault et Caterham vont concevoir en commun
des véhicules sportifs qu'ils nous promettent « distincts,
différenciés » et porteurs de leur « ADN
respectif ». Ils seront produits à Dieppe, au sein de l'usine
Alpine, dont l'avenir se trouve ainsi pérennisé.
Renouer la tradition
À nos yeux, cette annonce constitue une concrétisation
réjouissante de la « montée en gamme » de l'industrie
française prônée par le gouvernement, au demeurant peu enclin à
promouvoir le plaisir automobile... Si le projet aboutit, il restera
toutefois à transformer l'essai, dans un domaine où Renault a multiplié
les aventures sans lendemain (Safrane biturbo, Spider,
Clio V6). Or, la légitimité d'un constructeur s'acquiert dans
la durée. Souvent cité en exemple, le groupe Volkswagen a persévéré des
années durant pour ériger Audi au rang de référence mondiale. Mais si
la France parvient à se refaire une place dans l'automobile haut de
gamme, ce sera vraisemblablement en se frayant son propre chemin, sans
verser dans la froideur germanique ni céder à l'exubérance italienne.
L'inoubliable berlinette nous semble typiquement
franchouillarde, en ce qu'elle symbolise une certaine débrouillardise
nationale : dérivée d'une modeste 4CV, faisant appel à des
composants de grande série, elle n'en tenait pas moins la dragée haute
à des concurrentes plus huppées, forte d'une agilité hors pair. Son
héritière renouera-t-elle avec la tradition ? Dévoilée d'ici
trois ou quatre ans, celle-ci renoncera vraisemblablement au moteur en
porte-à-faux arrière qui avait caractérisé toute la lignée. Depuis la
disparition de l'Alpine A610 en 1995, seule la Porsche 911 est restée
fidèle à cette architecture. Son succès ne s'est pas démenti, preuve
que la tradition a du bon !
Publié dans Automobile, Économie et Industrie | Pas de commentaire | Lien permanent
15 novembre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Tandis que le président de la République célèbre la
Francophonie avec un certain enthousiasme, apparemment grisé par
l'idéologie, son ministre délégué consolide les liens unissant la
France et la Louisiane.

Dans un discours prononcé à l'occasion du sommet de l'OIF, le
président de la République a loué « cette belle et grande
cause, qui s'appelle la Francophonie ». « Nous
n'aurons de cesse » de la défendre, a-t-il promis.
« En le faisant, nous n'honorons pas simplement une langue, la
langue française, nous faisons en sorte que le français puisse
apporter, non seulement un message, mais une part de beauté au
monde. » Un lyrisme terni par quelque idéologie :
« Parler le français, c'est une façon de penser, de concevoir
le monde », a souligné François Hollande. « C'est un
message de liberté. C'est en français, que les révolutionnaires de 1789
ont proclamé, et donc écrit, la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen », s'est-il félicité. « C'est en français, en
1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'a été rédigée la
Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est en français que
s'exprimaient les combattants africains pour l'indépendance, ceux qui
refusaient la souffrance des peuples asservis. » Mais n'est-ce
pas également en français qu'écrivait Maurras, par exemple ?
Dans le même discours, le chef de l'État s'est prononcé en
faveur de quatre priorités assignées à l'OIF :
« multiplier les échanges, dans l'espace francophone entre les
jeunes, entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les
artistes, les créateurs » ; « faire de la
francophonie un outil au service du développement » ;
« contribuer au règlement des crises, chaque fois que nous
sommes concernés et notamment ici en Afrique » ;
« porter la démocratie, les droits de l'homme, le pluralisme,
le respect de la liberté d'expression, l'affirmation que tout être
humain doit pouvoir choisir ses dirigeants ». Des lubies trop
bien connues ! Souhaitant faciliter la circulation dans
l'espace francophone, il a annoncé, par ailleurs, que la France
défendrait, au niveau européen « la publication des comptes
des entreprises minières, extractives, forestières pour que, pays par
pays, projet par projet, sans exception, nous puissions être sûrs qu'il
n'y a pas de prédation dans les pays d'accueil ».
Le 17 octobre 2012, au lendemain du sommet de de
Kinshasa, Yamina Benguigui, ministre délégué chargé de la Francophonie,
a présenté au Conseil des ministres un « plan
d'action » dont l'application sera censée « mieux
fédérer les énergies autour d'une francophonie dynamique, moderne et
tournée vers la jeunesse et la société civile ». Le
gouvernement entend poursuivre trois objectifs : donner un
nouvel élan à la politique en faveur du français, accentuer le
rayonnement de la francophonie dans le monde et populariser la
francophonie sur le territoire national. Sont annoncés, plus
concrètement : la contribution à la formation
d'enseignants ; la mobilisation de la diplomatie française
pour encourager, à travers le monde, l'enseignement d'au moins deux
langues étrangères à l'école ; l'organisation du premier Forum mondial
des femmes francophones ; le développement de l'offre pour
l'apprentissage du "français des affaires" ; l'organisation
des Jeux de la Francophonie à Nice en 2013. En outre, il est question
de promouvoir « le rôle du français comme facteur
d'intégration ».
Le même jour, Mme Benguigui a reçu Jay Dardenne,
lieutenant-gouverneur de Louisiane. À cette occasion, plusieurs accords
de coopération éducative, linguistique et culturelle ont été signés
entre la France et la Louisiane. Ils prévoient, notamment : un
programme de formation initiale de professeurs louisianais francophones
en partenariat avec des universités françaises ; la création
d'un label qualité des écoles d'immersion et l'extension de ce modèle
au lycée ; la certification de compétences linguistiques des
élèves avec un diplôme français. Selon le Quai d'Orsay, « ce
renforcement de la coopération éducative et linguistique constitue une
étape importante de la coopération engagée avec la Louisiane depuis
quarante ans ».
Sur l'agenda du ministre délégué chargé de la Francophonie
figuraient également, dernièrement : un voyage au Liban les 26
et 27 octobre, afin de participer à l'inauguration du salon du
livre francophone de Beyrouth, qui fête cette années ses vingt ans ;
l'ouverture le 28 octobre à Addis-Abeba (Éthiopie) d'un cycle de quatre
séminaires consacrés aux enjeux des opérations de maintien de la paix,
s'inscrivant « dans le cadre d'un programme de mobilisation
des francophones en faveur des opérations de paix », organisés
conjointement par les ministères des Affaires étrangères, de la
Défense, l'OIF et le Centre de politique de sécurité de Genève.
Publié dans Francophonie | Pas de commentaire | Lien permanent
19 octobre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Organisation internationale de la Francophonie donne un
aperçu des actions menées en faveur de l'usage du français dans les
organisations internationales, et notamment à l'ONU.

À l'approche du sommet de Kinshasa, l'Organsiation
internationale de la Francophonie (OIF) a rendu compte de diverses
actions menées en faveur de l'usage du français dans les organisations
internationales - des offres de formation aux protestations
officielles, en passant par les réunions de coordination des
fonctionnaires francophones. Abdou Diouf, le secrétaire général de
l'OIF, en tire un bilan positif : avec ce rapport, écrit-il,
« on constate que la tâche n'est pas facile mais on découvre
aussi que le travail de sensibilisation porte peu à peu ses fruits et
que les limites d'une tendance qu'on croyait irréversible vers un
unilinguisme intégral apparaissent de plus en plus ».
Parmi les bons élèves figurent, au sein des Nations Unies, le
département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences,
ainsi que celui de l'information, dont les activités, quoique
« encadrées par un budget serré », contribueraient
« activement au respect et à la promotion du
multilinguisme ». Le portail mis en ligne à l'intention
personnel du secrétariat de l'ONU serait accessible en français dans
son intégralité. Néanmoins, « de réels problèmes liés à
l'interprétation et à la traduction persistent ». Les
rapporteurs déplorent, notamment : le temps limité de présence
des interprètes lors des réunions officielles, « qui entraîne
une obligation pratique de passer à l'anglais » après 13
heures et 17 ou 18 heures ; le recours systématique à
l'anglais lors des réunions informelles ; la diffusion des
textes en priorité en anglais « même quand le rédacteur
initial n'est pas anglophone ». À Genève, par exemple, le
texte « d'un projet de loi sensible concernant un conflit en
cours dans un pays d'Afrique » n'a été distribué qu'en
anglais, y compris à l'État concerné, pourtant francophone !
La situation pourrait s'aggraver avec « la pénurie annoncée de
personnels linguistiques », consécutive au prochain départ à
la retraite d'une proportion importante de leurs effectifs permanents.
Le processus de recrutement constitue un autre écueil auquel
se heurte l'usage du français : « De la publication
des vacances de postes dans The Economist
jusqu'aux entretiens d'embauche, en passant par les exigences
linguistiques formulées, il ne fait aucun doute que l'anglophone est
clairement favorisé. » Ainsi le remplacement du
sous-secrétaire général à la communication et à l'Information a-t-il
« fait l'objet de préoccupations » de la part des
membres du Groupe des ambassadeurs francophones : la vacance
de poste était parue seulement en anglais, sans qu'il soit
explicitement exigé du candidat qu'il maîtrise les langues de
Shakespeare et Molière. Finalement, c'est un Autrichien francophone qui
a été nommé le 31 juillet dernier.
« Il est important de ne pas transiger, et de pouvoir
exercer une pression amicale et cordiale afin de faire respecter
l'usage du français », prévient l'OIF. « D'autant
plus qu'il existe une tendance au renoncement contre laquelle il est
nécessaire de lutter. » Toutefois, nuance-t-elle,
« la Francophonie ne doit pas jouer un rôle de
gendarme ». À bien des égards, en effet, l'apprentissage
volontaire du français serait préférable à la défense pointilleuse d'un
strict multilinguisme. Quoi qu'il en soit, selon Abdou Diouf,
« plus que jamais, nous pouvons affirmer que l'atteinte de nos
objectifs en ce qui a trait au respect de la place de la langue
française dans la vie internationale dépend d'abord et avant tout de
notre propre volonté à faire respecter des règles qui existent
déjà ». Qu'on se le dise !
Publié dans Francophonie | Pas de commentaire | Lien permanent
7 octobre 2012
Quelques mots sur le Pacte budgétaire européen... et sur ses
opposants.

Une opération de communication se conclut ces jours-ci au
Parlement, où le
Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union
économique et monétaire (TSCG) est en passe d'être ratifié.
Cet accord, intergouvernemental et non communautaire, se résume à
l'expression d'un engagement solennel en faveur d'un assainissement
progressif des finances publiques - un engagement souscrit à
l'intention plus particulière de l'opinion allemande, afin de parer à
son aversion pour la "solidarité budgétaire", raison pour laquelle il
est censé contribuer à "sauver l'euro".
Ramener les finances publiques à l'équilibre, plutôt que de
faire payer aux générations futures non pas les investissements
consentis en leur faveur, mais les gaspillages d'un État inutilement
dispendieux, voilà un objectif dont la poursuite devrait apparaître
impérieuse aux yeux de tous. Hélas, ce serait oublier ces idéologues
chaussés de grosses lunettes volontaristes, pas loin de proclamer que
l'or pousse sur les arbres, tandis qu'ils exhortent l'État à pointer au
guichet de la Banque de France, quitte à plonger la nation dans le
chaos monétaire. Que des royalistes appellent à délivrer de nouveaux
assignats, voilà une situation tristement ironique. Jacques Bainville
nous avait pourtant mis en garde : il n'y a « rien de
plus terrible que la liberté donnée à l'État d'imprimer du
papier-monnaie », écrivait-il dans L'Action Française
du 2 novembre 1925.
En vérité, la France n'a rien à gagner à ratifier ce traité,
mais elle aurait tout à perdre à s'y refuser, étant donné qu'elle
s'orienterait délibérément vers la banqueroute le cas échéant. D'aucuns
s'excitent au motif qu'il appartiendra à la Cour de justice de de
l'Union européenne (CJUE) de vérifier qu'une "règle d'or" budgétaire
aura bien été introduite dans le droit national. Pas de quoi fouetter
un chat : les juges de Luxembourg ne seront pas censés statuer
sur le fond. En outre, le traité entretient le flou quant au "déficit
structurel" qu'il conviendrait de combler, ainsi que sur les
"circonstances exceptionnelles" qui permettraient de se soustraire à
cet impératif.
Dans ces conditions, la marge d'appréciation conférée à Paris
demeurera des plus large. L'immixtion potentielle du juge national dans
un domaine jusqu'alors plus ou moins réservé à la Commission pourrait
même jouer à la défaveur de Bruxelles. « On comprend pourquoi
l'exécutif européen n'est pas très très enthousiaste sur ce
texte », relève
notre confrère Nicolas Gros-Verheyde. « Celle-ci
garde la main sur le mécanisme de correction. Mais elle pourra aussi
devoir rendre des comptes et justifier sa position de façon plus étayée
que jusqu'ici... »
Cela, certains ne le voient pas, préférant s'honorer de
résister à l'édification d'un État européen dont chaque traité
multilatéral négocié sur le Vieux-Continent devrait nécessairement
constituer une nouvelle pierre. D'ailleurs, on s'amuse de constater le
sérieux avec lequel ils accueillent les propositions européistes les
plus fantasmatiques, à l'image de celles
formulées tout récemment par le "groupe des onze" :
élection du président de la Commission par les citoyens de l'Union,
définition d'une politique étrangère commune à la majorité qualifiée,
création d'une armée communautaire, etc. Ce projet, c'est une
« blague », comme l'a observé Jean-Louis Bourlanges,
aujourd'hui (dimanche 7 octobre 2012), à l'antenne de France
Culture. Ces élucubrations sans lendemain sont légions. Pour
être, avec
notre confrère Jean Quatremer qu'ils citent très volontiers,
les seuls à ne pas s'en lasser, les souverainistes ont l'outrecuidance
de revendiquer le monopole du patriotisme. Voilà précisément ce qui les
rend insupportables !
Publié dans Europe, Souverainisme | 3 commentaires | Lien permanent
4 octobre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
de l'Union économique et monétaire (TSCG), dont le Parlement français
débat ces jours-ci, est censé "sauver l'euro". Vaste programme.

Quelques milliers de personnes ont battu le pavé parisien,
dimanche dernier, 30 septembre, à l'appel du Front de gauche,
pour réclamer que soit soumise à référendum la ratification du Traité
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l'Union
économique et monétaire (TSCG), ou "Pacte budgétaire". Le cas échéant,
toutefois, les manifestants devraient batailler pour faire mentir les
sondages : selon une enquête BVA, dont les conclusions ont été
publiées lundi par Le Parisien, 64 % des Français voteraient
en faveur du traité.
Une fois n'est pas coutume, ils pourraient (presque) le faire
en connaissance de cause. À la différence des traités communautaires,
en effet, le TSCG, long de vingt-cinq pages seulement, s'avère
relativement facile à lire. Contrairement au traité de Lisbonne, par
exemple, il ne constitue pas une révision du droit primaire de l'Union
européenne. D'ailleurs, seuls vingt-cinq des vingt-sept États membres
de l'UE y ont apposé leur signature, le Royaume-Uni et la République
tchèque s'y étant refusés. Les parties contractantes s'appuieront
néanmoins sur les institutions de l'Union pour mettre en œuvre des
engagements souscrits à sa marge, dans un cadre intergouvernemental.
Cela ne recèlerait-il pas quelque fragilité juridique ? En
tout cas, il est envisagé d'intégrer les innovations du TSCG au cadre
juridique de l'Union européenne dans les cinq ans suivant son entrée en
vigueur (comme on le fit des accords de Schengen).
Imboglio juridique
Le droit communautaire s'en trouverait-il
bouleversé ? Loin s'en faut. Le TSCG contient moult références
au « Pacte de stabilité et de croissance révisé »
adopté à l'automne 2011. Le renforcement de la discipline budgétaire,
sous la surveillance accrue de la Commission européenne, est acquis de
longue date ! Le Pacte budgétaire se distingue par
l'introduction « d'objectifs à moyen terme » portant
sur la réduction du déficit structurel – un déficit
« corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des
mesures ponctuelles et temporaires », selon les termes du
TSCG, dont l'ampleur ne devrait pas dépasser 0,5 %, voire
1 % du PIB.
Était-il nécessaire de négocier un nouveau traité à cet
effet ? Un texte d'une telle nature solennise l'engagement des
responsables politiques en faveur d'un assainissement des finances
publiques. En dépit des lourdeurs inhérentes au processus de
ratification, c'est, vraisemblablement, tout l'intérêt qu'il présente
aux yeux du chancelier allemand, confronté à la défiance d'une opinion
publique où l'euroscepticisme va croissant. Au cœur de cette opération
de communication, orchestrée par Angela Merkel, donc, figure
l'introduction d'une "règle d'or" budgétaire, ou la promesse que sera
garantie l'exportation de la rigueur germanique – la contrepartie de la
"solidarité budgétaire" consentie par Berlin. De fait, les signataires
du TSCG s'engagent à équilibrer leurs comptes « au moyen de
dispositions contraignantes et permanentes, de préférence
constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance
tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de
quelque autre façon ».
En négociant un tel engagement, les exécutifs ont délibérément
court-circuité leur parlement... Dans le cas de la France, cela se
traduira non par une révision constitutionnelle, mais par l'adoption
d'une loi organique et, selon le projet du gouvernement, la création
d'un Haut Conseil des finances publiques dirigé par le premier
président de la Cour des comptes. Cela « va profondément
modifier la préparation et le suivi des lois de Finances »,
analyse, dans Les Échos, notre confrère
Étienne Lefebvre. À l'avenir, par exemple, la prévision de croissance
sur laquelle se fonde le budget « devra être validée en amont
par le Haut Conseil, dont l'avis sera rendu public au moment de la
présentation du budget, fin septembre. Un avis négatif ne sera pas
suspensif, mais son poids politique sera déterminant. Plus question de
s'appuyer sur une prévision trop volontariste. » Un objectif à
moyen terme sera désormais fixé dans les lois de programmation des
finances publiques, et une trajectoire pluriannuelle définie en
conséquence. En cas d'écart, le gouvernement proposera des mesures en
application d'un "mécanisme de correction". Il appartiendra au Haut
Conseil de donner l'alerte, « en tenant compte »,
précise le gouvernement, « le cas échéant, de circonstances
exceptionnelles ».
Politique d'abord
Les "circonstances exceptionnelles", telles qu'elles sont
définies par le TSCG, « font référence à des faits inhabituels
indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant
des effets sensibles sur la situation financière des administrations
publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que
visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant
que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas
en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme ». Cela ne
pourrait-il pas donner lieu à diverses interprétations, selon que l'on
statue à Paris, Berlin, Bruxelles ou Luxembourg ? Telle est
l'inquiétude exprimée par Marc Clément, magistrat administratif, dans
un article publié par Telos. En définitive,
résume-t-il, « le Traité de stabilité instaure à côté des
mécanismes européens centrés sur les objectifs maximum de déficit de
3 % et de dette de 60 %, un autre ensemble de
contraintes visant à l'équilibre structurel des budgets. Mais ces
règles sont des règles nationales dont l'application sera contrôlée
nationalement. » D'un côté, « la Commission et le
Conseil sanctionnent sous le contrôle de la Cour de
Justice » ; de l'autre, celui du TSCG, « ce
sont les juges nationaux ». « Qu'est-ce qui garantit
que les décisions des juges ne seront pas contradictoires d'un État
membre à l'autre ? Rien, car pour le Traité de stabilité, le
juge de Luxembourg n'intervient que marginalement. » Du moins
est-il censé vérifier qu'une "règle d'or" budgétaire a bien été
introduite dans le droit national, sans participer directement à son
application.
Le moment venu, n'en doutons pas, les politiciens sauront
s'engouffrer dans cet imbroglio juridique, sous la pression d'un corps
électoral avide de promesses dont il faudra bien financer la
réalisation, au moins en partie... Vingt ans après la ratification du
traité de Maastricht, le TSCG est censé en corriger les insuffisances,
en restaurant la discipline budgétaire dont l'Union européenne s'était
affranchie à la demande de Paris et Berlin. Quoique "renforcé" tout
récemment, le Pacte de stabilité avait volé en éclats à leur
instigation, après avoir été jugé « stupide » par
Romano Prodi, alors président... de la Commission européenne. Pourquoi
le Pacte budgétaire serait-il promis à un avenir différent ? On finira
bien par s'en extirper. D'aucuns s'y essaient d'ores et déjà. Jugeant «
intenable » la réduction du déficit public poursuivie à court
terme, Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale,
souhaiterait que Paris s'en affranchisse. « Mais je ne
souhaite pas que ce soit la France qui donne l'impression de ne pas
tenir ses engagements et sa parole parce que nous aurions à le payer
cher au niveau de la gestion de notre dette et de l'effort
financier », a-t-il expliqué le 23 septembre, comme
le rapportent Les Échos. D'où son espoir
de faire peser la responsabilité sur Bruxelles, qui aurait bon
dos ! À supposer qu'il faille effectivement "sauver l'euro"
et, plus généralement, ramener les finances publiques à l'équilibre
sans faire tourner la planche à billets - ce dont la rédaction de L'Action
Française 2000 est loin d'être convaincue, ses
lecteurs le savent bien ! - on le voit, le carcan du droit ne
saurait y suffire. C'est pourquoi, de notre point de vue, cette affaire
n'est qu'une nouvelle illustration de la prégnance du "politique
d'abord" cher à Maurras : en pratique, « dans l'ordre
du temps », la politique demeure bel et bien « la
première ».
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
4 octobre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
À la faveur, d'une part, des débats de société et, d'autre
part, des défis lancés par la crise économique, hommes d'église,
politologues et journalistes se risquent à critiquer un régime
politique que l'on croyait inattaquable.
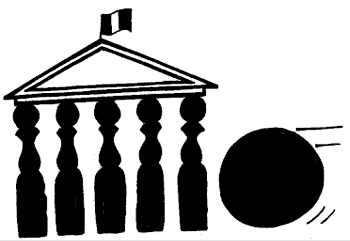
La démocratie a-t-elle encore la cote ? Du moins la
critique-t-on plus volontiers que par le passé. D'abord dans l'Église.
Ainsi Benoît XVI a-t-il jugé « évident », le
22 septembre 2012, devant le Bundestag, « que dans
les questions fondamentales du droit, où est en jeu la dignité de
l'homme et de l'humanité, le principe majoritaire ne suffit
pas ». Deux jours plus tard, alors que Jean-Michel Apathie
l'interrogeait sur RTL à propos du mariage des
homosexuels, Mgr André Vingt-Trois, archevêque de Paris et
président de la Conférence des évêques de France, a tenu un discours
similaire : « il n'est pas sain de mettre aux
voix » la distinction du bien et du mal, a-t-il déclaré.
Érosion progressive
Outre-Rhin, le politologue Herfried Münkler analyse, quant à
lui, l'« érosion progressive » qui affecterait la
démocratie parlementaire. Le Courrier international
s'est fait l'écho de ses interrogations publiées par le Spiegel.
« Pourquoi la crise actuelle devrait-elle signifier le début
de la fin de ce modèle politique ? », se
demande-t-il. « N'est-ce pas qu'un moment difficile à passer,
auquel succédera à nouveau une période florissante du système, rôdé et
éprouvé, de la démocratie parlementaire ? Un élément ne plaide
pas en ce sens : l'impossible synchronisation des rythmes
économique et politique. La Bourse et les banques dictent le rythme des
décisions et les parlements courent derrière elles. Ce phénomène n'est
pas seulement une conséquence de la mondialisation, mais aussi un effet
de l'accélération des communications et des nouvelles technologies de
l'information. Les autorités politiques sont tellement sous pression
que le gouvernement place en permanence le Parlement devant le fait
accompli. Non seulement celui-ci se contente d'approuver ce que
l'exécutif a annoncé sous la pression de la Bourse et des agences de
notation, mais l'Union européenne et l'euro, qui en tant que remparts
supranationaux auraient dû faire barrage à l'autonomisation des
marchés, contribuent au contraire à la marginalisation des parlements
nationaux, dans la mesure où les chefs de gouvernement prennent les
décisions à Bruxelles et exhortent les élus à ne pas les contester sous
peine de faire accourir les spéculateurs financiers. »
Apologie des pleins pouvoirs
La situation n'a pas échappé à Henri Pigeat. Intervenant lundi
dernier, 1er octobre, au micro de BFM Business,
l'ancien président de l'AFP n'a pas mâché ses mots. De son point de
vue, l'Italie doit être montrée en exemple pour avoir réalisé, depuis
un peu moins d'un an, plus de réformes que la France durant le
quinquennat de Nicolas Sarkozy. Or, ce succès tiendrait au fait que le
gouvernement de Mario Monti disposerait, en quelque sorte des
« pleins pouvoirs sous contrôle ». En France,
soutient Henri Pigeat, « toutes les réformes récentes [...]
ont été réalisées avec des gouvernements de pleins pouvoirs ».
Dans les démocraties, déplore-t-il, « il y a toujours des
intérêts particuliers qui vont s'opposer à l'intérêt
général ». Selon lui, il faut « faire en sorte que
les choses qui doivent être réglées d'urgence le soient
effectivement ». Sinon, prévient-il, « nous allons
butter sur une crise beaucoup plus grave que la situation actuelle et
il faudra faire les réformes sous l'autorité de la Banque centrale
européenne, du FMI et d'autres autorités extérieures ». Alors,
"politique d'abord" ?
Publié dans Politique, Société | Pas de commentaire | Lien permanent
20 septembre 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
L'institution du "mariage homo" figure parmi les priorités du
gouvernement. Les débats qui s'annoncent au Parlement permettront-ils
de discerner les multiples questions que ce projet soulève ?
En voici un aperçu.

D'ici la fin octobre, un projet de loi sera présenté afin
d'établir, selon les termes du gouvernement, « le mariage pour
tous ». Plus couramment, on parle d'autoriser le
« mariage homo » - et non celui des homosexuels.
Aussi laisse-t-on entendre, au moins par facilité de langage, que ce
mariage-là ne sera jamais qu'un avatar parodique de son homologue
traditionnel. De toute façon, soutient Luc Ferry, « les unions
homosexuelles seront toujours, qu'on le veuille ou non, différentes du
mariage ». Pourquoi vouloir les désigner comme tel, en dépit
de l'acception attachée à la désignation d'une institution
ancestrale ? À certains égards, la réforme annoncée vise moins
à conférer de nouveaux droits aux homosexuels qu'à ébranler les
structures sociales. Citant un appel à « supprimer
l'obligation de fidélité, l'obligation de communauté de vie [...] ainsi
que la présomption de paternité (ou de parentalité) »
inhérentes au mariage, Éric Deschavanne, un professeur de philosophie,
le juge « emblématique de la contradiction qui consiste à revendiquer
l'accès à un statut que l'on entend à cette fin vider de sa
substance ».
Un ordre symbolique
Quoique favorable à l'institution d'une "union civile"
équivalente au mariage, Luc Ferry considère
« essentiel, ne serait-ce que pour ne pas mentir aux
enfants », que la différence entre l'un et l'autre de ces
statuts « soit clairement nommée ». Ce faisant,
l'ancien ministre s'érige en défenseur, certes timide, d'un "ordre
symbolique" délibérément pris pour cible. Pour les uns, explique Éric
Deschavanne, « accorder aux couples homosexuels le droit au
mariage et le droit à l'enfant permettrait de mettre un terme définitif
à "l'hétéronormativité" (ou "hétérocentrisme") » ; il
s'agirait « de remédier à l'humiliation
multiséculaire subie par les homosexuels ». À l'opposé, leurs
détracteurs entendent « poser des limites objectives à
l'évolution des mœurs et du droit de la famille ». Telle est,
nous semble-t-il, la démarche de Luc Ferry : « Si la
logique [...] est à la fois celle de l'égalité et de l'amour, le
mariage devrait [...] être accessible à tous les individus, quels
qu'ils soient, qui veulent former un couple », observe-t-il.
« Pourquoi pas des frères et sœurs, par exemple, s'ils
s'aiment et s'ils y trouvent leur compte ? Qui pourrait, si
rien ne vient limiter la dynamique ainsi enclenchée, leur refuser ce
droit et au nom de quoi ? » Dans une optique réactionnaire, résume Éric
Deschavanne, « le droit est "un langage" qui prétend rendre compte de
la réalité et on ne peut lui demander de subvertir les représentations
communes qui s'inscrivent dans le langage courant. Ce qui se produirait
si l'on introduisait dans le droit le mariage homosexuel et
l'affiliation d'un enfant à deux pères ou à deux mères. »
Qu'en sera-t-il à l'issue des débats parlementaires ? Si
l'adoption plénière était ouverte aux couples homosexuels, des enfants
pourraient effectivement se voir réputés nés de deux pères ou deux
mères, au risque de bouleverser les repères de la filiation, déjà
brouillés par les mutations de la famille dont cette affaire n'est,
somme toute, qu'un symptôme. À moins que le volontarisme juridique soit
sans grand effet sur les mœurs, comme le suggère la psychologue
Caroline Thompson. Dans une famille homoparentale, affirme-t-elle,
« l'enfant n'a aucune illusion sur le fait que ses parents
soient deux femmes ou deux hommes ». D'ailleurs, poursuit-elle
« il n'appellera pas les deux parents "papa" ou
"maman" ». Généralement, les "parents" s'accorderaient pour
savoir lequel des deux sera ainsi désigné. Considérant, en outre,
qu'« il existe quantité d'exemples où l'éducation [...] ne
s'est pas faite dans un milieu familial dit traditionnel »,
Mme Thompson soutient que l'enfant « trouvera
ailleurs ce qui n'est pas donné d'emblée » : chez les
grands-parents, mais aussi dans « les histoires racontées par
la mère sur les pères ». Cela dit, comme le relève Éric
Deschavanne, « les objections sont multiples, que l'on
pourrait opposer aux prétendues démonstrations de l'innocuité de
l'homoparentalité : contradiction des résultats des études
[...] ; partialité des enquêtes conduites par des auteurs militants,
caractère excessivement restreint des populations de référence ;
absence de recul historique. »
Le mariage, une affaire privée ?
De part et d'autre, on ne manquera pas d'invoquer l'intérêt de
l'enfant. À ce petit jeu-là, les réactionnaires devront se montrer
prudents. Faut-il agiter « le droit d'avoir un père et une
mère » ? On se demande comment un nourrisson pourrait
en réclamer l'application. Quant à sa mise en œuvre, supposerait-elle
d'imposer aux veuves le choix d'un mari ? Ce slogan sera
facile à récuser, étant donné les carences juridiques dont
souffriraient, paraît-il, les familles homoparentales, où vivraient
entre dix mille et trois cent mille enfants. Aux yeux de Jeannette
Bougrab, par exemple, « il ne s'agit pas tant de donner un
droit à l'enfant mais de reconnaître le droit des enfants. Il faut
adopter des mesures permettant au coparent de poursuivre l'éducation de
l'enfant en cas de décès du parent biologique plutôt que placer
l'enfant dans un foyer. De même, il convient de modifier les règles
[...] afin de permettre au coparent de pouvoir léguer des biens à
l'enfant qu'il a contribué à éduquer. »
À cet effet, une libéralisation des successions ne serait-elle
pas suffisante ? Faudrait-il, plus généralement, laisser les
individus contracter à leur guise ? L'institution du mariage
civil remonte à 1792. « En un peu plus de deux siècles, quel
succès ! », ironise Georges Kaplan. « Les
jeunes gens d'aujourd'hui se marient de moins en moins [...] et un
mariage civil sur trois finit en divorce ! Comme à chaque fois
que l'État a prétendu réglementer et diriger nos vies privées, il n'est
parvenu qu'à détruire ce qui fonctionnait si bien depuis des
lustres. » Quoi qu'il en soit, l'ouverture du mariage aux
couples de même sexe serait-elle, comme il l'espère, « un
premier pas sur la longue route qui nous reste à parcourir pour
reprivatiser nos vies » ? À l'inverse, elle
conférerait une reconnaissance institutionnelle à des mœurs auxquelles
l'État devrait, selon nous, rester indifférent.
Les citations de Luc Ferry, Éric Deschavanne, Caroline
Thompson et Jeannette Bougrab sont tirées d'un
rapport du Conseil d'analyse de la société publié en mai
2007 ; celles de Georges Kaplan sont extraites de son blog
Ordre spontané.
Publié dans Société | Pas de commentaire | Lien permanent