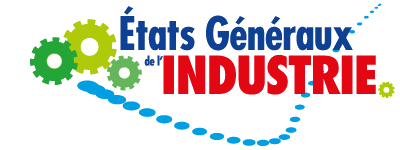13 février 2010
Mercredi dernier, 10 février, la commission des lois
de l'Assemblée nationale a
examiné une proposition de résolution rejetée
une semaine auparavant par la commission des Affaires
européennes.

Présenté par des députés issus du groupe SRC (socialiste,
radical, citoyen et divers gauche), ce texte promeut la "clause de
l'Européenne la plus favorisée". « Il s'agit d'identifier les
dispositions les plus favorables aux femmes dans les États membre de
l'Union européenne dans chaque domaine, et de proposer que les États
membres alignent leur législation sur celle de l'État membre où elle
est la plus favorable aux femmes », a résumé, dans son rapport,
Mme Pascale Crozon (PS).
Selon un mécanisme jugé « curieux » par le
député UMP Étienne Blanc, le législateur national devrait s'inspirer
des législations étrangères "les plus progressistes" –
« notion qui, en droit, [le] laisse d'ailleurs
perplexe ». En conséquence, « sans porter un jugement
sur le fond de la proposition », le parlementaire a exprimé
son « opposition radicale » quant à la forme de la
proposition.
« Il ne s'agit pas aujourd'hui de décider du contenu
de la loi future », a souligné le socialiste Jérôme Lambert.
« On ne peut à l'évidence pas légiférer à la hâte sur ce
sujet », a-t-il reconnu. « Il s'agit "simplement" –
mais la portée symbolique est forte – de voter une résolution invitant
le gouvernement français dans les négociations européennes à venir à
soutenir le principe de la clause de l'Européenne la plus favorisée.
Qui peut refuser une telle chose ? La cause des femmes ne
mérite-t-elle pas l'affirmation de la volonté d'une égalité la
meilleure possible ? » Cela ne se discute
pas : « Sur le fond du texte lui-même, on ne peut
être contre », a déclaré Mme Marie-Jo Zimmermann. « Si
nous le rejetions, expliquer notre décision pourrait être
délicat. », a averti l'UMP François Vannson.
La chambre basse a manifestement du temps à perdre en échange
d'inepties. La commission a adopté sans modification l'article unique
de la proposition de résolution, inscrite à l'ordre du jour de la
séance publique du 18 février prochain.
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent
10 février 2010
La commission des Affaires européennes de l'Assemblée
nationale s'est réunie le 3 février pour
examiner deux propositions de résolution promouvant la
« clause de l'Européenne la plus favorisée ». Avec,
en perspective, selon les explications des rapporteurs, l'établissement
d'« un statut pleinement harmonisé de la femme en Europe qui
ferait la synthèse des meilleures lois en la matière ».

À l'origine de ces initiatives : des députés issus,
d'une part, de la gauche démocrate et républicaine (Parti communiste,
Parti de gauche, Verts), et, d'autre part, du groupe socialiste,
radical, citoyen et divers gauche. Lesquels n'entendaient pas
apparaître en retrait sur la scène européenne, où les féministes sont
galvanisés par « une présidence espagnole pleine
d'allant ». Entre autres événements ponctuant le semestre,
citons : la
conférence sur « les femmes, la paix et la sécurité », puis le "sommet européen des
femmes au pouvoir" en février ; l'adoption par le
Conseil de conclusions sur l'éradication de la violence à l'encontre
des femmes prévue le 8 mars ; une conférence le
25 mars sur « l'égalité entre les hommes et les
femmes, une base pour la croissance et l'emploi » ;
la "Ve rencontre de femmes espagnoles et africaines pour un
monde meilleur" le 28 mars ; un "séminaire technique"
le 29 avril sur « le rôle de la femme dans le développement
rural ».
Identifiant « les termes du débat »
parlementaire, les rapporteurs observent que « les arguments
"contre" [...] ne concernent ni les principes, ni l'intention des
propositions de résolution, mais le calendrier et les
circonstances ». Et de rappeler que « la "clause de
l'Européenne la plus favorisée" a déjà fait l'objet d'une évocation,
d'une tentative d'inscription à l'agenda européen, sous présidence
française », sans avoir « reçu l'écho que l'on aurait
souhaité ». « Certains pays sont
réticents », souligne Mme Anne Grommech. En
conséquence, le corapporteur UMP veut « éviter toute prise de
position prématurée ». D'autant que « la faisabilité
d'une [telle] démarche vient d'être mise à l'étude [...] avec
d'ailleurs l'hypothèse d'un traité entre quatre États : la
Belgique, l'Espagne, la Suède et la France. Un groupe de travail
interministériel a été constitué. [...] Ses conclusions sont prévues
pour le mois de mars. »
Le député pointe une autre difficulté, concernant
« les domaines sur lesquels porte la "clause de
l'Européenne la plus favorisée" ». À ses yeux,
« il y a un exemple qui est très concret,
c'est celui de l'interruption volontaire de grossesse.
Aujourd'hui, en France, l'IVG n'est possible que dans les douze
semaines. Or, passer à dix-huit semaines, délai applicable en Suède,
supposerait un débat approfondi. Il faut notamment souligner qu'un tel
délai de dix-huit semaines pourrait permettre de sélectionner le sexe
de l'enfant. Menée sur la base d'une clause automatique sans débat
préalable, une telle réforme peut aboutir à des situations compliquées
de déséquilibre entre les garçons et les filles telles qu'on les
connaît en Chine et en Inde. »
« Dans de telles circonstances, conclut
Mme Grommech, il convient de rejeter les propositions
présentées, car prématurées sur le plan diplomatique et exigeant des
études approfondies, sur des questions très sensibles. »
Suivant son avis, la commission des Affaires européennes a rejeté
chacune des résolutions. Ce faisant, la droite parlementaire a pourtant
démontré, une fois de plus, combien elle est soumise à la gauche dans
les débats "sociétaux".
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | 2 commentaires | Lien permanent
9 février 2010
C'est bien connu : 80 % des lois votées par
le Parlement français seraient d'origine communautaire. Cité par tout
un chacun, ce pourcentage a pénétré les esprits sans avoir jamais fait
l'objet d'une démonstration. C'est donc un « mythe »
que la fondation Terra Nova entend démonter
dans une étude rendue
publique le 5 février.

Ses auteurs, Matthias Fekl et Thomas Platt, ont scruté la
législation française promulguée entre 1998 et 2008. Aussi n'ont-ils pris en
compte « que les actes [européens] nécessitant une adaptation au niveau
national, et non ceux qui se substituent purement et simplement à
l'action du législateur ». « L'exercice de
quantification est difficile et risqué », affirment-ils.
« Les résultats sont donc à interpréter avec
prudence. » D'autant que « si l'Union européenne est
bien présente au quotidien dans chacun des vingt-sept États membres, si
son action irrigue et affecte en profondeur les systèmes juridiques
nationaux, les interactions entre normes européennes et loi nationale
sont infiniment plus complexes qu'une simple transposition, "bête et
méchante", de normes imposées de l'extérieur ».
Selon leurs calculs, « environ 25 % des
dispositions législatives adoptées par le Parlement comportent un ou
plusieurs articles transposant des dispositions d'origine
communautaire. Moins de 10 % des lois comportaient une part
significative de mesures de transposition du droit communautaire. Moins
de 10 % du total des articles législatifs adoptés ont vocation
à transposer des dispositions communautaires. [...] La mesure
sectorielle de cet impact s'inscrit dans la logique des compétences
transférées à l'Union : un impact fort pour l'agriculture, les
transports, l'économie, l'environnement ; un impact modéré
mais réel pour l'emploi et le social [...], la justice ; un
impact marginal pour la culture, l'éducation, la défense, les affaires
étrangères. Mais, contrairement à une idée reçue, même dans les
secteurs les plus européanisés, la législation nationale "autonome"
demeure largement majoritaire. Le cas de l'agriculture [...] est le
plus révélateur. Un peu plus de 60 % des lois comportent des
éléments d'origine communautaire. [...] Mais, quand on affine par
article, on s'aperçoit que seulement 18 % de l'activité
législative nationale dans ce domaine a une origine
communautaire. »
« On est donc loin des 80 %, martelés tant
par les fédéralistes soucieux de montrer l'importance de l'Europe que
par les souverainistes cherchant à dénoncer le poids tentaculaire de la
"bureaucratie" bruxelloise. » Sans doute les uns et les autres
partagent-ils en définitive une vision commune de l'Europe, un
comble !
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
6 février 2010
La présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne
poursuit sur sa lancée.

S'exprimant
le jeudi 4 février au nom de l'Union européenne, le
représentant permanent de l'Espagne auprès de l'ONU, Juan Antonio
Yanez-Barnuevo, a remercié Ban Ki-moon « pour sa proposition
de réforme de l'architecture de l'égalité des sexes au sein de
l'organisation ».
Laquelle fut apparemment présentée en janvier dernier, dans
un rapport de vingt-cinq pages dont nous proposerons
peut-être une synthèse si notre niveau d'anglais s'avère suffisant pour
en décrypter l'essentiel.
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent
4 février 2010
Le second sommet européen des femmes au pouvoir s'est tenu à
Cadix le mercredi 3 février.

Convoqué à l'initiative des gouvernements espagnol et
britannique, il s'inscrivait dans la continuité d'une réunion organisée
à Athènes dix-huit ans auparavant. À cette occasion fut adoptée une
"déclaration politique" censée donner « une
impulsion définitive » à l'égalité hommes-femmes dans l'Union
européenne, selon le vœu formulé le 27 janvier par le ministre
espagnol de l'Égalité, Mme Bibiana Aido (photo).
Les signataires – parmi lesquels figure la Française
Nora Berra, secrétaire d'État en charge des Aînés – observent
que « l'amélioration des résultats scolaires des femmes n'a
pas été accompagné d'une présence proportionnelle dans les sphères de
décision » ; ce qui serait un véritable
« gâchis ». Et de stigmatiser « les
stéréotypes sexistes » qui « continuent de promouvoir
des comportements différents pour les femmes et les hommes, constituant
le terreau des discriminations ».
Révoltés contre des aspirations dont la variété nous semble
profondément structurée par l'identité sexuelle, les signataires
s'imaginent que « la participation équilibrée des femmes et
des hommes est indispensable à l'épanouissement personnel et
collectif ». L'égalité serait, en outre, « une
condition préalable pour obtenir une croissance durable ».
« La valeur économique des politique d'égalité des sexes est
évidente », affirment-ils. Elle assurerait notamment une
natalité pérenne – hypothèse sur laquelle il y aurait matière à
discuter, bien qu'elle soit apparemment vérifiée par certaines
statistiques.
Sans surprise, le texte appelle à « des changements
structurels et culturels dans tous les domaines de la vie ».
Ce qui suppose, entre autres, des incitations à partager les tâches
ménagères, des mesures de discrimination positive, voire l'organisation
régulière de sommets européens réunissant exclusivement des femmes. Les
participantes se sont également engagées « à promouvoir
l'égalité des sexes dans l'action extérieure et la coopération au
développement de l'Union européenne ».
Aujourd'hui, 4 février, s'ouvre par ailleurs à Cadix
le "forum européen des femmes Pékin + 15"
« au cours duquel sera analysé le degré de respect des
objectifs stratégiques et des mesures fixées lors de la
Ive Conférence mondiale sur les femmes de l'ONU, qui s'est
tenue à Pékin en 1995 », selon les informations fournies par
la présidence du Conseil.
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent
4 février 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'UE s'est montrée bien timide dans la coordination des États
membres venus au secours d'Haïti. Cela nourrit de nouvelles critiques
formulées à l'encontre de Catherine Ashton, Haut Représentant pour les
Affaires étrangères.

Deux semaines après le terrible séisme survenu en Haïti, les
ministres européens sont enfin convenus, le 25 janvier, de créer une
cellule de coordination « pour échanger les informations sur
les moyens civils et militaires » apportés par les États
membres.
Aucun bilan chiffré
« Encore une fois, déplore Jean Quatremer, les
Européens ont agi en ordre dispersé alors qu'ils sont les principaux
contributeurs : 400 millions d'euros, environ, contre
100 millions de dollars dévalués pour les
Américains. » (Coulisses de Bruxelles,
19/01/2010) Le 22 janvier, Nicolas Gros-Verheyde estimait à
2 000 le nombre d'Européens engagés au titre de la protection
civile, dont 1 300 Français. Des chiffres que l'UE s'est
montrée incapable de lui fournir : « Pour trouver de
l'information, il fallait la chercher ailleurs dans les capitales,
voire auprès de l'US Army. » (Bruxelles 2,
28/01/2010) Un comble !
Peut-être les flottements consécutifs à l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne expliquent-ils en partie ces déboires. À moins que
cette inertie soit inhérente au fonctionnement de la machine
administrative européenne. Gouverné par le consensus, cet empire
normatif n'apprécie pas d'être bousculé. « Le mode de décision
européen est trop lent pour s'adapter à une crise soudaine »,
observait Jean-Pierre Jouyet au lendemain de la présidence française de
l'UE, tandis qu'il accusait la Commission d'avoir « mal
analysé » la nature de la crise financière (Une
présidence de crises, Albin Michel).
Fallait-il se rendre sur place ?
Tandis qu'on ressort des tiroirs un rapport de 2006, où Michel
Barnier proposait la création d'une force européenne de protection
civile, les critiques redoublent à l'encontre de Catherine Ashton, le
Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et
la Politique de sécurité. Moult commentateurs ont regretté qu'elle ne
se soit pas rendue sur place, alors qu'Hillary Clinton se trouvait à
Port-au-Prince le 16 janvier. « On aurait pu imaginer
que le drapeau européen soit visible plus rapidement »,
affirme Pierre Lellouche, le secrétaire d'État en charge des Affaires
européennes (Euractiv, 27/01/2010). Les
européistes se bercent d'illusions : aux côtés du secrétaire
d'État américain, en effet, le Haut Représentant n'aurait pas accaparé
l'attention des médias. Pour avoir assisté, la semaine dernière, à une
allocution du président du Conseil européen Herman Van Rompuy prononcée
à Paris, nous pouvons témoigner de la relative indifférence suscitée
par le déplacement d'une telle personnalité.
Mme Ashton a tenté de se justifier : « Je
n'avais rien à fournir sur le terrain sinon prendre un espace précieux
alors que les avions étaient incapables d'atterrir à cause de l'état de
l'aéroport. Je ne suis pas un médecin, ni un pompier. Ma place était de
réunir une coordination au niveau de l'UE et des Nations
Unies. » (Bruxelles 2, 20/01/2010)
Diplomatie européenne sans finesse
Nicolas Gros-Verheyde lui reconnaît le mérite de ne pas avoir
versé dans la "politique spectacle" : « Sa place
était davantage à Bruxelles », estime-t-il, « pour
organiser, coordonner l'action au niveau politique. Ce qu'elle a fait
en convoquant (un peu tard) un conseil des ministres
extraordinaire » (Bruxelles 2,
25/01/2010). À l'opposé, Jean Quatremer a publié un article
assassin : « Elle a manifestement décidé
d'interpréter a minima ses nouvelles fonctions, à la fois par flemme et
par désintérêt pour un poste qu'elle n'a jamais demandé. [...]
Annonçant, lundi, les chiffres de l'aide européenne, Ashton a été
tellement confuse que Miguel Angel Moratinos, le chef de la diplomatie
espagnole dont le pays assure la présidence tournante de l'Union, s'est
fait un plaisir de la reprendre pour expliquer clairement la situation.
Et en trois langues, alors qu'Ashton est incapable de parler autre
chose que l'anglais. » (Coulisses de Bruxelles,
26/01/2010)
Sa désaffection pour la langue de Molière inquiète Jean-Pierre
Raffarin. Dans ces conditions, admet l'ancien Premier ministre, on peut
« douter du degré de sensibilité et de finesse de la prochaine
diplomatie européenne ». Quant aux souverainistes, ils se
réjouiront peut-être de ces déboires, qui sont autant de freins au
développement du Service européen pour l'Action extérieure menaçant, à
leurs yeux, la diplomatie française.
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
4 février 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Madrid nous avait prévenus : l'égalité hommes-femmes figure
parmi les priorités de son semestre européen.

Intervenant devant une commission du Parlement européen, le
ministre espagnol de l'Égalité, Mme Bibiana Aído, a exprimé,
selon le communiqué de l'assemblée, la volonté « d'encourager
le partage des tâches entre les femmes et les hommes ». Par
ailleurs, au cours d'une conférence organisée à Bruxelles par la
Commission européenne et l'Otan sur « les femmes, la paix et
la sécurité », le premier vice-président du gouvernement
espagnol, Mme María Teresa Fernández de la Vega « a
défendu l'idée de recourir à des quotas afin de parvenir à ce que les
femmes participent à tous les niveaux, civil et militaire, aux
processus de paix et au règlement des conflits ». Et de
demander « instamment aux organisations internationales de
prendre des "engagements contraignants" » à cet effet.
Le secrétaire général de l'Otan, le Danois Anders Fogh
Rasmussen, aurait certes « appuyé la suggestion de fixer des
"objectifs" pour la participation de la femme [sic] à tous les
niveaux », rapporte la présidence espagnole du Conseil de
l'Union européenne. Il aurait « cependant considéré que le
fait d'imposer un quota à l'Otan "ne serait pas réaliste" étant donné
"les différentes traditions nationales qui s'y trouvent" ».
Remarque de bon sens, au demeurant bien timorée. Faut-il rappeler que
l'Organisation du traité de l'Atlantique nord est une structure à
vocation militaire ? Avec cela, la stabilisation de
l'Afghanistan semble en bonne voie...
Le rendez-vous "féministe" suivant était fixé au mercredi
3 février, date à laquelle devait se tenir à Cadix une
« réunion informelle des femmes ministres en
exercice » de l'UE. Madrid nous a annoncé qu'une "déclaration
politique" serait adoptée lors de ce sommet. Faut-il s'attendre à de
nouvelles surprises ?
Publié dans Défense, Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent
4 février 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Le président de la République s'est rendu le
26 janvier au cimetière militaire Notre-Dame de Lorette
(Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais), dont les tombes musulmanes ont
été profanées à trois reprises depuis 2007.

Ouvrant son discours, le chef de l'État a rendu hommage à
Harouna Diop, maréchal des logis chef au 517e régiment du
train de Châteauroux, tombé au champ d'honneur le 13 janvier
dernier, à l'âge de quarante ans, alors qu'il était père de six
enfants. « Il était musulman comme les 550 soldats
français qui reposent à Notre-Dame de Lorette avec leurs
40 000 frères d'armes », a rappelé Nicolas
Sarkozy. « Ils ont été tués, pour la plupart, au cours de la
bataille d'Artois en 1915. Ils se sont battus pour défendre leur
patrie, notre patrie. [...] Tous sous le même drapeau, ceux qui
croyaient au ciel comme ceux qui n'y croyaient pas. Ensemble. [...] Ils
ont donné leur vie, leur courage, leur exemple à notre pays.
Aujourd'hui, je suis venu leur porter la reconnaissance de la France
tout entière. »
Le président de la République s'est écarté quelque peu du
"droit-de-l'hommisme". « Être Français, a-t-il souligné, c'est
appartenir à une nation qui s'est construite, au fil de l'Histoire.
[...] La France n'est pas une page blanche. » En conséquence,
« être Français, qu'on le soit de naissance ou qu'on le
devienne, c'est avoir la France en héritage, non pas comme un
patrimoine figé qui devrait être jalousement gardé dans un musée, mais
comme un héritage qui n'aurait d'autre testament que de nous en montrer
dignes et de le faire fructifier pour les générations futures. Être
Français, cela ne confère pas seulement des droits, cela confère
également des devoirs. Et parmi ces devoirs, le premier d'entre eux est
d'aimer la France. En honorant ceux qui ont donné leur vie pour elle.
En respectant ses lois et ses valeurs. En étant prêt à se mettre à son
service si les circonstances l'exigent. »
Un principe d'apaisement
Observant que « l'islam est aujourd'hui la religion
de nombreux Français », le président a affirmé que
« notre pays, pour avoir connu non seulement les guerres de
religions, mais aussi les luttes fratricides d'un anticléricalisme
d'État, ne peut pas laisser stigmatiser les citoyens français
musulmans ». Et de prôner une saine laïcité, qui
« n'est pas la négation ou le rejet du fait
religieux » mais « un principe d'apaisement dont
dépendent la concorde et la paix civiles ». Cependant, pour
Nicolas Sarkozy, c'est aussi « la reconnaissance par l'État de
l'égale dignité des religions, dès lors qu'elles se conforment à nos
lois, qu'elles se conforment à nos principes, qu'elles se conforment à
nos valeurs, au premier rang desquelles la dignité irréductible de la
personne et l'égalité absolue entre les hommes et les
femmes ». Or, nos "valeurs" ne sont-elles pas le fruit d'une
histoire nationale façonnée par le christianisme ?
Feignant de l'ignorer, le chef de l'État s'est réfugié dans
l'ineptie : « Plus que tout, être Français, c'est
faire preuve d'un attachement profond, d'un attachement permanent aux
valeurs et aux principes de notre République. » À quoi bon
cultiver la pudeur laïque ? De toute façon, « il est
impossible de s'intégrer s'il n'y a rien à intégrer »,
remarquait François Fillon le 4 décembre dernier. Le Premier
ministre, lui, ne craint pas de le dire : si « la
France est laïque », elle « est tout naturellement
traversée par un vieil héritage chrétien qui ne saurait être ignoré par
les autres religions installées plus récemment sur notre
sol ». Encore un effort, Monsieur le président !
Publié dans Idées | Pas de commentaire | Lien permanent
4 février 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Les États généraux de l'Industrie confirment le déclin du
secteur manufacturier : la France perd du terrain, tout
particulièrement face à l'Allemagne. Aperçu des forces et faiblesses de
l'industrie nationale.
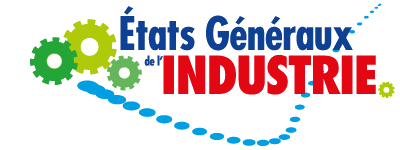
Lancés le 2 novembre 2009, les États
généraux de l'Industrie ont achevé la première phase de leurs travaux.
Synthétisés dans un rapport remis le mois dernier au ministre Christian
Estrosi, ceux-ci soulignent, sans surprise, le déclin du secteur
manufacturier. S'il représente encore 16 % de la valeur
ajoutée créée en France, son poids dans l'économie nationale apparaît
moindre que dans la zone euro, où la moyenne s'établit à
22,4 %. Bien que 500 000 emplois industriels aient
été perdus depuis 2000, des difficultés de recrutement persistent,
notamment dans l'électricité et l'électronique, la mécanique et les
travaux des métaux.
Déficit commercial
La France demeure le cinquième exportateur mondial, mais ses
parts de marché sont en recul depuis une quinzaine d'années, passant de
5,8 % en 1995 à 3,8 % en 2008. « Ce
phénomène s'explique en partie par la montée en puissance de nouveaux
compétiteurs comme la Chine et une tendance de certains acteurs à
délocaliser », commentent les rapporteurs. En partie
seulement. Représentant un montant équivalent à 56 % des
exportations allemandes en 2000, les exportations françaises de
produits manufacturés étaient réduites à 37 % huit ans plus
tard. La balance commerciale se dégrade : depuis 2007, les
performances de l'agroalimentaire et des biens d'équipement ne
compensent plus le déficit des autres secteurs.
L'industrie française s'appuie sur un tissu d'entreprises de
taille intermédiaire (entre 250 et 5 000 salariés)
insuffisamment développé. Elle dégage des marges plus faibles que celle
des principaux pays de l'Union européenne, à l'exception du
Royaume-Uni ; la rentabilité et l'accès aux financements s'en
trouvent naturellement affectés.
R&D à la traîne
L' effort consenti en recherche et développement (R&D)
plafonnait en 2006 à 1,9 % du PIB national. « La
France se situe bien en-deçà de l'Allemagne qui y consacre
2,4 % de son PIB. » Elle se distingue « par
un niveau important de dépenses R&D publiques, l'un des plus
importants de l'OCDE rapporté au PIB, et à l'inverse par un faible
niveau de dépenses R&D privées ». Aucune société
française ne figure parmi les cinquante entreprises mondiales les plus
innovantes identifiées par BusinessWeek-BCG. En conséquence,
« le niveau de prise de responsabilités de la France dans les
travaux de normalisation internationale a régressé depuis dix ans, pour
se situer aujourd'hui à la moitié de [celui] de l'Allemagne ».
Ce sombre tableau présente quelques nuances. Disposant
d'infrastructures de qualité, le territoire national attire des
investissements directs étrangers jugés, dans l'ensemble, importants et
créateurs d'emplois. « Ce flux a mieux résisté en France que
dans le reste de l'Europe en 2009 puisqu'il n'a baissé que de
27 % contre 45 % sur l'ensemble de
l'Europe. » De grandes entreprises françaises bénéficient d'un
rayonnement mondial et d'un savoir-faire reconnu. Tout particulièrement
les industries de santé, « porteuses d'une très forte valeur
ajoutée économique et sociale ». Enfin, « par ses
positions fortes dans les industries de la chimie, de l'énergie, de
l'électronique et de la mécanique », la France pourrait
« prendre une position de leader
européen, voire mondial, dans la réponse au défi du développement
durable ».
Au crédit des pouvoirs publics, les rapporteurs mentionnent,
entre autres, l'institution du crédit impôt recherche, qui
aurait « un effet positif sur l'accroissement de l'effort de
recherche des entreprises ». Autre « mesure
phare » : « la mise en place des pôles de
compétitivité qui ont permis en quatre ans de mettre en œuvre pour plus
de 4 milliards d'euros de projets collaboratifs financés à
30 % par l'État et les collectivités territoriales, le reste
par les entreprises. L'existence des pôles constitue aussi et peut-être
surtout un levier important d'amélioration de la qualité d'un dialogue
entre la recherche publique et la recherche privée dont la faiblesse
est largement identifiée comme un problème crucial de l'innovation en
France. »
Biens et services ne sont plus séparables
D'aucuns pariaient sur la "sanctuarisation" de certains
domaines d'activité, voire une "spécialisation internationale" reposant
sur la dichotomie produits-services. Or, soulignent les rapporteurs,
« l'imbrication des produits et équipements industriels et des
services associés de mise en œuvre, d'installation, d'exploitation et
de maintenance, font que désormais c'est souvent une fonction, voire un
service, assurés dans le temps, qui sont vendus, plus qu'un objet
manufacturé ». À leurs yeux, « l'idée d'une économie
fondée sur l'amont et l'aval de la production apparaît désormais comme
un non-sens : la R&D est aussi délocalisable, les services le
sont aussi (voir l'essor des services informatiques en Inde, la
délocalisation des call-centers) ».
Leurs considérations demeurent très générales. Ils réclament,
par exemple, « une promotion soutenue du "made in
France" », sans s'aventurer à en préciser les modalités –
soumises aux règles du marché unique européen. Entrés dans leur seconde
phase, les États généraux de l'Industrie travaillent maintenant à la
« définition des propositions d'actions », dont la
mise en œuvre nécessitera « la mobilisation et l'engagement de
tous les acteurs autour de l'objectif de la reconquête
industrielle ».
Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaire | Lien permanent
25 janvier 2010
Le président du Conseil européen vient d'ouvrir une
grand'messe de la francophonie. Aperçu de son intervention.

Le président du Conseil européen était à Paris aujourd'hui.
Nous avons assisté à son discours prononcé en ouverture du
23e colloque international de l'Alliance française. Herman Van
Rompuy fut introduit par le président de la fondation, Jean-Pierre de
Launoit, qui brossa, non sans complicité, le portrait d'un homme au
« regard pétillant et malicieux ». Lequel nous confia
qu'il avait appris le français dans la rue ; pour ce Belge
issu d'une famille néerlandophone, la langue de Molière fut d'abord
celle « du quartier et des terrains de football ».
Évoquant « une époque de mutations
profondes », l'ancien Premier ministre belge s'est interrogé
sur le rapport à la culture qui en émergerait. Tout en observant la
« McDonaldisation » de l'Europe et du monde, il s'est
prémuni des « oppositions stériles » –
« Google contre Proust », « la Silicon
Valley contre Venise », etc. « Avec le mot
"Amérique", je risque de toucher un point sensible » avait-il
prévenu. La culture du Nouveau Monde lui apparaît « riche à
bien des égards ». Il n'en demeure pas moins un promoteur des
Humanités.
Revenant sur « la longue histoire de notre
continent », le président du Conseil européen a retenu
quelques périodes d'unification, auxquelles succédèrent des
éclatements : la chrétienté du Moyen Âge, où la même liturgie
était célébrée partout en Europe dans la même langue – un symbole parmi
d'autres d'« une vraie "standardisation
culturelle" » ; la République des Lettres, née d'une
Renaissance préparée par la redécouverte d'Aristote par saint Thomas
d'Aquin ; l'Empire napoléonien. La présent serait
« le résultat de ce double mouvement ».
Herman Van Rompuy s'est attaché à décrire « une tension
permanente entre l'universel et le particulier » qu'il juge
caractéristique de l'héritage européen.
Fustigeant – gentiment – l'utopie de Julien Benda, promoteur
d'une langue commune à tout le continent, il a déclaré lui préférer la
« sagesse » d'un Denis de Rougemont, qu'il découvrit
chez les Jésuites dans les années soixante. « L'Europe ne peut
pas fonctionner sur le modèle de l'État-nation », a-t-il
observé. D'autant que « les États membres veulent être
ensemble ; ils ne veulent pas être un ». Une
distinction que les souverainistes jugeront sans doute trop subtile. 😉
Publié dans Europe, Francophonie | Pas de commentaire | Lien permanent