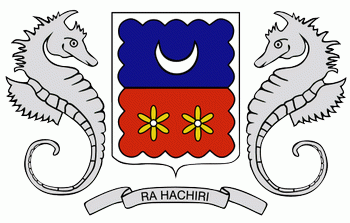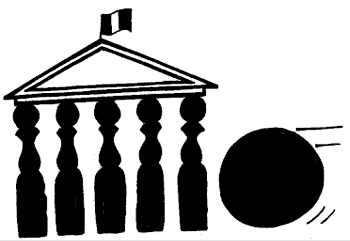17 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Un parlementaire veut insérer l'homosexualité et le "genre"
dans un accord international. Cela sans tenir du compte du calendrier
des négociations, ni respecter la nature des résolutions européennes du
Sénat.

L'invocation des "droits de l'homme" serait-elle
dépassée ? Sans doute a-t-elle une portée trop générale aux
yeux de Mme Alima Boumediene-Thiery, sénateur Vert de Paris.
Forte du soutien d'une vingtaine de collègues, parmi lesquels on
reconnaît les noms de Robert Badinter, Catherine Tasca ou Dominique
Voynet, elle a déposé une proposition de résolution européenne portant
sur l'insertion d'« une clause de non discrimination en raison
de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre » dans
l'accord de Cotonou.
Inconséquence
Signé le 23 juin 2000, ce texte fixe le
cadre du partenariat liant les États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) à l'Union européenne. Conclu pour une durée de vingt
ans, il est néanmoins révisé tous les cinq ans. À cet effet, les
dernières négociations ont été ouvertes en mai 2009, et conclues en
mars dernier – ce que semblait ignorer Mme Boumediene-Thiery,
soucieuse d'orienter une discussion qui se trouve déjà close.
« C'est en réalité en février 2009, au moment où
était adopté le mandat de négociation de la Commission européenne,
qu'une telle invitation aurait trouvé sa place », souligne
Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour la commission des Lois du Sénat.
Par ailleurs, en invitant les États ACP à respecter le principe de non
discrimination, sa collègue a méconnu « la logique des
résolutions européennes », censées délivrer un message
politique au gouvernement ou aux instances européennes, mais non à des
pays tiers.
La Halde veille
De toute façon, précise M. Hyest, les États ACP se
sont « résolument opposés » à toute référence à
l'homosexualité et au "genre", « en dépit de la demande
renouvelée de la Commission européenne ». Sur le continent
africain, l'homosexualité ne serait "légale" que dans treize
pays ; en Mauritanie, au Nigéria, en Somalie et au Soudan,
elle serait même passible de la peine capitale. Quant à la France, elle
« semble connaître depuis peu des cas de discrimination à
l'égard des personnes transgenres », déplore le
sénateur : « Comme le souligne une récente
délibération de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
et pour la promotion de l'égalité (HALDE), ces personnes "sont souvent
victimes de discrimination durant la période d'adaptation et de
conversion sexuelle". [...] Une autre délibération, un peu plus
ancienne, de cette même autorité a recommandé à la Caisse nationale
d'assurance maladie de prévoir une circulaire à destination de ses
services afin qu'ils soient vigilants sur l'immatriculation sociale du
patient en tenant compte du changement d'état civil des personnes
transgenres. Dans cette affaire, l'apparence physique de la réclamante
et son immatriculation à la Sécurité sociale ne coïncidant plus, elle
avait été contrainte de révéler son changement de sexe à son employeur.
À la suite de cette révélation, elle a été victime de moqueries et de
pressions qui l'ont contrainte à démissionner. »
Passer d'un sexe à l'autre en toute liberté
Le mois dernier, le ministère de la Justice a diffusé une
circulaire invitant le ministère public à émettre un avis favorable aux
demandes de changement de sexe à l'état civil, dès lors que les
traitements conférant une apparence physique et un comportement social
correspondant au sexe revendiqué ont bien entraîné un changement
définitif et irréversible, même en l'absence d'opération chirurgicale
d'ablation des organes génitaux. Selon Jean-Jacques Hyest,
« le droit à la vie privée justifie que l'état civil indique
le sexe dont la personne a désormais l'apparence ».
Réunie le mercredi 9 juin, la commission des Lois a
donc approuvé la proposition de Mme Alima
Boumediene-Thiery, « mais en retenant une rédaction plus
conforme à la logique d'une résolution européenne ». Ce
faisant, sans doute a-t-elle confirmé l'emprise croissante de
l'idéologie du genre sur les élites républicaines.
Publié dans France | Pas de commentaires
17 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'île aux Parfums s'acclimate progressivement au statut de
département d'outre-mer français qui lui sera conféré l'année
prochaine. Entres autres domaines faisant l'objet d'une
réforme : le mariage et la justice.
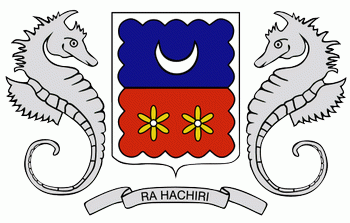
Une nouvelle étape dans le processus de départementalisation
de Mayotte a été franchie le mercredi 2 juin. Ce jour-là,
Mme Marie-Luce Penchard, ministre de l'Outre-Mer, a présenté
une ordonnance portant dispositions relatives au statut civil de droit
local applicable sur l'île aux Parfums, ainsi qu'aux juridictions
compétentes pour en connaître. Selon les explications du gouvernement,
ce texte vise à mettre un terme à l'inégalité entre les hommes et les
femmes en matière de mariage et de divorce : il proscrit la
répudiation et interdit de contracter de nouvelles unions polygames,
sans condition d'âge ; jusqu'alors, les hommes nés avant 1987
bénéficiaient d'un statut privilégié, garanti par la loi de programme
pour l'Outre-Mer du 21 juillet 2003.
En relevant à dix-huit ans l'âge légal du mariage des femmes,
cette ordonnance permettra l'adhésion de la France à la Convention
internationale sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage
et l'enregistrement des mariages, adoptée à New York le
7 novembre 1962 – adhésion jusqu'ici différée en raison de la
spécificité des règles applicables à Mayotte. Le texte supprime
également la justice cadiale, dont le fonctionnement n'était pas
compatible avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. « Le système cadial est
en place aux Comores et à Mayotte depuis l'arrivée des Shiraziens entre
le XIVe et le XVIe siècle », rapportait en 2001 le
sénateur José Balarello. « Depuis cette époque, le cadi joue
un rôle de juge, de médiateur et d'institution régulatrice de la vie
sociale et familiale. Il a été explicitement maintenu par [le] traité
de 1841 passé entre le sultan Andriansouly et le commandant
Passot. »
La charia sur la sellette
Régis par un statut fixé en 1986, les cadis et les secrétaires
greffiers étaient des fonctionnaires de la collectivité territoriale de
Mayotte ; recrutés sur concours, ils étaient investis par le
préfet, après avis du procureur de la République près le tribunal
supérieur d'appel et d'une commission présidée par le président du
tribunal supérieur d'appel et composée de quatre personnalités
religieuses désignées par le préfet et le Grand cadi. Outre
l'application de certains principes du droit coutumier (répudiation,
polygamie, double part successorale des hommes...), le fonctionnement
même de la justice cadiale était critiqué : « Les
cadis ne disposent souvent d'aucune documentation et leur
méconnaissance du droit musulman entraîne des divergences de
jurisprudence d'autant plus insatisfaisantes que le taux d'appel
demeure très faible. De plus, l'absence de formule exécutoire rend
l'exécution des décisions aléatoire. Par ailleurs, la justice cadiale
ne connaît pas la représentation par des avocats. »
L'ordonnance présentée le 2 juin 2010 substitue à la
justice cadiale une compétence de plein droit de la juridiction de
droit commun pour connaître des conflits entre personnes relevant du
statut personnel de droit local. Conformément au Pacte pour la
départementalisation, le rôle des cadis sera recentré sur des fonctions
de médiation sociale.
Publié dans Outre-mer | Pas de commentaires
17 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
La grand-messe du football mondial s'est ouverte vendredi
dernier. L'événement se prête naturellement à de multiples tentatives
de récupération. Sa démesure économique, aussi bien que le sort des
laissés-pour-compte, témoignent des dysfonctionnements de notre
"village global".

Nul ne peut échapper à la déferlante footballistique. Nos
colonnes elles-mêmes n'échappent pas à quelques embruns... Comme
toujours, nos lecteurs se diviseront selon qu'ils soient emportés par
la ferveur populaire ou exaspérés par les hordes de supporters, le
vacarme des vuvuzelas retransmis depuis l'Afrique du Sud, et les
inévitables récupérations politiques.
La mayonnaise aurait-elle tourné ?
Ici ou là, on ne manquera pas d'agiter le drapeau râpé de la
France black-blanc-beur, tandis qu'Alain Finkielkraut stigmatisera avec
une conviction renouvelée une équipe
« black-black-black ». Cela au grand dam d'Éric
Besson : découvrant la sélection de Raymond Domenech, le
ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et
du Développement solidaire avait regretté « qu'il n'y ait pas
au moins un des Benzema, Ben Arfa ou Nasri » – autrement dit,
un joueur d'origine maghrébine. La mayonnaise de la "diversité"
aurait-elle tourné ?
Depuis le 26 mai, et jusqu'au 11 octobre, la
Cité nationale de l'histoire de l'immigration consacre une exposition
au ballon rond. « Pratique originaire d'Angleterre, le
football se diffuse en France à la fin du XIXe siècle, à la
faveur des déplacements et migrations », rappellent les
organisateurs. « Joueurs étrangers en clubs amateurs du début
du XXe siècle, vedettes étrangères en clubs professionnels du
championnat de France, joueurs naturalisés ou, plus fréquemment,
d'origine étrangère endossant le maillot tricolore lors des
compétitions internationales, relations entre supporters, joueurs et
clubs, entre médias et joueurs : le football révèle nombre
d'enjeux de la société d'aujourd'hui. "Facteur de rapprochement entre
les peuples" pour les uns "creuset" de l'immigration pour les autres,
ou encore sport pouvant générer xénophobie et racisme, le football et
sa pratique constituent à leur manière un miroir de la société
française. »
Audience record en Chine
Voilà une époque révolue. Dorénavant, en effet, ce miroir
reflète, dans une large mesure, l'image du village global, en dépit du
désintérêt des Américains pour le soccer. Lors
des deux premières journées de la compétition, c'est dans l'empire du
Milieu, selon la Fédération internationale de football (FIFA), qu'a été
enregistré le record d'audience nationale, 24 millions de
Chinois ayant suivi la retransmission du match opposant la Grèce à la
Corée du Sud.
Aussi les "récupérations" débordent-elles largement du
périmètre hexagonal. Samedi dernier, 12 juin, le colonel
Kadhafi a vigoureusement condamné la FIFA, une « mafia
mondiale » qu'il accuse d'organiser un « trafic
d’êtres humains ». Force est de reconnaître qu'il n'a pas tout
à fait tort. Le mois dernier, Maryse Ewanjé-Epée a justement publié,
aux éditions du Rocher, une enquête consacrée aux Négriers du foot.
« Ils sont des centaines chaque mois, les enfants foot qui
embarquent pour le voyage sans retour vers d'illusoires
carrières », annonce la quatrième de couverture. « En
Afrique, le football suscite des passions sans bornes : il est
le ticket pour l'ascenseur social. Trafic d'identités, chantage, ruines
familiales, disparitions, le phénomène a bouleversé la vie de milliers
de familles. Un exilé africain sur mille, en moyenne, fait carrière
dans le football. Les autres finissent dans les statistiques des
associations comme Foot Solidaire ou Manifootball, qui recensent plus
de 200 cas de maltraitance et d'escroquerie chaque année. En France,
plus de 1 200 cas d'enfants foot et de footballeurs sans
papiers ont été identifiés »
En revanche, ce sont de jeunes gens présents sur le sol
national depuis leur naissance qui suivront non pas le parcours de
l'équipe de France, mais celui de la sélection algérienne. Les "Verts",
comme on les appelle eux aussi, n'avaient plus participé à la phase
finale de la Coupe du monde de football depuis vingt-quatre ans. Mais
parmi eux, seuls deux joueurs évolueraient dans un club local.
« Pour les Algériens, c’est une équipe importée »,
apprend-on sur le site Internet de RFI. Peut-être
le malaise identitaire n'est-il pas une spécificité française...
Une réponse à la crise...
"Footeux" (comme Philippe de Villiers) ou feignant de l'être,
les politiques défileront à l'antenne de Public Sénat, qui lance une
émission censée les mettre aux prises avec les enjeux des matchs à
venir. Dans les bureaux élyséens, enfin, on se réjouit à l'annonce de
la reprise économique : « Le sport, c'est une réponse
à la crise », avait déclaré le président de la République,
alors qu'il plaidait pour que la France organise l'Euro 2016.
Bank of America estime à 0,5 points de PIB l'apport de la
Coupe du monde à l'économie sud-africaine. « Mais la question
du bénéfice de l'accueil de ce type de manifestation pour le pays reste
entière sur le long terme », tempère notre consœur Sandrine
Cassini (La Tribune, 11/06/2010).
Dans l'immédiat, peut-être Nicolas Sarkozy caresse-t-il
l'espoir qu'un exploit sportif des Bleus galvanisera le moral de la
nation. À moins qu'il formule l'hypothèse selon laquelle la distraction
des traders apaiserait la tension régnant sur les
marchés financiers. En tout cas, on est loin du temps où le chef de
l'État nous promettait qu'il irait chercher la croissance avec les
dents.
Publié dans Non classé | Pas de commentaires
17 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Tandis que les déficits publics alimentent les difficultés de
financement des entreprises, les velléités "régulatrices" se heurtent à
l'opacité de nouveaux produits proposés aux investisseurs. Aperçu du
tableau dressé par l'AMF.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a présenté le mois
dernier « la cartographie 2010 des risques et tendances sur
les marchés financiers et pour l'épargne ». Jean-Pierre
Jouyet, son président, a pointé – sans surprise – le déséquilibre des
finances publiques : ce serait « le premier des
risques » pesant sur notre économie, sinon le seul,
« car en un sens il englobe tous les autres ».
Mauvais présage
Dans l'immédiat, les marchés obligataires sont menacés par la
hausse des taux d'intérêt. Mardi 8 juin, les CDS (credit
default swaps) se sont envolés : le coût annuel des
assurances protégeant les investisseurs contre un défaut de paiement
français à cinq ans a dépassé les 100 points de base (1 % de
la valeur notionnelle). Un prélude à la perte du "triple A"
dont Paris bénéficie depuis qu'il est noté par
Standard & Poor's, Moody's et
Fitch ? Le spectre d'une dégradation hante vraisemblablement
les couloirs de Bercy. D'autant que les déboires de l'État ont pour
corollaire « un durcissement des conditions de financement de
l'ensemble des agents économiques ». Les PME seraient tout
particulièrement affectées par « la concurrence accrue pour
l'accès aux financements ». Quant aux épargnants,
« de plus en plus frileux », ils privilégient
« une allocation de leur épargne faiblement
rémunératrice » à l'origine d'un « sous-rendement
structurel ».
Ingéniosité spéculative
Si les modalités de cotation des actions et le trading
algorithmique inspirent toujours quelque réserve ou inquiétude, tel ne
serait plus le cas des transactions de gré à gré, en raison de leur
évolution « inévitable » vers un large recours à
l'entremise des chambres de compensation, complété par un
enregistrement dans des bases de données centrales pour les marchés de
dérivés. « Ainsi les chambres de compensation et
d'enregistrement vont-elles devenir des maillons essentiels de la
chaine des risques » dont il conviendra de
« surveiller étroitement » la gouvernance. L'AMF
prône l'implantation en zone euro des chambres traitant des contrats
libellés dans la monnaie unique.
Son président déplore la commercialisation de nouveaux
produits qui seraient « surtout destinés à contourner les
contraintes règlementaires en matière de fonds propres ou conçus pour
satisfaire les exigences des investisseurs en matière de notation des
titres en portefeuille ». Or, étant donné leur complexité
croissante, il n'est « pas certain que ces instruments de
dette soient correctement valorisés sur les marchés et que les
investisseurs estiment correctement le risque de crédit
associé ».
La prudence contre le principe de précaution
Cela dit, Jean-Pierre Jouyet met en garde contre
« une surenchère dans la volonté de maitriser tous les
risques » : « Si on cherche à créer une
économie sans risque, il n'y aura plus d'économie du tout. C'est à la
qualité de la maîtrise et du contrôle des risques que nous devons
veiller et non à l'éradication totale du risque. Car le risque vraiment
nocif, c'est celui que l'on n'a pas su ou voulu anticiper. »
La prudence va-t-elle éclipser le "principe de précaution" ?
Hélas, la République ne s'est pas montrée exemplaire dans l'exercice
des vertus cardinales... Confrontés aux exigences contradictoires des
marchés, qui appellent à maîtriser les déficits publics sans
compromettre la relance de l'économie, les pouvoirs publics devront
agir avec doigté », selon l'expression de
M. Jouyet. Ils seront forcés de reconnaître, un jour ou
l'autre, la faillite de l'État-providence. Le plus tôt sera le mieux.
Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaires
3 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'OTAN prépare l'adoption d'un nouveau concept stratégique,
censé l'inscrire dans le monde de l'après-11 Septembre. Le
Commandement allié pour la Transformation, avec un Français à sa tête,
est étroitement associé aux travaux.

L'OTAN s'achemine vers l'adoption d'un nouveau concept
stratégique. Réunis à cet effet en novembre prochain, les chefs d'État
ou de gouvernement des vingt-huit pays membres s'appuieront sur les
recommandations d'un "groupe d'experts" présidé par
Mme Madeleine K. Albright, dont le rapport a été publié le
17 mai, et qui aurait travaillé « en très étroite
collaboration » avec le Commandement allié Transformation
(ACT), selon le témoignage du Français placé à sa tête, le général
Stéphane Abrial – lequel s'est défini comme le « gardien de
l'avenir militaire de l'Alliance atlantique » lors d'une
conférence prononcée à Paris jeudi dernier, 27 mai, à
l'invitation de l'IFRI.
Trois menaces
Outre la perturbation des axes d'approvisionnement énergétique
et des voies maritimes, trois menaces pèseraient plus particulièrement
sur les Alliés : une attaque de missile balistique, avec ou
sans charge nucléaire ; des attentats perpétrés par des
groupes terroristes internationaux ; des cyberattaques. Des
menaces qui présentent « des variantes hybrides, combinant par
exemple la clandestinité d'un groupe terroriste avec la puissance
normalement associée à un État-nation – comme les armes de destruction
massive, qui peuvent se monnayer ou se voler ». Dans ces
conditions, une défense efficace devrait souvent commencer
« bien au-delà du territoire de l'Alliance ».
Les rapporteurs réaffirment néanmoins la vocation régionale de
l'Alliance, qui « ne saurait régler à elle seule tous les
problèmes de sécurité de la planète ». Ils appellent à fixer
des « principes directeurs » orientant les
interventions de l'OTAN au-delà de ses frontières, et plaident pour le
renforcement des partenariats – où l'on recherchera la synergie plutôt
que l'unité de commandement, suivant les conseils du général Abrial.
« Le concept stratégique devrait [...] donner aux partenaires
d'opérations de l'OTAN la possibilité de faire régulièrement et
véritablement entendre leur voix. » En outre,
« d'autres organisations [...] peuvent prendre la direction
des opérations lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs aussi
essentiels que la reconstruction économique, la réconciliation
politique ». En application des enseignements tirés de
l'expérience afghane, « il faut continuer d'insister sur la
nécessité de protéger les civils. [...] L'objectif premier est
d'établir une approche civilo-militaire globale qui permette aux
autorités locales de gagner la confiance et la loyauté de la
population. » L'"approche globale" est « un fil rouge
qui parcourt l'ensemble de mon action », a souligné le général
Abrial. Mais selon le groupe d'experts, « les efforts de
l'OTAN pour opérer avec des partenaires civils manquent encore de
cohérence ».
Si l'UE constitue un partenaire
« essentiel », sa coordination avec l'OTAN demeure
insuffisante ; le différend opposant Chypre et la Turquie
n'arrange rien à l'affaire... Le général Abrial a toutefois
ouvert « un dialogue suivi » avec l'Agence européenne
de défense, qui détient au sein de l'Union les compétences les plus
proches de celles de l'ACT. Évoquant l'ONU, Mme Albright et
ses collègues observent que son personnel « s'est parfois
montré déçu par le niveau de sécurité et de soutien que l'OTAN lui
apportait ». Sur le terrain, les deux institutions se
disputent parfois les responsabilités. Signe des temps, le rapport
stipule que « l'OTAN devrait travailler avec l'ONU afin de
donner une suite favorable à la résolution 1325 du Conseil de sécurité
sur le rôle des femmes dans la paix et la sécurité ».
Défense antimissile
La coopération avec la Russie est encouragée. Elle apparaît
« hautement souhaitable » en matière de défense
antimissile, domaine que les rapporteurs voudraient inscrire
« au nombre des missions essentielles de
l'Alliance ». « La question est sur la
table », a reconnu le général Abrial. Sans y répondre, il
s'est interrogé sur les menaces auxquelles répondrait un dispositif
antimissile, sur son coût et ses effets d'éviction. En revanche, le
retrait des armes nucléaires américaines stationnées en Europe ne
serait plus à l'ordre du jour.
« Il convient [...] de passer du dispositif certes
puissant, mais statique, de la Guerre froide à une posture plus souple,
plus mobile et plus polyvalente », ont résumé les experts.
Naturellement, « le principal obstacle à la transformation
militaire est l'insuffisance des dépenses et des investissements de
défense en Europe. [...] Un fossé particulièrement large s'est creusé
entre les capacités des États-Unis et celles des autres pays de l'OTAN,
et ce déséquilibre, s'il n'est pas corrigé, pourrait nuire à la
cohésion de l'Alliance. » « La crise va nous forcer à
une réforme indispensable », a commenté le général Abrial.
Afin de rentabiliser au mieux les ressources disponibles, il entend
mettre en réseau les capacités de transformation des Alliés, en créant,
par exemple, un « catalogue de formations ». Dans un
registre similaire, les rapporteurs promeuvent « de nouveaux
mécanismes informels de mutualisation des moyens, en particulier pour
le transport ».
L'alpha et l'oméga du nouveau concept
De leur point de vue, « l'élaboration d'un nouveau
concept stratégique offre l'occasion de faire connaître l'OTAN à des
populations qui en savent peu à son sujet et qui doutent peut-être de
son intérêt pour leur existence ». Dans cette optique, on
comprend mieux la relecture qui nous est proposée de
l'histoire : « En 1949, ce n'est pas à cause des
forces qu'ils redoutaient que les États membres de l'OTAN se sont
alliés, c'est parce qu'ils se faisaient mutuellement confiance et
qu'ils avaient foi dans les valeurs démocratiques. » Y compris
le Portugal de Salazar ? « Les idéaux fondateurs de
l'OTAN devront être l'alpha et l'oméga du nouveau concept
stratégique », conclut le groupe d'experts.
Gageons que ces considérations idéologiques seront sans grande
incidence sur le travail de l'ACT. Celui-ci pourrait bientôt
« monter en puissance ». Une chance pour la France,
qui en détient désormais le commandement ? « Nous
faisons partie de ceux qui tiennent la plume », s'est félicité
le général Abrial. Moins d'un an après sa prise de fonction, sans doute
est-il trop tôt pour tirer un premier bilan. Associant les industriels
à ses travaux, il a notamment assuré qu'une place plus juste serait
accordée aux entreprises européennes. Affaire à suivre.
Publié dans Défense | 2 Commentaires
3 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Tandis que la France perd un nouveau soldat, l'engagement en
Afghanistan suscite les commentaires réalistes du ministre britannique
de la Défense et pourrait s'immiscer dans la campagne
électorale en Belgique.

Un capitaine du 3e régiment de génie de
Charleville-Mézières est mort en Afghanistan le samedi 22 mai.
Barek Deligny, trente-huit ans, était marié et père de deux enfants.
Intervenant au sein d'une équipe de déminage aux côtés de soldats
néerlandais et afghans, il a été mortellement blessé par le
déclenchement d'un engin explosif improvisé (IED). Au cours de
l'attaque, un soldat néerlandais et un interprète afghan ont également
été tués. Selon l'armée de Terre, cet officier était « d'une
disponibilité sans faille et d'un comportement
exemplaire » ; « sportif confirmé et meneur
d'hommes », il montrait « un goût avéré pour l'action et
l'effort » (Secret Défense, 23/05/2010).
Vers les premiers désengagements en 2011
Il fut le quarante-deuxième soldat français tombé en
Afghanistan. Le chef de l'État n'en a pas moins exprimé « la
détermination de la France à continuer d'œuvrer au sein de la Force
internationale d'Assistance à la Sécurité », pour
« contribuer au retour de la stabilité, au rétablissement de
la paix et au développement en Afghanistan ». Vaste
programme !
Dans un entretien accordé à Philippe Cohen (France Soir,
04/05/2010), le ministre de la Défense, Hervé Morin, s'était montré
relativement optimiste, au point d'envisager, pour la première fois, un
désengagement courant 2011, dans la foulée des Américains :
« Nos compatriotes n'entendent malheureusement parler de
l'Afghanistan que lorsqu'un de nos soldats y est tué. En vérité, quand
on regarde les deux zones dont nous avons la responsabilité militaire,
la situation progresse. La montée en puissance de l'armée nationale
afghane que nous formons est significative. Notre objectif principal
est de commencer, dès la fin de l'année, à transférer aux Afghans
certaines zones, comme nous l'avons déjà fait à Kaboul. [...] Oui, nous
pouvons espérer être en mesure, pour l'année 2011, de transférer des
zones à l'armée et à la police afghane. »
Ministre décomplexé
Outre-Manche, Liam Fox, le nouveau ministre de la Défense, se
montre préoccupé par le conflit afghan. Faut-il que des soldats
britanniques risquent leur vie si loin de leur pays ? « C'est
une question que vous vous posez chaque jour », a-t-il confié
à la presse (Times online, 22/05/2010). Il entend
veiller, tout particulièrement, au moral de ses troupes. Revendiquant
l'étiquette « néoréaliste », il souligne l'objectif
militaire, et non humanitaire, de leur mission :
« Nous sommes là-bas pour que les Britanniques et nos intérêts
mondiaux ne soient pas menacés. [...] Nous ne sommes pas un policier
mondial. Nous avons des obligations vis-à-vis de la pauvreté et des
droits de l'homme, mais la situation en Afghanistan n'est pas
différente de celle de dizaines d'autres pays... » Voilà qui
tranche avec le discours "droit de l'hommiste" auquel nous ont habitués
les élites nationales.
Échec européen
En Belgique, la question afghane pourrait s'immiscer dans la
campagne électorale : « Dans une interview
au quotidien Le Soir, Dirk Van der
Maelen (député à la Chambre) demande un retrait des troupes belges
d'Afghanistan et en fait, même, une condition de la participation des
socialistes au gouvernement. Ce retrait devrait intervenir, selon lui,
"dès 2011, en phase et de manière coordonnée avec les
partenaires". » (Bruxelles 2,
25/05/2010)
Quant à l'Union européenne, elle a entériné le 18 mai
le prolongement pour trois ans de sa mission de police en Afghanistan
(Eupol Afghanistan), encore très loin de réunir les effectifs prévus à
l'origine. Pour l'heure, cela n'a rien d'un franc succès :
« Faiblesse du leadership, restrictions excessives de
sécurité, mandat limité et manque de stratégie, [...] la mission de
police de l'UE en Afghanistan illustre au mieux les défauts de
l'engagement de l'UE. » Tels sont les principaux éléments
d'une analyse du Centre for European Reform, dévoilés par Nicolas
Gros-Verheyde (Bruxelles 2, 17/05/2010).
Force est de le constater, la guerre demeure une affaire nationale.
Publié dans Défense | Pas de commentaires
3 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
La Commission européenne propose timidement d'accroitre les
efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avec
une croissance en berne, ce projet est-il déraisonnable ? En tout cas,
Paris n'en veut pas.

Dans une communication publiée le mercredi 26 mai, la
Commission européenne invite « à la tenue d'un débat
éclairé » sur l'incidence qu'aurait le passage à un objectif
de réduction des gaz à effet de serre (GES) dans l'UE de 30 %,
et non plus 20 %, par rapport au niveau de 1990. Cela,
« pour autant que les conditions le permettent ».
Visiblement, Bruxelles évite de trop se mouiller ! En effet,
il doit compter avec la réticence de plusieurs États membres. Telle
l'Allemagne, qui entend préserver son industrie lourde, ou la France,
dont le Conseil d'analyse stratégique (l'héritier du commissariat
général du Plan) réprouve tout nouvel effort qui serait décidé de façon
unilatérale par les Européens.
La France a trop d'avance
Dans une note publiée le mois dernier, il met en garde contre
de lourdes répercussions en termes de compétitivité et d'emploi. La
France a une longueur d'avance dans la réduction de ses émissions de
GES. Mais « sa production électrique étant déjà décarbonée à
près de 90 %, [elle] dispose désormais de beaucoup moins de
marges de manœuvre pour réduire ses émissions liées à la production
d'électricité. Sa situation démographique est en outre particulière au
sein de l'Europe : si les tendances récentes se poursuivent,
sa population pourrait augmenter de 8,6 % d'ici à 2030 par
rapport à 2010, ajoutant une difficulté supplémentaire à la réduction
des émissions de GES (alors que, dans le même temps, la population de
l'UE-27 n'augmenterait que de 5 %). »
Outre-Atlantique...
Une comparaison avec le projet de loi américain Waxman-Markey
sur la lutte contre le changement climatique, voté en
juin 2009 par la Chambre des Représentants, s'avère
éclairante : « Les études prospectives indiquent
qu'entre 80 % et 88 % des efforts de réduction
d'émissions seront réalisés par le secteur électrique. » Or,
Il est « beaucoup plus facile de mobiliser quelques centaines
d'acteurs industriels dans le secteur de l'électricité que des millions
de particuliers dans le secteur de l'habitat existant. Les Américains
ne devraient donc pas être amenés à modifier sensiblement leur way
of life, tandis que les Européens, et les Français
notamment, devront engager une modification durable de leurs
comportements. »
En pleine crise, la proposition de la Commission européenne
semble à première vue déplacé. Mais « depuis 2008, le coût
absolu de la réalisation de l'objectif de 20 % est passé de
70 milliards d'euros à 48 milliards [...] par an
d'ici 2020. Cette diminution est due à plusieurs facteurs : la
croissance économique plus faible a entraîné une réduction des
émissions, les prix élevés de l'énergie ont stimulé l'efficacité
énergétique et fait baisser la demande d'énergie et le prix du carbone
est tombé en-deçà du niveau prévu en 2008, étant donné que les quotas
du SCEQE [système communautaire d'échange de quotas d'émission] non
utilisés pendant la récession seront reportés. »
Quotas déchus
De fait, les quotas ont perdu leur effet incitatif, ce qui
inquiète les promoteurs d'une « croissance verte ».
Bruxelles est de ceux-là : « L'objectif de
20 % de réduction a toujours été considéré comme un levier
décisif pour la modernisation. Les investissements dans les solutions
telles que la capture et le stockage du carbone sont fortement liés au
signal donné par le prix du carbone sur le marché. Un carbone peu cher
carbone incite beaucoup moins au changement et à l'innovation. [...] La
réalisation de l'objectif de 20 % de réduction d'ici à 2020 ne
constituant pas un vecteur de changement aussi important qu'il était
escompté en 2008, le risque existe pour l'UE de devoir fournir
davantage d'efforts, y compris financiers, après 2020. »
En conséquence, la Commission a élaboré quelques scénarios qui
protégeraient l'Union européenne contre les "fuites de carbone" si elle
se fixait unilatéralement un objectif de 30 %. Consciente des
risques de délocalisations vers des pays appliquant des règles moins
strictes, elle n'exclut pas l'instauration d'une "taxe carbone" aux
frontières de l'Union. C'est une petite victoire pour Nicolas
Sarkozy ! Cependant, le projet présidentiel devra compter avec
les engagements commerciaux internationaux, et avec les difficultés
techniques.
La taxe carbone, un vrai casse-tête
« L'intégration des importations dans le
système d'échange de quotas d'émission en soi devrait être
soigneusement préparée afin de s'assurer que le système est compatible
avec les règles de l'OMC. Il pourrait être difficile de mettre en œuvre
un système qui cherche à définir en détail la teneur en carbone de
chaque catégorie de marchandises, mais ce niveau de précision pourrait
être nécessaire : cela signifie que le système pourrait au
mieux être envisageable pour un nombre limité de marchandises
standardisées, comme le ciment ou l'acier. De plus, il faudrait définir
une teneur moyenne en carbone UE pour chaque catégorie de marchandises.
Cela représenterait une charge administrative et nécessiterait de
trouver un accord sur cette valeur moyenne, ce qui exigerait sans doute
un processus difficile et très long. En outre, serait difficile de
vérifier le niveau de performance de différentes installations dans les
pays tiers sans un système de suivi et de notification très sophistiqué
dans ces installations. » Les fonctionnaires en charge du
dossier vont maudire le président de la République.
Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaires
20 mai 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Le vote d'une loi contre le port du voile intégral rassurerait
peut-être l'électorat courtisé par l'UMP, mais il pourrait fournir à
cette pratique une publicité inespérée, faute de s'appuyer sur des
bases juridiques suffisamment solides.

Un projet de loi prohibant le port de voile intégral ou, plus
vraisemblablement, la dissimulation du visage dans l'espace public,
devait être présenté en Conseil des ministres mercredi dernier,
19 mai. Dans l'attente d'en découvrir la teneur, on se
demandait par quelle prouesse juridique le garde ses Sceaux prétendrait
dissiper les menaces de censure soulignées le 25 mars par le
Conseil d 'État.
Une conception élargie de l'ordre public
Inutile d'invoquer la laïcité : « Elle ne
peut s'imposer directement à la société ou aux individus qu'en raison
des exigences propres à certains services publics (comme c'est le cas
des établissements scolaires). » La sauvegarde de la dignité
humaine ne serait pas une base beaucoup plus solide. En effet, la Cour
européenne des droits de l'homme l'a jugée indissociable de la
protection du "libre arbitre", tandis qu'elle se penchait sur les
évanouissements d'une femme soumise aux sévices de deux
complices : les salafistes peuvent compter sur le soutien des
sadomasochistes ! Quant à la sécurité publique, elle
constituerait « un fondement très solide pour une interdiction
de la dissimulation du visage, mais seulement dans des circonstances
particulières » ; en l'absence de troubles avérés,
une interdiction générale reposerait « sur une logique
artificiellement préventive » – laquelle n'a jamais été admise
par la jurisprudence.
En définitive, seule une acception élargie de "l'ordre public"
pourrait s'accommoder de la lubie présidentielle. Il faudrait y voir,
selon les termes du Conseil d'État, « le socle d'exigences
réciproques et de garanties fondamentales de la vie en
société ». « Mais une telle conception, juridiquement
sans précédent, serait exposée à un sérieux risque de censure
constitutionnelle ou conventionnelle, ce qui interdit de la
recommander », ont conclu les magistrats.
1 900 cas en France
Or, une censure de loi « sonnerait comme une défaite
de la République. Il est donc essentiel de bien peser les enjeux et les
risques d'une telle interdiction », avait prévenu la mission
d'information parlementaire sur le voile intégral, dans son rapport
publié en janvier dernier. Les élections régionales et la déroute de
l'UMP auront ouvert la voie aux plus téméraires.... Au risque de faire
la publicité d'une pratique certes en progression, mais qui demeure
marginale.
1 900 femmes porteraient le voile intégral sur le
territoire national, selon les estimations du ministère de l'Intérieur
(dont 270 établies dans les collectivités d'outre-mer). La
moitié seraient âgées de moins de trente ans, et l'immense majorité
(90 %) auraient moins de quarante ans. Les deux tiers seraient
des Françaises, parmi lesquelles la moitié appartiendraient aux
deuxième et troisième générations issues de l'immigration.
Fait remarquable, un quart des femmes intégralement voilées seraient
des converties.
En quête d'identité
« Il s'agit d'une pratique anté-islamique importée ne
présentant pas le caractère d'une prescription religieuse », a
rapporté Éric Raoult au nom de la mission parlementaire.
« Elle participe de l'affirmation radicale de personnalités en
quête d'identité dans l'espace social mais aussi de l'action de
mouvements intégristes extrémistes ; elle représente un défi
pour de nombreux pays. » Et de citer
Mme Nilüfer Göle, directrice d'études à l'École des hautes
études en sciences sociales, faisant le constat que « les
filles portant le foulard en France sont plutôt en rupture avec la
manière traditionnelle dont le portait leur mère ou leur
grand-mère ». La même analyse serait valable au sujet des
femmes portant volontairement le niqab, auxquelles la mission a
attribué deux motivations : « en premier lieu, la
recherche de pureté dans la pratique d'un culte plus austère ;
en second lieu, la volonté de prendre ses distances avec une société
jugée pervertie ».
De grands principes
Prenant acte de la situation, les parlementaires ont proposé,
entre autres, de « renforcer la formation civique délivrée
dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration ». Si la
l'interdiction devait être votée – puis appliquée... –, des stages de
"citoyenneté" seraient peut-être imposés aux contrevenants. Sans doute
y inculquerait-on le principe de laïcité, censé permettre, selon nos
députés schizophrènes, « l'intégration à la communauté
nationale de ceux qui rejoignent la France pour y travailler et y
vivre », mais « n'interférant pas dans leur culture
et leur religion ». « Lutter contre le port du voile
intégral c'est [...] faire œuvre de libération », a encore
proclamé le rapport parlementaire. « C'est notre vivre
ensemble fondé sur l'esprit des Lumières qui est bafoué », a
confirmé André Gérin.
Les pouvoirs publics se fourvoient dans l'idéologie
contractualiste. Laquelle exclut fort logiquement la perspective
d'assimilation – un processus dont l'aboutissement tient moins aux
volontés individuelles qu'à l'enracinement progressif des générations.
Renouant avec ses grands principes, la République se remémorera-t-elle
également ses velléités totalitaires ? Selon les révélations
du Figaro (04/05/2010), le ministre Éric Besson
serait « disposé » à exposer à la déchéance de leur
nationalité des Français coupables d'« atteintes caractérisées
aux valeurs fondamentales de notre République ». Les
royalistes sont prévenus.
Publié dans France, Islam | Pas de commentaires
20 mai 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Confrontés à la crise des dettes souveraines, les dirigeants
politiques peinent à assumer leurs responsabilités. Le long terme étant
étranger à leur horizon, ils n'inspirent aucune confiance aux marchés
et doivent se réfugier derrière l'Europe...

Après avoir livré les traders à la
vindicte populaire, les responsables politiques ont désigné un nouveau
bouc émissaire, en l'occurrence les agences de notation. Leur influence
est incontestable : le 28 avril, après la
rétrogradation de l'Espagne par Standard & Poor's, l'indice
Ibex-35 de la bourse de Madrid avait brusquement chuté, terminant en
baisse de 2,99 %, tandis que, face au dollar, l'euro tombait à
son plus bas niveau depuis un an. Cela dit, c'est somme toute
injustement qu'on a accusé ces agences de promettre la faillite de la
Grèce : tout au plus en ont-elles évalué le risque à
25 %. De quoi effrayer investisseurs et spéculateurs, au
demeurant. Au point que ceux-ci ont pu juger Athènes moins fiable que
Buenos Aires ou Caracas.
Prééminence du politique
Irrationnels, les marchés ? Sans doute, puisqu'ils
concèdent à la France des taux préférentiels en dépit de son déficit
abyssal. Saluons les miracles accomplis par l'Agence France
Trésor : la dette dont elle a la charge avoisinait fin 2009
les 1 500 milliards d'euros, culminant à 77,6 % du
produit intérieur brut. Mais les arbres ne montent pas jusqu'au ciel...
La défiance des marchés vient rappeler à l'ordre des dirigeants
irresponsables – démocratie oblige.
De ce point de vue, loin de constituer une négation du
politique, la crise des dettes souveraines en souligne la
prééminence. « Que les dirigeants européens accusent
la spéculation, c'est de bonne guerre », commente Marc de
Scitivaux (blog de l'Institut Turgot, 13/05/2010)) « Mais ils
font une erreur d'analyse qui risque de leur coûter cher dans l'avenir.
Car ce n'est pas la spéculation qui a attaqué la Grèce avant-hier, le
Portugal ou l'Espagne hier et, qui sait, la France demain, même si
celle-ci peut amplifier les mouvements. C'est infiniment plus sérieux
et plus fondamental : c'est l'épargne mondiale qui marque sa
méfiance et se détourne des "États providence" financés par la
dette. »
Des États dont l'impuissance apparaîtra d'autant plus criante
qu'ils prétendront à l'omnipotence. Faut-il que le ministère de la
Culture s'obstine à offrir leur premier livre à des
nouveaux-nés ? Qu'importe l'amour de Frédéric Mitterrand pour
les enfants, la France dispose sans aucun doute de meilleures
nourrices ! En revanche, le Premier ministre eût été bien
inspiré de jouer les pédagogues. Sans doute l'opinion serait-elle plus
disposée que jamais à s'entendre dire que la nation ne pourra pas vivre
éternellement à crédit. Hélas, François Fillon s'avoue tétanisé par la
« rigueur ».
Les girouettes de l'UMP
Quant aux girouettes de l'UMP, elles ont fait la preuve de
leur lâcheté en s'attaquant au bouclier fiscal. Un bouclier dont la
construction releva certes du bricolage, et dont on peut discuter
l'intérêt. Reste qu'il suffit de quelques atermoiements pour le
fragiliser durablement. Les candidats à l'évasion fiscale savent ce que
vaut la parole d'un État républicain ! Dans ces conditions,
quelle crédibilité les marchés financiers peuvent-ils accorder aux
pouvoirs publics érigeant en « priorité » la
réduction des déficits publics ?
Apparemment, l'Europe demeure la seule voie de salut. Les
circonstances forçant la main aux gouvernements, la Commission de
Bruxelles avance ses pions. Selon la traduction que l'on fait de sa
communication du 12 mai, disponible uniquement dans la langue
de Shakespeare, elle propose que lui soient présentés ou soumis à
l'avenir les projets de budgets nationaux. Les souverainistes les plus
alarmistes dénoncent un nouvel abandon de souveraineté. À l'inverse,
certains y voient un moyen, pour les Exécutifs nationaux, de
s'émanciper via Bruxelles de la pression parlementaire. Le cas échéant,
la technocratie européenne n'en demeurerait pas moins le paravent de la
déliquescence du politique. Triste constat.
Publié dans France | Pas de commentaires
12 mai 2010
Un député veut élire en 2012 un vice-président de la
République.
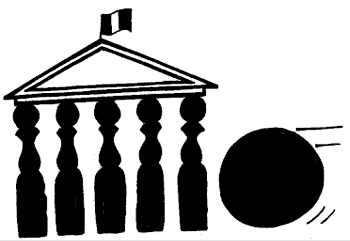
Une
proposition de loi constitutionnelle « visant à
instituer une fonction de vice-président de la République » a
été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le
13 avril 2010. Son auteur, Michel Hunault, député
Nouveau Centre de Loire-Atlantique, entend rebondir sur la mort du
président polonais Lech Kaczynski, dont l'accident ne peut, selon lui,
« laisser indifférent sur l'organisation institutionnelle de
notre démocratie ».
Feignant d'ignorer la mission de suppléance conférée au
président du Sénat, il prétend que « l'instauration d'un poste
de Vice-président permettrait [...] dans des circonstances
exceptionnelles d'assurer la continuité de l'État ». Rédigé
dans un style négligé, l'exposé des motifs témoigne d'une indigence
affligeante. Mais sans doute est-il à l'image d'une démarche quelque
peu hasardeuse. En effet, M. Hunault ne verrait apparemment
aucun inconvénient à abroger les dispositions constitutionnelles
stipulant selon quelles modalités doit être constaté l'empêchement du
chef de l'État.
Un travail typiquement parlementaire ?
Publié dans France | Pas de commentaires