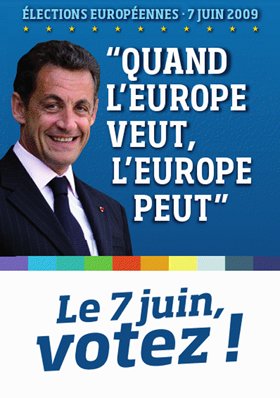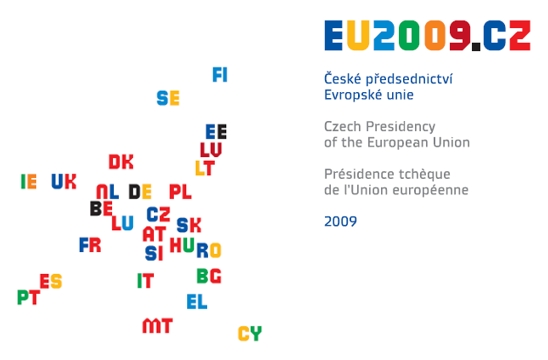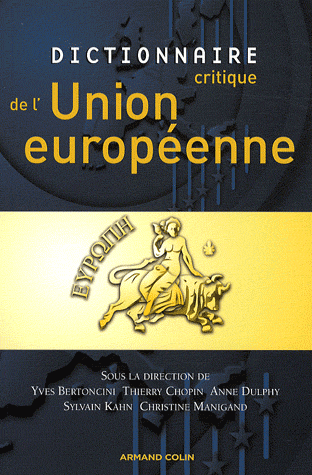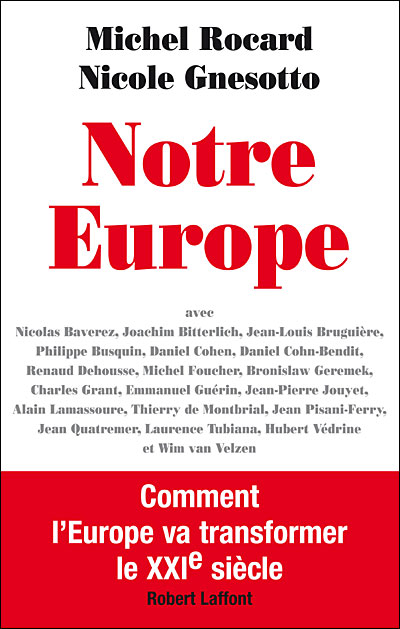18 juin 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Lecture d'un "album secret" signé Jean-Claude Martinez.
Député au Parlement européen de 1989 à 2009, Jean-Claude
Martinez se propose de révéler les secrets de cette institution.
S'appuyant sur les illustrations de Norma Caballero, il convie le
lecteur à la rencontre de six mille habitants, évoluant sur cinquante
hectares répartis dans trois villes : Strasbourg, le siège officiel du
Parlement, où les couloirs seraient un vrai cauchemar ; Bruxelles, qui
supplante peu à peu la capitale alsacienne ; Luxembourg, qui héberge
l'administration. En Belgique, étant donné l'étendue des surfaces à
couvrir, les rondes des agents de sécurité prennent entre six et huit
heures.
On découvre des lieux parfois insolites : la banque ING,
classée centième sur les 4 800 agences que compte le groupe dans le
Plat pays ; un bar dévalisé le soir du 13 juillet 2004, où le Parlement
accueillait les représentants de dix nouveaux États-membres ; une salle
de prières à Strasbourg ; un centre d'épilation à Bruxelles...
L'hémicycle constitue « une PME de cent personnes ». Les votes y sont
expéditifs : les députés disposent de quelques secondes pour presser la
bonne touche de leur machine électronique. Et quand ils prennent la
parole, c'est pour une ou deux minutes, trois tout au plus. Alors
s'affairent les interprètes, censés jongler avec 506 combinaisons
linguistiques possibles !
Soulignant « l'impérialisme de l'anglais », Jean-Claude
Matrinez rapporte cette mésaventure de Jacques Barrot : « Un député
voulait la lecture officielle de la position de la Commission
européenne. Mais ce texte officiel était en anglais. Le commissaire
français un peu juste dans cette langue ne se voyait pas en train de
lire un long texte en anglais. Il a donc fait le sourd en dépit de la
demande répétée de plusieurs députés et de la cruauté complice du
président, ajoutant goguenard : "Le commissaire ne souhaite pas lire." »
Précarité sociale du personnel
Le Parlement européen apparaît sous un jour plus humain qu'à
l'accoutumée. Ce qui n'est pas toujours flatteur. L'auteur s'indigne
des conditions de travail imposées au personnel de la restauration ;
employé par un prestataire externe, il est même privé de badge et de
parking, ceux-ci étant apparemment réservés aux fonctionnaires.
Conséquence des "privatisations", cette précarité illustre les méfaits
du libéralisme économique aux yeux de Jean-Claude Martinez, qui a
incarné une sensibilité "altermondialiste" au sein du Front national.
Issu d'une formation politique marginalisée, il dénonce les
privilèges des groupes majoritaires, ainsi qu'une procédure douteuse
qui l'aurait privé d'une vice-présidence du Parlement Europe-Amérique
latine (Eurolat). Le ton partisan de l'ouvrage procède d'un choix
discutable : des commentaires superflus agaceront peut-être les
sympathisants, et rebuteront sans aucun doute tous les autres.
Jean-Claude Martinez s'autorise même des piques répétées contre « la
fille Le Pen ». On regrette également les insuffisances de la mise en
page, ainsi que la rédaction hasardeuse du texte, où les redondances
sont légion. Si elle permet de glaner ici ou là des informations
précieuses, la lecture s'avère de ce fait décevante, voire frustrante.
Un essai à transformer !
Jean-Claude Martinez, Norma Caballero : L'Album
secret du Parlement européen. Édité par La Maison de la Vie
et des Libertés, 13 rue Durand, 34000 Montpellier ; 200 pages,
59,50 euros franco (chèque à l'ordre de La Maison de la Vie) ;
www.martinezlavie.com
Publié dans Europe, Livres | Pas de commentaires
4 juin 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Un nouveau groupe eurosceptique va se former à Strasbourg. Le Parlement européen n'en restera pas moins une "assemblée de consensus", dont les partis majoritaires continueront de se partager la présidence...

Quelle que soit l'issue des élections, quelques changements
sont déjà annoncés à Strasbourg et Bruxelles. L'euroscepticisme devrait
bénéficier d'une visibilité inédite. À la fin de la législature
1999-2004, les conservateurs britanniques avaient obtenu un "droit de
tendance" au sein de leur groupe, qui les autorisait à se désolidariser
de leurs collègues plus fédéralistes dans les discussions portant sur
l'avenir institutionnel de l'Union. Désormais, les Tories sont résolus
à quitter le PPE-DE, où siègent notamment les députés UMP ;
suivis par les Tchèques de l'ODS, ils devraient former avec eux le
"noyau dur" d'un nouveau groupe politique.
Arrangement technique
Seront-il rejoints par des souverainistes plus marginalisés ?
En tout cas, les "petits partis" souffriront d'une réforme du règlement
intérieur de l'assemblée adoptée en juillet dernier : pour constituer
un groupe, il faudra réunir au moins vingt-cinq députés issus de sept
États membres, contre vingt issus de six pays aujourd'hui.
Le Parlement européen demeurera gouverné par le "consensus"
des formations majoritaires, qui en partagent la présidence en vertu
d'un "arrangement technique". Rappelons ce chiffres agité au cours la
campagne, du NPA jusqu'au Front national : lors des 535 votes finaux
par appel nominal intervenus en 2008, droite et gauche se seraient
exprimées à l'unisson dans 97 % des cas. « Un score digne de la Douma
de l'ex-Union soviétique » commente L'Observatoire de l'Europe !
Prenant en compte le vote des amendements, Jean Quatremer dessine une
réalité plus complexe : « Le PPE et le PSE ne votent au final ensemble
que dans 69,70 % des cas (mais seulement 56 % dans les
affaires sociales et 52,5 % dans le domaine économique). Les
villiéristes votent avec les socialistes dans 40 % des cas alors que
les communistes votent avec le PPE dans 42 % des cas et avec les
villiéristes dans 40,90 % des cas... » (1)
Apolitisme ?
Des subtilités qui ne sauraient gommer une caractéristique
essentielle du Parlement européen, « condamné à gouverner au centre »
selon Paul Magnette (2). Aucune majorité suffisante ne se dégage dans
cette assemblée façonnée par la diversité des paysages politiques
nationaux. La fréquence des votes techniques et les incursions limitées
de l'Union dans les politiques de redistribution sociale tempèrent la
prégnance du clivage gauche-droite, mêlé aux divergences nationales et
institutionnelles.
Négociation
L'obtention du consensus serait même facilitée par l'examen
préalable des textes dans les groupes politiques, où ils font déjà
l'objet d'un compromis. À la différence des partis nationaux, maîtres
des investitures, les groupes européens n'ont pas les moyens d'exercer
une forte pression sur leurs membres. Les consignes de vote sont donc
le fruit d'une négociation, dont les députés seraient enclins à
respecter les conclusions dans la mesure où ils y participent.
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne changerait-elle la
donne ? L'accroissement des pouvoirs du Parlement européen donnerait au
"réflexe majoritaire" de nouvelles occasions de s'exprimer. C'est en
tout cas l'espoir des européistes, ravis de combler un "déficit
démocratique" au détriment des exécutifs. D'autres institutions, telles
la Commission et la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE),
ont au moins le mérite de veiller au respect réciproque des engagements
souscrits par les États. Or, aux yeux des gouvernements, que peut
représenter un rassemblement international de parlementaires, sinon un
pouvoir de nuisance ?
Nouveau statut
Le traité modificatif affecte le statut des députés, qui ne
seraient plus censés représenter les « peuples des États réunis dans la
Communauté », mais les « citoyens de l'Union ». Corolaire symbolique
des nouvelles modalités d'indemnisation appliquées dès juillet,
conformément à une décision remontant à septembre 2005.
« Jusqu'à présent, chaque eurodéputé était rémunéré par son
assemblée ou son gouvernement en fonction du salaire des députés
nationaux », explique Célia Sampol (3). « D'où les
grandes diversités existant entre un Bulgare qui gagnait à peine plus
de 9 000 euros par an, pendant qu'un Italien touchait 134 000 euros
annuels. Le nouveau statut met un terme à ces disparités et prévoit un
salaire mensuel égal pour tous de 7 412,69 euros avant impôts, soit 5
607,24 euros nets. Ce qui correspond à 38,5 % du traitement de base
d'un juge de la Cour de Justice européenne. Le financement des
rémunérations sera assuré par le budget de l'UE et non plus par les
budgets nationaux. »
Imbroglio
Les députés réélus cette année pourront conserver
définitivement leur indemnité nationale s'ils le souhaitent, de façon à
ne pas perdre au change... Quant aux États, ils pourront imposer le
statu quo à leurs élus pendant deux ans, craignant peut-être un
décalage avec la moyenne des rémunérations nationales.
Organisées sous l'égide du traité de Nice, les élections
européennes désigneront cette année 736 députés, Un nombre qui serait
porté à 750 plus le président avec l'application de Lisbonne... et même
754 dans une phase transitoire. Les sièges réservés aux Allemands étant
réduits de 99 à 96, il serait paraît-il délicat de renvoyer au pays les
trois élus en surnombre. Mais il faudra également désigner dix-huit
nouveaux députés, dont deux pour la France. On ignore encore par quel
"micmac institutionnel" sera résolu cet imbroglio juridique.
(1) Jean Quatremer : « Parlement européen :
des alliances politiques surprenantes » Coulisses
de Bruxelles, 22 mai 2008. (D'après les statistiques de
votewatch.eu)
(2) Paul Magnette : Le Régime politique de l'Union
européenne. Presses de Sciences Po, 310 pages, sept.2006, 15
euros.
(3) Europolitique, supplément au n°
3749, 8 mai 2009.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
4 juin 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Jérome Rivière voit trouble dans l'affaire du rosé coupé.
Dans un entretien audio diffusé par Novopress (20/05/09),
Jérôme Rivière, directeur de campagne de Libertas France, s'insurge
contre le projet de règlement européen autorisant la production de vin
rosé par coupage de blanc et de rouge : la Commission voudrait réviser
les pratiques œnologiques « pour que demain on puisse importer les vins
d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud ». Or,
selon le rapport du sénateur Gérard César, les vins coupés australiens seraient déjà sur le marché
européen, sans indication sur les étiquettes ! Étant donné l'intérêt du
dossier pour la campagne des souverainistes, une argumentation plus
rigoureuse aurait été la bienvenue.
Publié dans Europe, Souverainisme | Pas de commentaires
21 mai 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Union européenne doit produire du vin rosé par mélange de blanc et de rouge ; tel est le vœu de la Commission de Bruxelles. Un rapport parlementaire lève une partie du voile sur un "scandale" se révélant beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Explications.
Nouveau symbole des méfaits de la technocratie bruxelloise, le
projet de règlement européen levant l'interdiction de produire le rosé
de table par coupage de blanc et de rouge est une bénédiction pour les
souverainistes en campagne : 87 % des Français y seraient hostiles (1).
Poursuivant le décryptage de cette affaire, nous nous appuyons cette
fois-ci sur le rapport (2) de Gérard César, sénateur UMP de la Gironde.
Pour lui, il est essentiel « de soutenir le ministre de l'Agriculture
et de la Pêche, qui négocie ce dossier à Bruxelles [...] afin de faire
entendre la voix particulière de notre pays et de tenter d'y rallier
certains de nos partenaires européens lors du vote du texte le 19 juin
prochain ».
OCM vin
En avril 2008, un règlement avait lancé la réforme de
l'Organisation commune du marché vitivinicole (OCM vin). En
conséquence, à l'automne dernier, la Commission européenne a proposé
deux textes d'application, sur les règles d'étiquetage et les pratiques
œnologiques, discutés, respectivement, au sein d'un comité de gestion
et d'un comité de réglementation. Dans ce cadre, le 27 janvier, lors
d'un vote indicatif autorisant la consultation de l'OMC, « compte tenu
des réponses positives apportées à ses autres demandes » selon Gérard
César, la France s'est prononcée en faveur d'un "paquet" incluant la
mesure controversée.
Introduite en 1999, l'interdiction de produire du rosé par
coupage s'appliquait seulement aux vins de table. Cela « se justifiait
par l'existence de régimes d'aides distincts pour la distillation de
crise des vins de table rouges et des vins de table blancs. Le silence
des textes communautaires sur les vins autres que ceux de table
signifiait qu'il était licite d'utiliser la technique du coupage pour
les vins d'appellation, afin notamment de prendre en compte les
spécificités d'élaboration du champagne rosé et de certains vins
rouges. »
Un train de retard
La Commission avait-elle caché son jeu ? « Dès les premières
discussions préparatoires », elle avait « fait part de ses doutes sur
la justification du maintien de l'interdiction du coupage ». Celui-ci
devenait à ses yeux « une "discrimination négative" à l'encontre des
producteurs communautaires [...] alors que la pratique du mélange
rouge-blanc est utilisée aux États-Unis ou en Australie et que ces
produits sont déjà sur le marché européen, sans indication sur les
étiquettes ». Autrement dit, ce n'est pas la commercialisation – déjà
autorisée ! - du rosé coupé qui est en cause, mais sa fabrication sur
le territoire des vingt-sept États membres de l'Union européenne.
Ces restrictions étaient-elles préjudiciables aux viticulteurs français ? La faiblesse
des échanges internationaux sur le marché des vins rosés relativise
cette crainte : « Environ 10 % seulement de la production est
commercialisée entre pays. L'absence de normalisation internationale du
produit pourrait l'expliquer. Contrairement aux vins rouge ou blanc, le
rosé est largement consommé dans son pays ou sa région de production.
La concurrence se fait donc, pour l'instant du moins, davantage au sein
des pays producteurs qu'entre ceux-ci. » Dès lors, faut-il s'attendre à
ce que la demande en rosé coupé soit stimulée par l'émergence d'une
offre française ?
Quoi qu'il en soit, le recours au coupage présenterait trois
inconvénients selon le sénateur de la Gironde : un risque de
standardisation, les producteurs étant susceptibles de recourir aux
cépages blancs les plus répandus ; un risque d'édulcoration, avec la
tentation de corriger des excès de dureté par l'ajout de sucre ; un
risque de confusion dans l'esprit des consommateurs, confrontés à des
produits impossibles à différencier à l'œil nu. Gérard César imagine la
réaction d'un acheteur déçu par un rosé coupé : la crainte d'un déficit
d'image se dessine, affectant les producteurs de rosé traditionnel,
voire l'ensemble de la filière vitivinicole.
L'impasse multilatérale
Dans son ultime numéro, La Lettre de l'indépendance annonce
carrément « l'agonie des AOC ». Le rapport se veut plus nuancé : « Nul
ne peut anticiper aujourd'hui les conséquences économiques de
l'autorisation du vin rosé coupé sur la filière vitivinicole française,
mais ce sont peut-être les producteurs de vin rosé de table qui ont le
plus à craindre. [...] Les producteurs de vins rosés d'appellation
avaient la faculté [...] de recourir à la technique du coupage, mais
ils l'ont refusée dans leur cahier des charges. Compte tenu de la forte
fragmentation du marché du vin, certains observateurs optimistes
estiment que les vins rosés haut de gamme seront très faiblement
concurrencés par les vins rosés coupés à faible prix. »
Pressé par le temps, Bruxelles ne semble pas disposé à retirer
son texte. Or, « l'opposition au règlement sur les pratiques
œnologiques repose sur une alliance hétéroclite d'États membres que la
Commission européenne pourrait aisément briser en donnant satisfaction
aux revendications de certains pays pour isoler la France » (3). Et « si
d'aventure une minorité de blocage était réunie [...], il faudrait être
vigilant pour que les avancées qu'a obtenues le gouvernement lors des
négociations sur le nouveau règlement ne soient pas remises en cause ».
« Quant à une réglementation nouvelle au sein de l'OIV (4) (qui autorise
le coupage pour les vins) ou de l'OMC (qui interdit d'obliger les pays
tiers à indiquer sur leurs étiquettes si le vin rosé est issu de
coupage), elle est pour l'heure hors de portée. D'une part, la
modification des règles au sein de l'OIV nécessite le consensus des
États. D'autre part, les accords relatifs à la politique commerciale
communautaire doivent être conclus à la majorité qualifiée par le
Conseil "Affaires générales et Relations extérieures" (CAGRE). »
On le voit, « les marges de manœuvre du gouvernement sont très
faibles, tant au niveau communautaire qu'au niveau international ».
D'où l'intérêt des subtilités exposées ci-dessus : elles illustrent la
complexité des pratiques multilatérales, par ailleurs inintelligibles
pour le grand public. Voilà une affaire typiquement européenne.
(1) Selon un sondage Ifop pour Sud-Ouest Dimanche
et Midi Libre.
(2) N° 392, "annexe au procès-verbal de la séance du
6 mai 2009". Rapport de 32 pages disponible sur le site Internet du
Sénat.
(3) Avis aux connaisseurs : l'Allemagne et la Hongrie
n'apprécient pas la baisse du plafond autorisé de sulfites ; l'Italie
et la Grèce sont hostiles aux mesures relatives à la désalcoolisation.
(4) Organisation internationale de la vigne et du vin.
Publié dans Agriculture, Europe | Pas de commentaires
17 mai 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Rival des gouvernements représentés au Conseil des ministres, le Parlement européen apparaît également comme un relai potentiel d'influence nationale. Les députés français élus en juin prochain pourront-ils jouer un rôle à Strasbourg et Bruxelles ?

Simple assemblée consultative à l'origine, le Parlement
européen est devenu, aux côtés du Conseil des ministres et de la
Commission, un sommet incontournable du triangle institutionnel qui
pilote l'Union européenne. Investi d'une mission de contrôle, il
approuve la composition de la Commission et peut voter une motion de
censure à son encontre ; ses pouvoirs lui permettent d'amender ou
rejeter le budget européen ; il participe à l'élaboration de la
législation communautaire à différents degrés, dont le plus élevé – la
codécision – le place à égalité avec le Conseil.
Entre juin 2004 et février 2009, le Parlement européen a
statué « principalement dans les domaines de l'environnement et de la
protection des consommateurs, mais aussi du marché intérieur et de la
politique des transports » ; son accord fut sollicité pour 18 % des règlements et 71 % des directives adoptés par le Conseil durant
cette période, selon les observations d'Yves Bertoncini et Thierry
Chopin (1).
Motifs obscurs
Les déboires du "paquet télécom" ont illustré devant l'opinion
le "pouvoir de nuisance" acquis par cette assemblée : tandis que le
gouvernement français faisait voter la loi "Création et Internet" par
le parlement national, les députés au Parlement européen s'obstinaient,
contre l'avis du Conseil, à maintenir un amendement menaçant son
application. Le traité de Lisbonne multiplierait les occasions de jouer
un tel scénario. Les représentants des États membres l'ont pourtant
plébiscité ; quel intérêt avaient-ils à se dessaisir progressivement de
leurs monopoles ?
« Les raisons pour lesquels les gouvernements ont
"parlementarisé" l'Union restent en partie obscures » aux yeux de Paul
Magnette (2). « Sans doute certains gouvernements ont-ils été mus par des
calculs stratégiques », à l'exemple de l'Allemagne dont les députés
sont les plus nombreux. « D'autres gouvernements, nourrissant une
vieille méfiance à l'égard de la Commission, ont peut-être parié qu'en
renforçant le Parlement européen, ils affaibliraient à long terme le
collège des commissaires. » Mais ce choix relèverait aussi « d'une
forme de mimétisme institutionnel », ou plus simplement d'idéologie : «
Le formalisme qui irrigue les cadres mentaux du personnel politique
européen, conjugué au désir de répondre aux critiques du "déficit
démocratique" de l'Union, les conduit presque naturellement dans cette
voie. »
Néanmoins, « la tentation d'utiliser le Parlement européen
pour faire valoir des intérêts strictement nationaux » tendrait à se
renforcer depuis la fin des années quatre-vingt-dix : « Dans plusieurs
États membres, au Royaume-Uni et en Allemagne en particulier, les
partis de la majorité [...] tentent de faire de leurs élus à Strasbourg
les alliés du gouvernement. » À l'approche des élections européennes de
juin 2004, « le Premier ministre hongrois était allé jusqu'à proposer
que tous les partis hongrois forment une liste unique ». La même année,
le 29 avril, le président Chirac avait déploré que « l'influence de la
France au sein du Parlement européen » ne soit pas « à la hauteur des
enjeux pour notre pays » (3). Deux jours plus tard, l'UE allait
accueillir dix nouveaux États membres, diminuant d'autant le poids
relatif de la France, qui avait déjà perdu son second commissaire avec
le traité de Nice. Une réaction devenait d'autant plus pressante.
Le poids des groupes politiques
Au sein du Parlement européen, « les députés ont toujours
gardé leurs origines nationales à l'esprit, mais c'est à l'intérieur
des groupes partisans qu'ils ont formé leurs positions », si l'on en
croit Paul Magnette. Or, « la mise à disposition de moyens techniques
(collaborateurs, secrétariat, salle de réunion, budget pour des
publications, traductions) ainsi que le droit de parole et d'initiative
politique sont fonction de la taille du groupe » souligne Thierry
Chopin (4). « Il en va de même pour l'accession aux principaux postes de
responsabilités (vice-présidences et questure du Parlement européen,
présidences et vice-présidences des commissions et délégations,
rapporteurs et coordinateurs). » En conséquence, selon le directeur des
études de la Fondation Robert Schuman, « l'influence de la France se
mesure d'abord à la capacité de ses députés européens à se rassembler
au sein des groupes numériquement les plus importants, en particulier
le groupe PPE-DE, dominant depuis 1999, et le groupe socialiste ».
Coordination
Peu enclin à promouvoir l'hégémonie de ses collègues
pro-européens, Georges Berthu avait plaidé en mai 2004 pour une «
meilleure coordination des élus français sur les votes techniques, qui
est tout à fait possible, mais nécessiterait une meilleure organisation
au niveau français » ; il aurait même souhaité que les groupes
majoritaires acceptent « la formation en leur sein d'une composante non
fédéraliste » (5). Un vœu pieux : si l'on observe une moindre dispersion
des élus français au cours de la dernière législature, c'est en partie
en raison du nouveau mode de scrutin, divisant la France en huit
circonscriptions au détriment des petits partis, notamment
souverainistes. Yves Bertoncini observe avec satisfaction que la
majorité de nos députés (62,82 %) se concentrent au sein du PPE-DE et
du PSE : « Parmi les principaux États membres, [...] la France se place
ainsi en troisième position en termes de concentration après l'Espagne
et l'Allemagne [...]. En revanche, on note toujours une forte présence
française parmi les non-inscrits. »
Si la France se trouve mieux représentée aux postes
stratégiques, elle continue de reléguer les enjeux européens au second
plan. Tombée en disgrâce, Rachida Dati est envoyée à Strasbourg et
Bruxelles : c'est tout un symbole. « Les élections législatives
françaises de juin 2007 ont montré qu'un nombre non négligeable
d'eurodéputés français préféraient briguer un mandat national :
vingt-trois eurodéputés sur les soixante-dix-huit que compte la
délégation française avaient déposé leur candidature pour rejoindre
l'Assemblée nationale. » Avec Thierry Chopin, Yves Bertoncini précise
qu'« une douzaine de députés français élus en 2004 ont ainsi quitté le
Parlement européen depuis lors, contre seulement cinq parlementaires
allemands et cinq parlementaires anglais ».
Autre travers national : le cumul des mandats, pratiqué par
deux tiers des élus. Georges Berthu constate en outre que nos députés
sont « toujours un peu novices ». Les collaborateurs de la Fondation
Robert Schuman le confirment : « Le nombre moyen de mandats exercés par
un parlementaire européen allemand est ainsi de 2,4, contre seulement
1,6 pour la France [...] ; mieux, près de la moitié (48 %) des
actuels eurodéputés allemands en sont au moins à leur troisième mandat
à Strasbourg, alors que ce chiffre est de 18 % pour les eurodéputés
français [...]. Cette différence de longévité est encore plus frappante
s'agissant des eurodéputés appartenant aux deux groupes les plus
influents : la proportion de députés allemands ayant trois mandats ou
plus est ainsi de 53 % dans le groupe PPE-DE et de 78 % dans le groupe
PSE, contre respectivement 17 % et 13 % pour les députés français. »
Nouveau statut des députés
Les chiffres sont révélateurs, mais « les transformations
nécessaires renvoient également à des difficultés plus profondes, en
particulier le choix traditionnel d'une logique de puissance au
détriment d'une véritable politique d'influence. Peu habitué à user de
son soft power, notre pays gagnerait sans doute à faire primer le
pouvoir réel sur les enjeux symboliques. » Yves Bertoncini encourage la
France à développer « une véritable stratégie d'influence », sans
négliger le lobbying. Approuverait-il les propositions de Georges
Berthu ?
En 2004, celui-ci réclamait, entres autres, une meilleure
articulation du travail parlementaire national et européen : « Certains
pays ont [...] systématisé cette symbiose en logeant les uns et les
autres dans des immeubles voisins, voire communicants. À Paris, on en
est encore à des années-lumière. » Les velléités du gouvernement
nourrissaient alors le pessimisme du député MPF : « Encore faudrait-il
aussi que les pouvoirs publics français n'alimentent pas eux-mêmes la
tendance la plus fédéraliste en soutenant des projets aberrants, comme
celui de statut unifié des députés européens. Par ce texte, [...] les
députés européens ne recevraient plus leur rémunération principale de
leurs pays respectifs, mais seraient entièrement payés sur le budget
communautaire. Or "qui paye commande" ! Comment peut-on vouloir à la
fois l'aboutissement de cette réforme, et une reprise en mains de la
défense des intérêts français ? » Cinq ans plus tard, le projet est en
passe d'aboutir. Bien que sa portée nous semble avant tout symbolique,
cette réforme est effectivement symptomatique des ambiguïtés
caractérisant l'édification d'une "fédération d'États-nations".
(1) Yves Bertoncini & Thierry Chopin : « Les
"élections européennes" en France : un triple choix » Questions
d'Europe, n° 135, 27 avril 2009. Disponible sur
www.robert-schuman.org
(2) Paul Magnette : Le Régime politique de l'Union
européenne. Presses de Sciences Po, 310 pages, septembre
2006, 15 euros.
(3) Conférence de presse retranscrite sur le site Internet du
ministère des Affaires étrangères.
(4) Thierry Chopin : « L'influence française
au Parlement européen : bilan et perspectives - Quels enjeux à
l'horizon des élections européennes de 2009 ? » Questions
d'Europe, n° 119-120, 8 décembre 2008. Disponible sur
www.robert-schuman.org
(5) Georges Berthu : « Améliorer l'efficacité
française au Parlement européen » Note du 20 mai 2004 publiée
sur le site http://fondationdeservicepolitique.com
Publié dans Europe | Pas de commentaires
7 mai 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
À l'approche du scrutin du 7 juin, la campagne tarde à démarrer, y compris sur la Toile, où les "programmes politiques" ne sont pas légion. Aperçu des thématiques développées par l'Alliance royale, Debout la République, le Front national, Libertas, le MoDem, le PS et l'UMP.
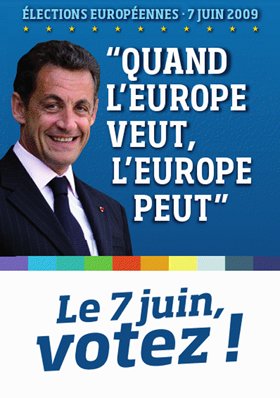
À six semaines des élections européennes, nous avons arpenté
la Toile à la recherche des "manifestes politiques" de quelques partis.
Certains sites de campagne reflètent le désintérêt suscité par
le scrutin : outre le nom de ses têtes de liste, le Front
national diffuse seulement quelques affiches. L'UMP publie des
actualités et met en valeur la "communauté" de ses sympathisants, sur
le modèle de Facebook, sans formaliser ses propositions, peut-être dans
l'attente d'un discours du président de la République ; les internautes
en quête d'un programme doivent se contenter d'un tract peu fourni, où
l'on remarque l'importance accordée à l'outre-mer.
Discours protectionnistes
L'heure n'est plus aux déclarations eurobéates. Certes, le PS
entretient le mythe selon lequel la construction européenne aurait «
garanti la paix » ; et le MoDem s'illusionne en croyant pouvoir
renverser la situation où, « depuis des années, chaque pays essaie de
marquer des points contre les autres ». Confrontés à la crise
économique, les partis préfèrent accompagner le retour médiatique du
politique. Dans la continuité du « succès de la présidence française de
l'Union », l'UMP martèle ce slogan : « Quand l'Europe veut, l'Europe
peut. » Réunis sous la bannière de Libertas, le MPF et CPNT exploitent
une thématique similaire : « Prenons l'Europe en main. »
Des appels de pied au protectionnisme sont lancés de toutes
parts : l'UMP nous encourage à voter « pour une Europe qui nous protège
» ; selon les socialistes, « le débat n'est pas tant de savoir si
nous serions des partisans ou des adversaires du
protectionnisme, mais bien de déterminer quels intérêts nous souhaitons
protéger ». La hantise du dumping illustre la nécessité d'une
harmonisation des fiscalités européennes aux yeux du PS et du MoDem.
Reste à convaincre nos partenaires, dans un domaine où l'unanimité
demeurerait la règle malgré l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Le PS s'indigne d'« un budget européen réduit à moins de 1 %
de la richesse produite en Europe » ; le MoDem lui fait écho, proposant
« un budget européen dont le volume serait décidé par le Parlement
européen et alimenté par un impôt unique sur l'ensemble des pays de
l'Union ». Autre suggestion du parti centriste : la nomination d'« un
procureur européen avec autorité sur les polices ». De retour au
pouvoir, ces fédéralistes se montreront-ils aussi disposés à dépouiller
l'État de ses prérogatives ?
L'Alliance royale plébiscite la création de deux commissariats
européens, « pour la coordination de la sécurité des pays européens »
d'une part, « pour l'environnement et la sécurité sanitaire » d'autre
part. Quels rapports entretiendraient-ils avec les directions générales
de la Commission, le Centre de suivi et d'information en charge de la
protection civile, l'Agence européenne pour l'Environnement ? On
l'ignore, mais ces propositions témoignent de la volonté largement partagée d'envisager
l'Europe indépendamment du marché unique. François Bayrou souhaiterait
que « l'exigence sociale, démocratique et écologique soit placée au
même niveau que la concurrence ». Pourquoi pas au-dessus ? De toute
façon, la concurrence n'est qu'un instrument censé servir la
prospérité, dont l'efficacité inspire une circonspection stimulée par
la crise.
Le PS feint d'offrir à l'Europe « le droit à l'alternance » :
« Il y a aujourd'hui la possibilité de donner sa place à la politique
au cœur de l'Europe et d'assumer jusqu'au bout le clivage avec la
droite en faisant échec à une candidature Barroso et, nous le
souhaitons, en ayant un candidat commun issu du PSE pour la présidence
de la Commission. » C'est mal parti. D'autant qu'en dépit de leur
affiliation à gauche, les gouvernements britannique, espagnol et
portugais devraient appuyer la reconduction de José Manuel Barroso.
Vœu pieux
Autre vœu pieux : la constitution d'« une Europe forte avec
une vraie défense européenne ». Cela « n'est pas aujourd'hui crédible »
rétorque l'Alliance royale. Prenant le risque de froisser ses
sympathisants, celle-ci considère même « que la France doit se
maintenir dans l'Otan, [...] la seule organisation militaire capable de
répondre aux besoins de sécurité dans nos zones d'intérêts stratégiques
». Debout la République prétend qu'« avec le traité de Lisbonne
(article 27-7), la France n'aurait pas pu faire entendre sa voix sur la
guerre en Irak ». Le texte incriminé - qui n'est pas stricto sensu un
article du traité de Lisbonne - introduit une clause de défense
mutuelle et rappelle la compatibilité des politiques de l'UE avec les
engagements souscrits dans le cadre de l'Otan. Or cela n'est pas
nouveau et ne concerne pas directement l'intervention en Irak, décidée
en dehors des structures atlantiques.
Tandis que le Front national fait passer « ma retraite, ma
famille, mon emploi... avant l'Europe », d'autres souverainistes ont
adopté une posture plus nuancée, "eurocompatible" selon l'expression du
"sécessionniste" Reinelde Maes (afe-blog.com, 26/04/09) : « Osons une
Europe différente » lance Nicolas Dupont-Aignan ; c'est « une dimension
nécessaire de notre avenir » confirme Libertas. Tout en revendiquant sa
« prudence » à l'égard de la construction européenne, l'Alliance royale
observe que « certains secteurs industriels ont [...] besoin d'une
masse critique suffisante pour être concurrentiels dans un contexte de
mondialisation : aéronautique, espace, défense, énergie, pharmacie,
etc. » Selon l'AR, l'Europe est « une zone relativement homogène en
matière stratégique. Beaucoup d'enjeux concernant la France [...] sont
aussi en même temps européens : terrorisme, accès aux ressources
d'énergie, sécurité maritime, etc. »
L'Alliance royale esquisse « un aménagement de ce qui existe
déjà : un conseil européen représentant les États, une assemblée, des
commissions exécutives et des instances juridictionnelles, chacune
agissant dans le strict cadre des coopérations auxquelles les États
membres auront bien voulu souscrire ». Exit la « Grosse Kommission »
fustigée régulièrement par Les Manants du Roi, éclatée en diverses
entités. L'AR plébiscite une communauté où « nul État européen ne peut
être contraint d'appliquer des directives ou des lois européennes sur
son territoire s'il ne les a pas lui-même ratifiées. Nulle institution
européenne ne peut exercer de coercition de droit sur les États membres
en dehors de traités librement et préalablement consentis par eux. »
Qu'adviendrait-il du droit communautaire dérivé ? L'Alliance laisse
planer une certaine ambiguïté. Elle se préoccupe en tout cas de la
réversibilité des engagements : de son point de vue, « l'adoption de la
monnaie unique apparaît comme imprudente, non pas nécessairement pour
ses conséquences économiques, mais parce qu'elle lie la France de façon
trop forte ».
Référendum
Imaginant eux aussi un nouveau traité, les gaullistes de DLR
voudraient qu'il soit « approuvé par référendum le même jour dans tous
les pays de l'Union ». On mesure l'irréalisme de la proposition à la
vue du laborieux processus de ratification du traité de Lisbonne. Cela
supposerait en outre de chambouler des traditions, voire des
dispositions constitutionnelles, puisque la Loi fondamentale allemande
circonscrit l'usage du référendum à la réorganisation du territoire
fédéral. Maladroitement, Nicolas Dupont-Aignan en vient à promouvoir «
l'uniformisation » qu'il dénonce ! L'"identité" est d'ailleurs un thème
jugé porteur, y compris par le MoDem : « Nous défendrons l'Europe qui
garantit les identités, les modes de vie, les langues et les cultures
sur son sol et dans le monde. » Mais les développeurs de Libertas ont
négligé la traduction des termes anglais apparaissant sur la version
imprimable de chaque page du site Internet ; un comble !
Ne négligeons pas la France !
« Les querelles institutionnelles ne sont plus de saison »
affirme le PS, « car l'ordre du jour de la nouvelle administration est
économique et social. Le traité de Lisbonne est une donnée, mais ne
saurait borner l'ambition des socialistes pour l'Europe. » Ni celle des
autres ! Or, « pour réorienter l'Europe », faut-il « d'abord envoyer au
parlement de Strasbourg une majorité de députés de gauche » ou d'une
quelconque sensibilité ? Cela n'a rien d'évident, car l'UE n'est pas
émancipée de l'influence des exécutifs nationaux. Le MoDem s'en
offusque implicitement en voulant changer une situation où « les
gouvernants de notre pays et les dirigeants européens préparent toutes
les décisions entre eux, dans le secret ». Beaucoup dépend de nous.
C'est pourquoi « l'Alliance royale estime qu'une coopération à
l'échelle de l'Europe n'est possible que par le renforcement des
institutions françaises ». Qu'elle suscite espoirs ou inquiétudes,
l'Union européenne reflète à bien des égard nos propres ambitions, nos
propres frustrations. Ne négligeons pas la France !
Publié dans Europe, France | Pas de commentaires
5 février 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Comment l'UE encadre-t-elle la taxe sur la valeur ajoutée ?
La taux de TVA dans la restauration passera-t-il bientôt, en
France, de 19,6 à 5,5 % ? Jacques Chirac s'y était engagé en 2002.
Renouvelant cette promesse, Nicolas Sarkozy se heurte lui aussi à
l'opposition de l'Allemagne. Le 20 janvier, lors du conseil Ecofin
(réunion des ministres des Finances de l'UE), celle-ci a assoupli sa
position. Berlin craignait jusqu'à présent d'alimenter les
revendications de ses propres ressortissants en donnant son feu vert.
Or, la TVA est encadrée par le droit européen, dont la
modification requiert l'unanimité des États membres en matière de
fiscalité. Érigée parfois en garantie suprême de notre indépendance,
cette exigence apparaît ici comme un frein aux initiatives du
gouvernement, qui ne se risquera pas à enfreindre pour si peu les
règles d'une "partie" se jouant à vingt-sept. Paradoxe inhérent à
l'intégration européenne !
Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est régi par
une directive du 28 novembre 2006. Ce texte impose jusqu'au 31
décembre 2010 un taux standard minimum de 15 %. Il autorise en
outre la fixation d'un ou deux taux réduits de 5 % minimum,
dont il restreint toutefois l'application à quelques livraisons de
biens et prestations de services clairement identifiés (les services de
restauration n'en font pas partie). Ainsi, chaque État demeure libre de
fixer un taux standard et un taux réduit, mais non de définir les
domaines où s'appliquent l'un ou l'autre.
Par ce biais, les gouvernements européens entendaient
vraisemblablement se prémunir d'un risque de "distorsion de
concurrence" . Dans cette affaire, celui-ci est pourtant loin d'être
évident : d'un bout à l'autre de l'Europe, les restaurateurs
ne se disputent pas les mêmes clients ; quant au tourisme, s'en
trouve-t-il vraiment affecté ?
Publié dans Europe | Pas de commentaires
15 janvier 2009
Article publié dans L'Action Française 2000
Quelques faux pas auront suffi aux Tchèques pour que fusent les anathèmes... Retour sur la situation intérieure du pays et son incidence sur les dossiers qu'il aura à traiter en assurant pendant six mois la présidence de l'Union européenne.
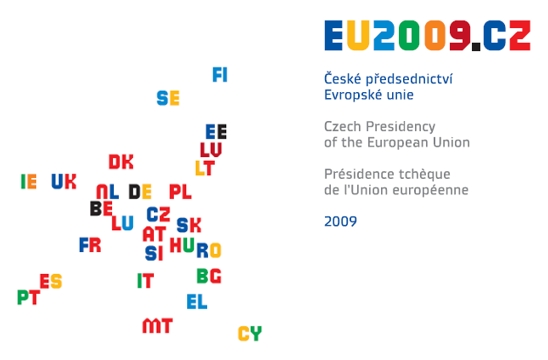
À la tête de l'UE depuis le 1er janvier, la République tchèque
a commis quelques impairs. Le 3 janvier, alors que les troupes
israéliennes venaient de pénétrer à Gaza, Jiri Frantisek Potusnik,
porte-parole du Premier ministre Mirek Topolanek, jugeait l'opération «
plus défensive qu'offensive ». « La déclaration a fait immédiatement le
tour du monde », déplore Jean Quatremer, « CNN et BBC world service
concluant à juste titre que l'Union européenne soutenait implicitement
Israël ». Rectifiant le tir, le chef de la diplomatie tchèque, Karel
Schwartzenberg, a expliqué qu'« il s'agissait d'une erreur personnelle
» : « Cela arrive à tout le monde, cela m'est arrivé aussi quand
j'étais jeune. » Un second faux pas est survenu le 8 janvier : dans un
communiqué annonçant le dénouement partiel de la crise gazière,
Vladimir Poutine était désigné comme président et non Premier ministre
russe. Comble de maladresse, le texte ne fut corrigé que partiellement
avant sa deuxième diffusion !
Traité en sursis
Cet "amateurisme" rend d'autant plus pressante la ratification
du traité de Lisbonne aux yeux de ses promoteurs, désireux d'en finir
avec la présidence tournante du Conseil européen. Mais le Parti civique
démocrate (ODS, droite libérale), qui dispose d'une fragile majorité,
est loin de partager leur impatience. Jan Zahradil, chef de sa
délégation au sein du groupe PPE-DE du Parlement européen, affirme que
ni son gouvernement ni son parti ne veulent bloquer le traité. « Mais
cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont satisfaits de l'ensemble.
Personnellement, je ne suis pas un supporteur du traité. [...] Je ne
crois pas qu'attribuer plus de pouvoir au Parlement soit une bonne
idée. [...] Il est évident que les tentatives de créer une sorte
d'opinion publique ou de conscience paneuropéenne ont été jusqu'à
présent sans succès. » Complétant cette observation de bon sens, il
reproche au traité de favoriser les grands pays, notamment l'Allemagne
et la France, qui deviendraient selon lui « beaucoup plus influents
dans le processus de décision de l'Union ». L'atlantisme prôné par
l'ODS viserait donc à équilibrer « les ambitions grandissantes de l'UE
». Plus enthousiaste à l'égard de celle-ci, l'opposition dénonce un
chantage : en échange de Lisbonne, l'ODS tenterait d'arracher le vote
d'un traité autorisant le déploiement d'un radar antimissile américain.
Les sociaux-démocrates sont d'autant moins disposés à céder qu'ils
espèrent un abandon du projet par le nouvel hôte de la Maison Blanche.
Prague souhaiterait d'ailleurs recevoir Barack Obama pour sa première
visite présidentielle en Europe.
Le processus de ratification pourrait se heurter également à
l'hostilité du président Vaclav Klaus. Bien que la République tchèque
soit un régime parlementaire, sa signature est indispensable. Il
refusera vraisemblablement de l'apposer tant que l'Irlande ne lui aura
pas montré l'exemple. Rien d'étonnant de sa part : en juin 2003, lors
du référendum sur l'adhésion à l'UE, il n'avait donné aucune consigne
de vote ; depuis, il a banni le drapeau européen du château
présidentiel ; le 11 novembre dernier, il avait profité d'une
visite officielle à Dublin pour dîner en compagnie de Declan Ganley,
"héros" du "non" irlandais.
Eurosceptiques
Ce soir-là, il s'était retrouvé à la même table que Philippe
de Villiers. L'euroscepticisme tchèque diffère toutefois de son
homologue français : il touche davantage les responsables politiques,
et ne se nourrit guère de la peur du "plombier polonais". Bien au
contraire : selon Marion Van Renterghem, Vaclav Klaus s'inscrirait dans
le sillage des monétaristes. Les conceptions libérales qui priment dans
son pays pourraient avoir une incidence sur les dossiers européens. La
présidence tchèque ne s'est-elle pas donné pour devise « une Europe
sans barrière » ?
Libéralisme
Elle espère lever les restrictions à la libre-circulation des
travailleurs, en obtenant au Conseil européen des 19 et 20 mars, sinon
la suppression, au moins l'atténuation des "mesures transitoires"
protégeant quinze États membres au détriment des derniers adhérents.
Elle entend promouvoir le libre-échange, par la relance du cycle de
Doha ou l'abolition des barrières commerciales transatlantiques. La
République tchèque accueille avec réserve la perspective d'un
encadrement accru du secteur des télécommunications, refusant par
exemple que soit plafonné le tarif de certains services téléphoniques.
Enfin, c'est elle qui devra boucler les négociations avec la Commission
et le Parlement sur le "troisième paquet" de libéralisation du marché
de l'énergie.
Deux sujets connexes figurent parmi ses dossiers les plus
importants : la préparation de la prochaine conférence des Nations
Unies sur le changement climatique, qui se tiendra à Copenhague du 7 au
18 décembre, et la sécurité des approvisionnements énergétiques. Enclin
à promouvoir le nucléaire, le gouvernement tchèque devra compter avec
la pression des Verts... Satanée démocratie !
Parmi les grands rendez-vous du semestre : le sommet du
"Partenariat oriental" au printemps ; celui du G20 le 2 avril, censé
lutter contre une crise financière à laquelle la République tchèque se
montre peu sensible ; celui du soixantième anniversaire de l'OTAN le
lendemain. D'ici le 1er juillet, on suivra également les négociations
visant à accélérer l'intégration des Balkans à l'UE : c'est une
priorité pour Prague, qui escompte, entre autres, la résolution d'un
conflit territorial ayant conduit la Slovénie à freiner le processus
d'adhésion de la Croatie.
Séduits par le volontarisme de Nicolas Sarkozy, exaspérés par
la "grande gueule" de Vaclav Klaus, nos confrères attendront les
Tchèques au tournant...
Sources :
- Dictionnaire critique de l'Union européenne.
Armand Collin, octobre 2008, 493 pages, 39,50 euros.
- Europolitique. Numéro 3665,
« Présidence tchèque de l'UE : un relai difficile ».
24 décembre 2008, disponible sur www.europolitique.info
- Jean Quatremer : « Amateurisme
tchèque » ; « La présidence tchèque bouge enfin et
regaffe... ». Coulisses de Bruxelles
(bruxelles.blogs.liberation.fr), 4 et 9 janvier 2008.
- Marion Van Renterghem : « Vaclav Klaus,
le mouton noir de l'Europe ». Le Monde,
4 janvier 2008.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
20 novembre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Europe présentée à travers 236 notes synthétiques.
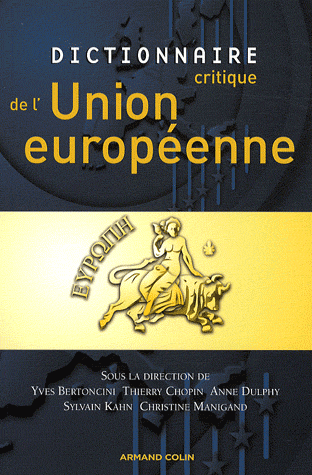
Les éditions Armand Colin ont publié le mois dernier un Dictionnaire
critique de l'Union européenne dont la lecture distille
mises au point historiques (voire historiographiques), juridiques
(arrêts déterminants de la Cour de Justice), politiques (présentation
des mouvements "pro-européens") ou théoriques (analyse fonctionnaliste
ou intergouvernementaliste de l'intégration européenne), ainsi que
quelques chiffres significatifs : par exemple, selon l'estimation
d'Yves Bertoncini, le droit communautaire dérivé représenterait 10 à 20 % de l'ensemble du droit en vigueur en France.
Au fil des 493 pages, écrites selon "l'esprit du temps", on
pourra discuter certains jugements, mais le caractère "universitaire"
de l'ouvrage le préserve des inepties politiciennes les plus désolantes
; l'article consacré au souverainisme, présenté par Justine Lacroix
comme « une identification de la nation à la démocratie » - plus
généralement au politique, diraient les souverainistes d'AF - témoigne
d'une relative impartialité.
Inévitablement, on sera frustré par les questions laissées
apparemment en suspens, comme le bilan économique du marché commun ou
les enjeux géopolitiques de la candidature d'Ankara... Ces 236 notes
synthétiques, complétées par des cartes et une chronologie, apportent
néanmoins un éclairage appréciable sur différentes facettes de l'UE,
faisant de ce dictionnaire un compagnon utile – quoique un peu coûteux
(39,50 euros) - au profane décidé à se documenter peu à peu sur le
"machin" européen.
Publié dans Europe, Livres | Pas de commentaires
2 octobre 2008
Article publié dans L'Action Française 2000
De Daniel Cohn-Bendit à Hubert Védrine, vingt et une personnalités s'expriment sur la construction européenne.
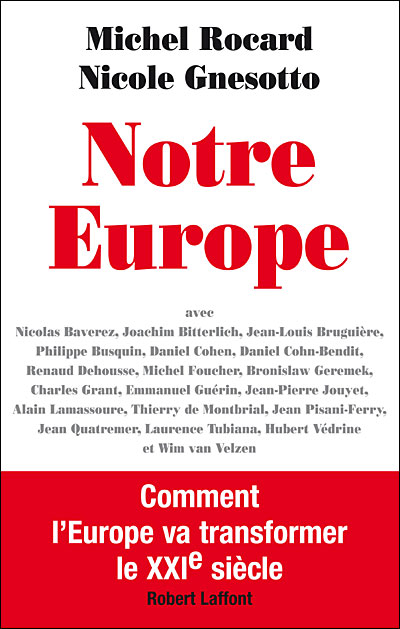
Un ouvrage paru en septembre, dirigé par Michel Rocard et
Nicole Gnesotto, rassemble les contributions de personnalités
éclectiques censées « rendre à Bruxelles ce qui revient à Bruxelles »
et « appréhender la construction européenne [...] comme une réalité
vivante ».
"Réalisme"
On y relève moult banalités. Ainsi Michel Rocard affirme-t-il
que « l'édification d'une institution commune [...] a comme résultat
majeur la réconciliation et la paix ». Une ineptie à laquelle Hubert
Védrine apporte un démenti cinglant : « Ce n'est pas
l'intégration de l'Europe de l'Ouest qui va l'empêcher [la guerre],
mais l'équilibre des forces [...] de l'OTAN et du Pacte de Varsovie...
»
Fidèle à son "réalisme", constatant la difficulté de conclure
un accord à vingt-sept, l'ancien ministre des Affaires étrangères
estime qu'on arrive « au point ultime de l'intégration politique pour
l'Europe dans son ensemble ». Il ne cache pas son relatif
euroscepticisme : s'appuyant sur des textes juridiques, « certains ont
attendu la naissance presque miraculeuse d'une politique étrangère
européenne. [...] Mais on le voit bien : cela ne conduira pas à une
politique étrangère européenne unique... » Appelant les Européens à «
dépasser l'irrealpolitik », caractérisée par « une fatigue historique
[...], une aspiration helvétique à une grande Suisse à l'abri des
turbulences de la mondialisation » - y compris chez certains
nationalistes, serions-nous tentés d'ajouter ! -, il plaide pour
l'autonomisation progressive des Européens au sein d'un pôle
occidental. Il se démarque ainsi de l'"esbroufe gaulliste" stigmatisée
implicitement par Thierry de Montbrial, et se montre bienveillant à
l'égard du président de la République, dont la politique pourrait être,
selon lui, le levier de cette transformation. Affaire à suivre.
Ultimes frontières
Dans l'immédiat, Michel Foucher lève le voile sur un « secret
de polichinelle », celui des frontières ultimes de l'UE : « Dans le
scénario d'expansion au fil de l'eau que Washington nourrit, celui qui
a effectivement cours, l'Union devra s'étendre à l'ensemble des États
membres du Conseil de l'Europe, à la seule exception de la Russie, mais
la Turquie incluse. » Dans ces conditions, sans identité
forte, quid de l'Europe politique ? Loin d'en entretenir l'illusion, la
plupart des auteurs parient plutôt sur la puissance de l'"empire
normatif". Renaud Dehousse en révèle une vision plus "morale" que
politique : il salue cette Europe ayant « dépassé le stade primitif où
les rapports entre États sont avant tout des rapports de force ».
Quitte à s'intéresser aux critiques de la realpolitik,
on préférera les analyses de Zaki Laïdi, beaucoup plus fouillées.
Jean Quatremer prétend briser un mythe, celui des 60 % de lois
d'émanation communautaire. « Le raisonnement en termes de pourcentage
est délicat, observe-t-il : le droit ne se prête guère à ce genre de
pesée. » Se livrant à son propre calcul, il estime néanmoins que ce
sont « seulement 25 % des lois adoptées en 2007 qui étaient d'origine
européenne ». De son point de vue, « tout ne se décide pas à Bruxelles,
[...] loin s'en faut ». Le sujet – controversé – aurait mérité de plus
amples développements. Le journaliste se veut catégorique : « Les États
sont non seulement à l'origine des traités par lesquels ils décident
d'exercer en commun leur souveraineté, mais ils en contrôlent à chaque
instant l'application. Ils sont aux deux bouts de la chaîne et décident
donc toujours en dernier ressort. » C'est oublier l'influence de la
Cour de Luxembourg, dont Renaud Dehousse rappelle que les juges « loin
de s'en tenir à l'intention [...] des parties contractantes [...], se
sont abondamment inspirés des objectifs ultimes de l'intégration,
énoncés de façon générale dans le préambule du traité de Rome ».
Le pragmatisme de Jean-Louis Bruguière tranche avec
l'idéologie inspirant bien des contributions. Tout en promouvant le
mandat d'arrêt européen, il s'insurge contre certaines dérives : « Une
coopération bien gérée est un facteur d'efficacité. Mais vouloir aller
trop vite ou négliger, dans une démarche politique ou doctrinaire, des
réalités opérationnelles peut avoir l'effet inverse de celui recherché.
C'est ce qui se passe [...] avec les tentatives d'intégration du
renseignement. Celui-ci ne se partage que dans une situation donnée et
dans une démarche bilatérale... »
Basses attaques
Daniel Cohn-Bendit se distingue par une intervention rédigée
sur un ton plus "politicien", où il attaque notamment le souverainisme
: une « nécrose », dont les « poussées xénophobes » ne seraient pas «
les moindres dégâts » ; par-delà la basse polémique, on relève cette
observation de bon sens : « La souveraineté demeure une
coquille vide sans l'efficience de l'action politique. »
Au final, on s'interroge sur le public auquel s'adresse un tel
ouvrage. Parfois rébarbatif et redondant, il ne présente pas de "vertus
pédagogiques" manifestes, véhicule des lieux communs sans franchement
ouvrir le débat, et présente des analyses trop superficielles pour
satisfaire un lecteur averti. On y trouvera éventuellement
une introduction à d'autres études traitant plus spécifiquement de tel
ou tel aspect de la construction européenne, à lire avec un regard
critique.
Sous la direction de Michel Rocard et Nicole Gnesotto : Notre
Europe ; Robert Laffont, 394 p., 22 euros.
Publié dans Europe, Livres | Pas de commentaires