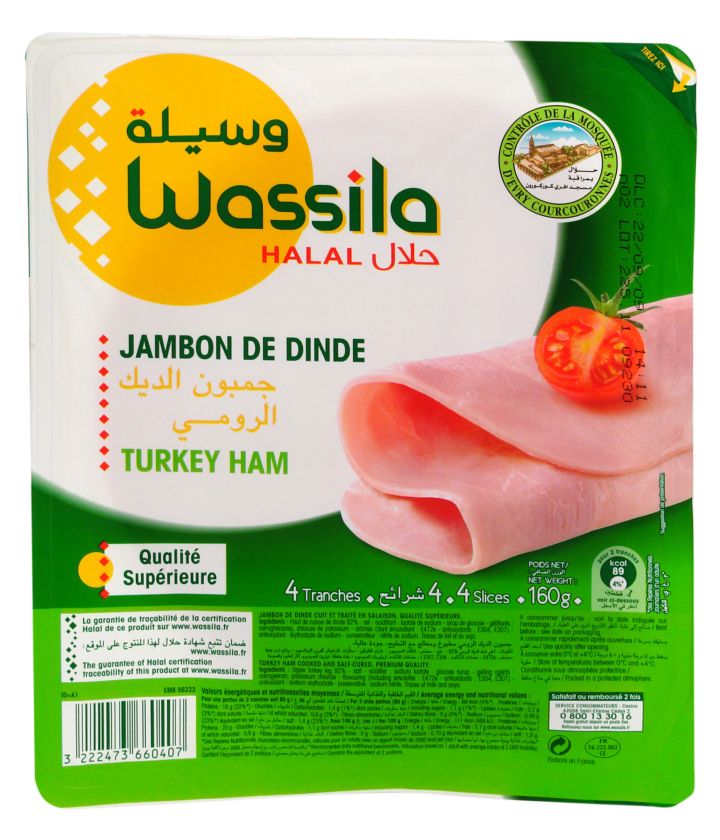22 janvier 2010
Vers une nouvelle formation du Conseil de l'UE ?

Le 3 février prochain se tiendra à Cadix, en Espagne,
une « réunion informelle des femmes ministres en
exercice » de l'Union européenne. L'événement est annoncé très
sérieusement par
le secrétariat général du Conseil, sans autre détail au
demeurant.
Mise à jour le 26 janvier - La
présidence espagnole apporte quelques précisions :
« La [sic] ministre de l'Égalité présidera aux côtés de la
première vice-présidente [sic] du gouvernement, à Cadix (11 heures), le
sommet européen des femmes au pouvoir, une initiative à laquelle
participeront les ministres et représentantes politiques des plus
hautes sphères des divers États membres. Une déclaration politique sera
adoptée lors de ce sommet. » Nous ne manquerons pas d'en rendre compte.
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaire | Lien permanent
21 janvier 2010
Jean-Pierre Raffarin défend l'usage du français dans les
institutions européennes.

Jean-Pierre Raffarin s'est rendu à Bruxelles le
14 janvier, où il a rencontré les présidents du Conseil
européen, de la Commission et du Parlement. « En qualité de
"représentant personnel du président de la République" », il
entendait défendre auprès d'eux l'usage du français dans les
institutions européennes.
« Le français ne recule que lorsque l'offre de
français est insuffisante », proclame
l'ancien Premier ministre. « Quand, dans une ville
du monde, on ouvre une école française, les capacités d'accueil sont
immédiatement saturées. Quand dans une institution on fragilise le
français, ce sont les valeurs du pluralisme et de l'humanisme qui sont
étouffées. » Et de lancer : « Pour le combat
du français et de la francophonie, j'ai l'âme résistante, l'âme
québécoise ! »
Les discussions ont porté sur l'amélioration de la
signalétique du Parlement européen, la valorisation des travaux du
forum des députés francophones, la célébration par l'Union de la
journée internationale de la Francophonie le 20 mars, la
formation au français des responsables européens...
Au cours de son déplacement, Jean-Pierre Raffarin s'est
entretenu avec des journalistes « extrêmement las de constater
le déclin du français dans les salles de presse de l'Europe ».
Tel
Jean Quatremer, qui fustigea encore tout récemment la
présidence espagnole du Conseil, coupable de proposer
des traductions uniquement vers l'anglais : « Rien pour
le français, rien pour l'allemand pourtant les deux autres langues de
travail de l'Union. » Son
confrère Nicolas Gros-Verheyde élève lui aussi des
protestations : « On savait déjà que toutes les
missions de l'Europe de la défense communiquaient essentiellement en
anglais. Maintenant, c'est un fait avéré : elles communiquent
uniquement en anglais, que ce soit sur leurs sites Internet ou [dans]
leurs communiqués à la presse. Il en est de même pour les agences.
[...] Catherine Ashton a, elle, adopté le monolinguisme universel et se
fait un devoir de ne pas parler d'autre langue [que l'anglais]. Mieux.
Pour l'action européenne sur le séisme en Haïti, la majorité de la
communication s'est faite, jusqu'ici, en anglais (un comble pour un
pays francophone). » « C'est vrai que cela permet de
douter du degré de sensibilité et de finesse de la prochaine diplomatie
européenne », commente l'ancien Premier ministre...
Selon lui, « la francophonie doit, sans doute, entrer
dans une nouvelle phase de son action ». « Il faut se
montrer plus intransigeant », affirme-t-il encore sur
son blog. À la demande du chef de l'État, il a entamé une
tournée des organisations internationales pour y défendre l'usage du
français. Prochaine étape : New York, où il
rencontrera les représentants des Nations Unies début février.
Souhaitons-lui bon voyage !
Publié dans Europe, Francophonie | 1 commentaire | Lien permanent
21 janvier 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
La Bibliothèque nationale de France doit-elle collaborer avec
Google ? Aperçu des conclusions de la mission Teissier.

La commission sur la numérisation des fonds patrimoniaux des
bibliothèques a remis son rapport le 12 janvier. Présidée par
Marc Teissier, elle était censée évaluer « la pertinence d'un
accord entre la BNF et Google du triple point de vue du partage et du
rayonnement des contenus français sur Internet, de l'intérêt économique
et financier pour l'État et le contribuable, du message politique à
adresser à la communauté internationale ». Une question
devenue en partie caduque depuis l'annonce par le président de la
République, dans les priorités du "Grand emprunt", d'une enveloppe
spécifique pour la numérisation du patrimoine culturel
(750 millions d'euros). La mission se félicite d'un changement
« considérable » permettant « d'envisager
une politique de numérisation [...] à la fois ambitieuse et
autonome ».
Le géant américain de l'internet s'est lancé en 2004 dans un
projet visant à numériser 15 millions d'ouvrages en dix ans.
Le rapport fustige les clauses souscrites par les bibliothèques
partenaires, parmi lesquelles figure la bibliothèque municipale de
Lyon : « Les accords passés par Google prévoient
toujours que les autres moteurs de recherche ne pourront pas accéder
aux fichiers numérisés par lui pour les indexer et les référencer.
[...] Cela revient [...] à permettre à un acteur [...] de renforcer
cette position dominante. [...] La durée des clauses d'exclusivité est
également excessive : des durées de plus de vingt ans [...]
peuvent aller à l'encontre de la mission d'accès impartie aux
bibliothèques. » Cependant, toute forme de partenariat ne
serait pas à exclure : « Un accord avec Google [...]
pourrait viser, non pas à faire prendre en charge l'effort de
numérisation mais à le partager, en échangeant des fichiers de qualité
équivalente et de formats compatibles. »
Deux objectifs généraux sont définis : d'une part,
« éviter le risque d'une segmentation du patrimoine, en se
donnant l'ambition d'une numérisation exhaustive, ou en tout cas la
plus large possible » ; d'autre part, réaffirmer
« la place du patrimoine français écrit sur
l'internet », qui « est aujourd'hui principalement
visible via Google Livres, grâce aux fonds francophones numérisés des
bibliothèques étrangères, qui ne sont pas complets ».
La bibliothèque numérique Gallica, développée jusqu'à
maintenant par la BNF, serait l'instrument naturel de cette politique.
Forte d'une autonomie renforcée, elle pourrait réunir « les
bibliothèques publiques patrimoniales et les éditeurs, dans une logique
de partenariat public-privé » et proposer un accès
« à tout le patrimoine écrit, via une plate-forme coopérative
respectueuse des droits des différents partenaires, les conditions
d'accès étant adaptées au statut de chaque œuvre ».
Le rapport promeut « la relance d'une impulsion
européenne, tant en direction des autres bibliothèques européennes que
du portail Europeana ». En revanche, ses auteurs ne
semblent pas avoir examiné l'opportunité d'une coopération dans le
cadre de la francophonie.
Leurs conclusions ont été accueillies avec
bienveillance par le ministre de la Culture, tout disposé à "rebooster"
Gallica. Lequel gagnerait d'abord à être mieux connu. Comme le souligne
la mission, « les efforts de numérisation doivent
s'accompagner d'une volonté de conquête de visibilité sur le
web ».
Publié dans Internet | Pas de commentaire | Lien permanent
21 janvier 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Quand le gouvernement français réaffirme sa foi dans les
vertus du marché unique européen.

L'UE travaille activement à l'élaboration de sa "stratégie"
pour les dix ans à venir. Le Conseil européen devrait l'adopter
définitivement en juin prochain. D'ici-là, les discussions iront bon
train. La France a défini sa position dans un document rendu public par
Euractiv le 18 janvier. Le gouvernement y
réaffirme sa foi dans les vertus du marché unique. Aussi prône-t-il une
mobilité accrue des étudiants, des enseignants, des travailleurs... Il
réclame également « une action vigilante pour assurer une
application uniforme effective des règles existantes », voire
« un recours accru au règlement [...] pour assurer une
application vraiment uniforme » (à la différence des
directives, les règlements s'appliquent sans transposition).
Parallèlement, la France propose que soit renforcée
« la dimension sociale du marché intérieur, y compris par la
voie de l'harmonisation législative » : « Il
est en particulier fondamental de garantir les conditions d'une
concurrence équitable [...], notamment par une plus grande coordination
dans le domaine fiscal et social. »
Paris entend reposer « la question de l'accès des PME
aux marchés publics ». De son point de vue, « seule
la politique commerciale commune peut agir en faveur de nos entreprises
pour ouvrir les marchés des pays tiers », mais aussi
« assurer [...] un plein respect du principe de
réciprocité ». Trop souvent, en effet, « les
Européens tolèrent des situations de fermeture de droit ou de fait
comme nous le voyons par exemple en ce qui concerne les marchés publics
dans certains États tiers ». En conséquence, le gouvernement
invite l'Union à « prendre les mesures appropriées pour faire
face au risque de dumping écologique, notamment
en mettant en place un mécanisme aux frontières visant les pays qui ne
joueraient pas le jeu de la lutte contre le changement
climatique » ; cela « dans des conditions
compatibles avec les règles de l'OMC », évidemment...
« Il s'agit de placer l'Europe à la pointe de la
transition vers une économie à faibles émissions de carbone. »
À cet effet, il faudra veiller à la cohérence des politiques
communautaires, dont « l'évaluation et le suivi [...] par le
Parlement et les États membres doivent être renforcés ».
Enfin, selon la France, « le Conseil européen [des chefs
d'État ou de gouvernement] doit être la pierre angulaire de la
gouvernance de la nouvelle stratégie ». Sans doute les États
plus petits préféreraient-ils s'en remettre à la Commission.
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
21 janvier 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Le Parlement européen a entamé l'audition des personnalités
choisies par les gouvernements pour former la nouvelle Commission. Sans
doute va-t-il en profiter pour affirmer son pouvoir à leurs dépens.

Le Parlement européen a entamé lundi 11 janvier
l'audition des personnalités désignées pour former la nouvelle
Commission. Présidée, comme la précédente, par le Portugais José Manuel
Durao Barroso, celle-ci sera soumise à un vote d'approbation qui
interviendra probablement le 26 janvier. Ensuite, seulement,
les chefs d'État ou de gouvernement pourront entériner officiellement
sa nomination.
Annonce fracassante
Sans doute leurs projets seront-ils en partie contrecarrés. À
l'automne 2004, la vindicte des parlementaires avait eu raison
de la candidature de l'Italien Rocco Buttiglione, coupable de
« penser que l'homosexualité est un péché ». Cette
fois-ci, prendront-ils pour cible la Britannique Catherine
Ashton ? Elle avait été choisie à la surprise générale pour
devenir le Haut Représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et
la Politique de sécurité, par ailleurs vice-président de la Commission.
Dans le résumé officiel de son intervention, on relève cette
annonce fracassante au sujet du Proche-Orient : « La
prochaine étape est d'aller là où nous pensons que nous pouvons
apporter le plus et formuler ensemble les solutions
appropriées. » À la décharge de Mme Ashton, on
rappellera qu'elle se doit de tenir un discours suffisamment consensuel
pour satisfaire vingt-sept États membres... En tout cas, son insistance
sur le poids des initiatives nationales et le rôle de l'Otan en matière
de défense n'aura pas froissé ses compatriotes. Marquant quelque
réserve à l'égard du droit-de-l'hommisme, elle a observé que
« parler aux gens sans médiatisation [était] parfois plus
efficace ». Évoquant le Service européen pour l'Action
extérieure (SEAE), elle a concédé aux députés qu'il ferait
« l'objet d'un droit de regard complet de la part du
Parlement », refusant toutefois de soumettre ses ambassadeurs
à une audition. En définitive, son intervention a tempéré les critiques
sans vraiment les dissiper. Mais sa candidature faisant l'objet d'un
consensus entre les gouvernements européens, les institutions de
l'Union et les groupes politique du Parlement, celui-ci ne se risquera
pas à la mettre en échec.
Barnier fait du "social"
Il ne s'attaquera pas non plus à Michel Barnier, censé
travailler « à mettre le marché intérieur au service du
progrès humain, à lutter contre le dumping social
et à protéger les services d'intérêt général ». "Européen"
convaincu, l'ancien ministre de l'Agriculture s'est pourtant risqué à
paraphraser les souverainistes : « Dans un monde
instable, fragile, dangereux, nous devons nous doter d'une Europe de la
défense. Mais nous n'avancerons pas contre les États membres en
menaçant de fragiliser leur souveraineté, nous avancerons avec
eux. »
Le "grand oral" de Rumiana Jeleva s'avéra plus mouvementé. Le
ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie était désigné pour
devenir commissaire en charge de la Coopération internationale, de
l'Aide humanitaire et de la Réponse à la crise. « L'audition
avait bien commencé, avec une déclaration politique initiale [...]
applaudie par les eurodéputés », raconte Nicolas
Gros-Verheyde. « Mais arrive une question prise de haut, de
trop haut », portant sur sa déclaration d'intérêts. Parmi les
inquisiteurs figuraient des députés bulgares : l'assemblée
européenne offre un terrain propice aux règlements de compte nationaux.
Déstabilisée, la candidate aurait ensuite multiplié les erreurs.
Répondant, par exemple, à une question sur l'aide humanitaire dans le
golfe d'Aden, « elle se montre "prête à aller sur place..."
sans mesurer qu'il s'agit de la Somalie dont on parle, un État
déliquescent, où le moindre occidental est aussitôt considéré comme une
proie à ravir ou... à tuer ». (Bruxelles 2,
12/01/2009)
« De fait, son audition, mardi dernier, a été
catastrophique », confirme Jean Quatremer. « Mais, à
ce petit jeu, elle est loin d'avoir été la seule dans ce cas. [...] Il
est clair que Jeleva est surtout victime d'une volonté du Parlement
européen de rappeler à la Commission et aux États membres qu'il est un
acteur majeur du jeu européen. » (Coulisses de
Bruxelles, 19/01/2010)
Les Socialistes et Démocrates réclament sa tête. En réaction,
le PPE s'est lui aussi cherché une proie. Son dévolu s'est jeté sur le
Slovaque Maros Sefcovic, suspecté d'avoir tenu des propos désobligeants
à l'encontre des Roms. L'attaque semble avoir échoué. Quoi qu'il en
soit, ces querelles illustrent, à nos yeux, tout l'intérêt des
auditions organisées par les commissions parlementaires.
Sur un pied d'égalité
Les gouvernements doivent pourtant compter avec le Parlement
européen. Lequel entend bien le faire savoir. Depuis le
4 janvier, rapporte encore Jean Quatremer, il exige que leurs
ambassadeurs à Bruxelles (les "représentants permanents"), ainsi que
tous les fonctionnaires du Conseil, se fassent accréditer comme
n'importe quel visiteur pour pénétrer dans ses bâtiments. L'assemblée
réclamerait l'application d'un principe de réciprocité.
« De fait, les fonctionnaires du Parlement se rendant
au Conseil des ministres doivent s'annoncer à l'entrée du Justus
Lipsius, dire avec quelle personne ils ont rendez-vous, obtenir un
badge provisoire, se plier aux contrôles de sécurité et enfin être
accompagnés. » Cela serait donc en passe de changer.
« Mais il ne s'agira que d'un armistice », poursuit
notre confrère : « Le prochain clash, déjà programmé,
est celui de l'accès aux réunions. » (Coulisses de
Bruxelles, 17/01/2010) Les gouvernements pourraient
regretter d'avoir accru les pouvoirs du Parlement européen en négociant
le traité de Lisbonne.
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
12 janvier 2010
Les gouvernements des Vingt-Sept rechignent à augmenter le
traitement des fonctionnaires européens suivant des règles établies de
longue date ; la Cour de Justice devra leur forcer la main.
Pourquoi les États lui ont-il conféré un tel pouvoir ?

Les fonctionnaires européens exigent que leur traitement soit
augmenté de 3,7 %. Une requête déplacée ? Jean-Philippe
Chauvin stigmatise leur « indécence ».
« Mais voilà », explique Jean
Quatremer : « Il ne s'agit que de
l'application d'une règle votée par les États membres, pour la période
2004-2012, qui prévoit que le salaire des eurofonctionnaires est
indexé sur celui de la fonction publique de huit pays [...] et sur le
coût de la vie à Bruxelles. »
La Commission européenne a porté l'affaire devant la Cour de
Justice de l'Union européenne, dont on devine le verdict. Celui-ci
s'imposera aux vingt-sept États membres, en dépit de leur accord
apparemment unanime. C'est ici que devrait résider le vrai scandale, du
moins aux yeux des souverainistes. Face aux juges, en effet, les
politiques témoigneraient d'une « servitude
volontaire », selon l'analyse de Paul Magnette (Le
Régime politique de l'Union européenne, Presses de Science
Po). « Pourquoi les gouvernements se sont-ils laissés faire
? » À ce « faux mystère », il y aurait
plusieurs réponses.
« On peut rappeler, d'abord, que l'action de la Cour
protège souvent les intérêts des gouvernements eux-mêmes. [...] En
effet, en l'absence de contrôle juridictionnel, les gouvernements
seraient fortement tentés de se soustraire à leurs obligations et de se
livrer une concurrence déloyale. Chacun des gouvernements pourrait en
pâtir à son tour et le régime dans son ensemble s'en trouverait
affaibli. Dans leurs conflits avec la Commission, les gouvernements ont
aussi, le plus souvent, trouvé dans la Cour un arbitre impartial. [...]
Le formalisme qui irrigue nos cultures politiques est aussi fréquemment
invoqué pour expliquer la docilité des gouvernants. Enfin, et peut-être
surtout, la structure du régime de l'Union elle-même explique la
résignation des dirigeants nationaux. Les rapports entre les
gouvernements et la Cour sont définis de telle sorte que les juges
peuvent se prévaloir de fortes marges d'indépendance, tandis que les
gouvernements sont privés de tout pouvoir de rétorsion. Cette
asymétrie fondamentale – due aux gouvernements eux-mêmes, auteurs des
traités – est la source essentielle des relations particulières qui se
sont établies entre les juges et les politiques dans
l'Union. »
« Formellement », les gouvernements
« restent libre de modifier les traités – et donc les pouvoirs
de la Cour. En pratique, la nécessité de réunir l'unanimité pour ce
faire rend la menace peu crédible : la jurisprudence de
Luxembourg affectant différemment les intérêts des gouvernements, il se
trouvera toujours au moins l'un d'entre eux pour opposer son veto à une
révision du traité. »
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
7 janvier 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
La Commission européenne convoque le féminisme au service de la croissance.

« L'égalité entre les femmes et les hommes est une
priorité pour notre pays et pour l'Union européenne »,
proclame le président du gouvernement espagnol. Sans doute José Luis
Rodríguez Zapatero a-t-il accueilli avec bienveillance le rapport
publié le 18 décembre par la Commission européenne.
« L'égalité des sexes n'est pas seulement une question de
diversité et d'équité sociale », affirme-t-on à Bruxelles.
Elle constituerait aussi « une condition préalable à la
réalisation des objectifs de croissance durable, d'emploi, de
compétitivité et de cohésion sociale ». Pour preuve, la
participation croissante des femmes au marché du travail serait
« à l'origine d'un quart de la croissance économique annuelle
depuis 1995 ».
Des États sceptiques ?
« Les investissements dans les politiques égalitaires
sont payants », martèle le rapport. Mais tous les États n'en
sont pas convaincus : examinant les mesures nationales de lutte contre
la crise, la Commission pointe « le risque de détérioration du
statut des politiques égalitaires ». La tentation serait
d'autant plus grande d'y renoncer que les femmes sembleraient moins
affectées par le conjoncture économique. Mais le taux d'emploi des
hommes se redresserait plus rapidement.
Constatant l'« influence marquée de la parentalité
[sic] sur la participation au marché du travail », la
Commission stigmatise le « partage traditionnel des
rôles », mais aussi le « manque de structure
d'accueil pour les enfants ». En conséquence, elle réclame
« des politiques et des incitations pour persuader les hommes
et leur permettre d'assumer une plus grande part des tâches
familiales » ; ce serait même « un défi
majeur à relever ». Plus raisonnablement, elle souligne que «
l'absence de mesures adéquates permettant de trouver un équilibre entre
vie professionnelle et vie familiale peut [...] inciter les femmes et
les hommes à ne pas avoir d'enfants ou à en avoir moins, ce qui pose
problème eu égard au vieillissement de la population ».
Fait remarquable : « Dans les pays où les
conditions sont favorables s'agissant des services de garde d'enfants,
des systèmes de congé parental et des régimes de travail flexibles, le
taux d'emploi des femmes et le taux de natalité sont tous les deux plus
élevés. » Ayant réconcilié en apparence féminisme et natalité,
Bruxelles ne craint pas d'affirmer qu'« au besoin, il
conviendrait de [...] supprimer les éléments financiers qui dissuadent
les seconds titulaires de revenus [...] de travailler ».
Incohérence
Ce rapport, nourri d'idéologie, n'est pas sans présenter
quelque incohérence. Saluant la réforme du congé parental, la
Commission observe qu'elle encouragera les pères à profiter de cette
possibilité. Une perspective manifestement contraire à l'objectif
assigné par ailleurs à l'égalité des sexes, censée « permettre
aux États membres d'exploiter pleinement l'offre potentielle de main
d'œuvre ».
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | 2 commentaires | Lien permanent
7 janvier 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Espagne assure pour six mois la présidence du Conseil de
l'UE. Ses dirigeants devront cohabiter avec de nouveaux responsables
européens... Rappels historiques et résumé des priorités affichées par
Madrid.

Depuis le 1er janvier, l'Espagne assure la présidence
du Conseil de l'Union européenne. C'est la quatrième fois que cette
responsabilité lui incombe depuis son entrée dans la Communauté
européenne en 1986. Madrid avait frappé à sa porte dès les années
soixante, obtenant seulement qu'elle lui soit entrouverte, avec la
souscription d'un accord préférentiel en 1970. Formalisée en 1977,
moins de deux ans après le décès du général Franco, sa demande
d'adhésion avait été accueillie avec réticence par la France...
Un pays europhile
Elle suscitait en revanche un consensus national. L'adhésion
fut approuvée à l'unanimité par le parlement. « L'appui de
l'Espagne au processus d'intégration européenne a toujours été
supérieur à la moyenne européenne », constate Lorenzo Delgado
Gomez-Escalonilla. « L'entrée dans l'Europe n'est pas associée
à la perte de la souveraineté ou de l'identité nationale comme cela se
produit dans d'autres États. » (Dictionnaire
critique de l'Union européenne, Armand Colin)
En vingt ans, bénéficiant largement des fonds structurels
européens, l'économie espagnole s'est radicalement transformée. Cela
n'est pas allé sans douleur, mais le "revenu par tête" est passé de
8 000 euros annuels en 1985 à
23 000 euros en 2005. Il y a quatre ans, le traité
établissant une constitution pour l'Europe ayant fait l'objet d'un
référendum, le "oui" l'avait emporté à la faveur de 77 % des
voix.
Animant pendant six mois les travaux des ministres européens
(à l'exception de ceux touchant aux affaires étrangères, désormais
coordonnés par le Haut Représentant), l'Espagne revendique quatre
priorités : « application fidèle et résolue du
nouveau traité ; une plus grande coordination des politiques
économiques afin de garantir la relance économique et d'asseoir les
bases d'une croissance européenne durable ; renforcement de
l'Union en tant qu'acteur politique décisif dans la
mondialisation ; veiller constamment aux intérêts des citoyens
européens et au respect de leurs droits dans toutes les nouvelles
initiatives ».
« Nous voulons que le président Van Rompuy et la
Haute Représentante [sic] Ashton puissent, dès le début, exercer
pleinement leurs fonctions », assure José Luis Rodríguez
Zapatero. Sa fidélité à l'"esprit de Lisbonne" est pourtant mise en
doute. Le chef du gouvernement espagnol parviendra-t-il à se faire une
place aux côtés du président du Conseil européen ? En pleine
période de transition institutionnelle, on guettera les incidents.
Mais, de part et d'autre, on se satisfera vraisemblablement de quelques
arrangements. Dorénavant, par exemple, un délégué du Haut Représentant
est censé présider le COPS (Comité politique et de sécurité) ;
aussi Mme Ashton a-t-elle assigné cette mission à l'ambassadeur
espagnol, tout simplement (Bruxelles 2,
19/12/2009).
L'Espagne devrait porter un intérêt tout particulier au
Parlement européen. Elle y sera plus souvent confrontée que ses
prédécesseurs en raison des pouvoirs accrus de l'assemblée. En outre,
elle s'attachera à faire adopter aussi vite que possible le protocole
permettant de réviser sa composition sans attendre les prochaines
élections européennes. Parmi les douze États bénéficiant de sièges
supplémentaires, elle est en effet celui qui en gagne le plus (quatre
députés).
Questions pour un champion
Naturellement, il appartiendra à Madrid d'accompagner la mise
en œuvre du Service européen pour l'Action extérieure (SEAE). Catherine
Ashton voudrait en faire « un vrai service, pour mener la
diplomatie de l'Union [...] avec les moyens budgétaires nécessaires,
non pas pour remplacer la diplomatie des États membres mais pour [s'] y
ajouter » (Bruxelles 2,
16/12/2009). « Je pense que nous pouvons obtenir beaucoup de
la "diplomatie tranquille" », a-t-elle déclaré. Affichant un
optimisme bien naïf, elle espère « réunir les représentants
les plus talentueux de tous les États membres de l'UE » (Le Figaro,
18/12/2009).
À moins qu'une grève des fonctionnaires européens ne perturbe
le calendrier, le Parlement entamera lundi prochain,
11 janvier, les auditions des nouveaux membres de la
Commission. Mme Ashton sera la première soumise à ce "grand oral"
minuté à la seconde près, où les questions s'enchaîneront pendant trois
heures à un rythme infernal (Bruxelles 2,
17/12/2009). Curieuse façon d'évaluer des compétences sur un sujet
aussi complexe que les relations internationales.
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
7 janvier 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Depuis la fin novembre, Quick s'essaie à la vente de
hamburgers certifiés halal. Le groupe de
restauration rapide se lance ainsi sur un marché porteur, qui affiche
régulièrement une croissance à deux chiffres.
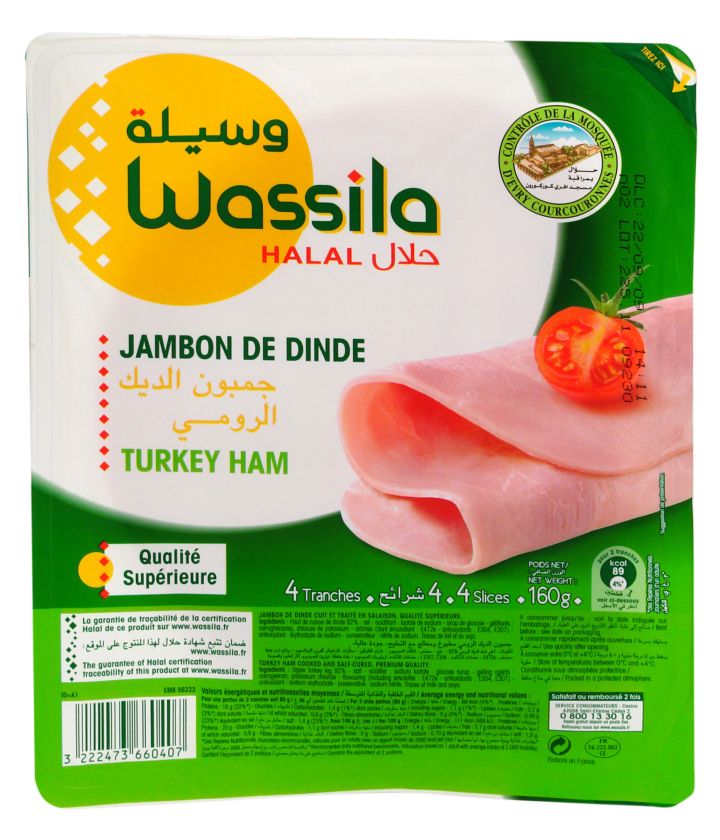
Le concurrent européen de McDonald's, contrôlé à 95 %
par un fonds public français, s'est immiscé malgré lui dans le débat
sur l'identité nationale : depuis le 30 novembre, des
repas certifiés halal sont servis dans huit
restaurants Quick de l'hexagone. Les hamburgers y sont garnis d'une
viande issue d'un abattage rituel, opéré par égorgement
« au nom de Dieu », face à La Mecque, par un
sacrificateur habilité par un organisme religieux avec l'agrément de
l'État. Le porc étant réputé haram (illicite),
des allumettes de dinde ont remplacé les lardons.
30 % de hausse
La démarche, expérimentale, permettra d'évaluer l'ampleur des
difficultés logistiques : les prescriptions islamiques
pourraient s'avérer délicates à respecter dans des cuisines où des
aliments "licites" risquent de cohabiter avec quelques autres proscrits par la loi
coranique. L'enseigne veillera sans doute à dissiper la méfiance des
clients, alors que son concurrent KFC, ayant investi un créneau
similaire, est justement accusé d'avoir trahi leur confiance. À
Villeurbanne, ils sont invités à vérifier l'origine des commandes dans
un cahier mis à leur disposition en français et en arabe. Avec ce
changement de carte, rapporte notre consœur Carole Bianchi,
« "le fast-food a vu son chiffre d'affaires progresser de
30 % et a dû embaucher deux fois plus de personnel en moins de
quinze jours, selon le gérant Karim Bouzeenaba » (20 Minutes,
15/12/2009).
Nouveau marché
L'alimentation halal constitue un marché
en plein essor, enregistrant régulièrement une croissance supérieure à
10 %. Spécialisé « dans les études marketing
ethniques », le cabinet Solis lui attribue un chiffre
d'affaires de 4 milliards d'euros en 2009 (dépenses des
ménages, sans compter la consommation en restauration hors domicile de
type sandwicheries, restaurants, collectivités...). Par comparaison, le
"bio" drainerait seulement 2,6 milliards d'euros, selon
l'estimation citée par Anne-Hélène Pommier (Le Figaro,
16/12/2009).
« Longtemps limité à des commerces
traditionnels », le circuit de distribution de ces produits
s'étend aujourd'hui aux grandes et moyennes surfaces, observe Solis,
« notamment aux grandes enseignes d'hypermarchés qui
présentent des offres de produits halal élaborés pour partie par les
plus grands groupes agroalimentaires français ».
Industriels et distributeurs cibleraient les "baby-boomers de
la diversité", nés en France et forts d'un pouvoir d'achat supérieur à
celui de leurs aînés. Mais ils communiquent encore avec pudeur,
préférant généralement promouvoir les "saveurs d'Orient". Si Maggi fait
figure d'exception, la plupart commercialisent leurs produits halal
sous une marque spécifique. Tel Casino, en pointe avec Wassila, ou
Panzani, qui fut le premier à lancer une campagne publicitaire sur les
chaines "hertziennes". C'était l'été dernier, à l'occasion du ramadan :
« Certains de nos clients se retrouvent dans les personnages
de la pub, ça leur fait plaisir, c'est pour eux une preuve
d'intégration » se félicitait alors Sébastien Beyhourst,
directeur marketing de Zakia Halal (Libération,
26/08/2009).
Entre intégration et assimilation
Preuve que l'intégration n'est en aucun cas synonyme
d'assimilation ? L'"islamisation" du pays, volontiers
dénoncée, suscite un malaise compréhensible. Observons toutefois
qu'elle ne va pas sans paradoxes : s'ils se distinguent de
leurs compatriotes par certaines habitudes de consommation, imposées
par leur foi, les musulmans peuvent désormais se fournir dans les mêmes
boutiques, s'asseoir à la même table... Voire se joindre aux mêmes
fêtes : à la veille de Noël, Caroline Taix signalait que
« chapons, foie gras et dinde farcie halal [avaient] fait leur
apparition dans les rayons des épiceries spécialisées » (Les Échos,
24/12/2009).
Publié dans Islam | 2 commentaires | Lien permanent
29 décembre 2009
Depuis Dublin, un commissaire européen prononce un éloge
dithyrambique de la diplomatie française. Charlie McCreevy a-t-il perdu
la tête ?

Le président de la République n'a pas manqué de fanfaronner,
tandis qu'il venait d'obtenir pour la France le portefeuille de
commissaire européen en charge du Marché intérieur. Ce faisant, il
aurait « enterré une fois pour toutes le mythe selon lequel
les commissaires européens, et tout particulièrement les Français,
arrivant à Bruxelles, sont supposés laisser de côté les intérêts
nationaux ». C'est en tout cas l'opinion formulée le
18 décembre par le commissaire irlandais Charlie McCreevy,
auquel Michel Barnier doit justement succéder. Selon lui, l'influence de
la France à Bruxelles serait
« impressionnante » : « On oublie
que la bureaucratie de Bruxelles a été conçue par la France. [...] Au
fil des années, cela a donné aux Français un énorme avantage pour
savoir comment actionner les leviers de pouvoir. » En
conséquence, il a salué l'« habileté extraordinaire »
de la diplomatie française.
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent