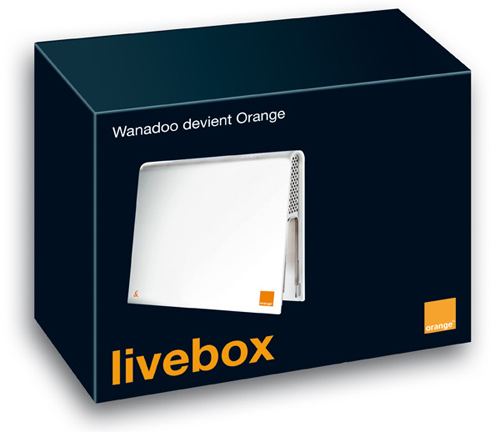5 novembre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Parmi les multiples remontrances rendues publiques par la
Commission européenne le 28 octobre, plusieurs concernaient la
France.

La plus médiatisée portait un nouveau coup au bouclier fiscal,
accusé de constituer « un obstacle à la libre circulation des
capitaux », étant donné que seuls les impôts payés en France
interviennent dans le calcul d'un éventuel remboursement.
Paris est prié, également, de mieux appliquer le droit
européen portant sur l'étiquetage de produits chimiques (harmonisé au
niveau mondial), la qualité de l'air (polluée par des particules en
suspension), la prévention des inondations et les semences fruitières.
Bruxelles conteste, en outre, un accord bilatéral conclu avec
la Russie pour le survol de la Sibérie, au motif qu'il ne s'applique
pas à toutes les compagnies aériennes de l'Union. Agitant la
jurisprudence, la Commission signale que, depuis 2002, la plupart des
accords de ce type ont été adaptés. Moscou ferait figure d'exception en
refusant pareille évolution.
La République tchèque, quant à elle, est poursuivie
devant la Cour de justice pour avoir acheté quatre avions de transport
tactique sans mise en concurrence. C'est une première, affirme notre
confrère Nicolas Gros-Verheyde : jusqu'à maintenant, en effet,
la Commission s'était abstenue d'interférer dans des contrats
strictement militaires. Ce faisant, elle semble rompre avec une
interprétation plus souple des traités, et anticipe l'entrée en vigueur
d'une directive encadrant les marchés de défense. Ce n'est peut-être
qu'un début...
Publié dans Europe | Pas de commentaires
5 novembre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'adoption d'un nouvel accord-cadre par le Parlement et la
Commission européenne suscite l'inquiétude du Conseil des ministres.

Le Parlement européen poursuit sa "montée en puissance" aux
dépens des gouvernements. Le 20 octobre a été signé un nouvel
accord-cadre régissant ses rapports avec la Commission, qui s'est
engagée à lui garantir la participation aux réunions, l'accès aux
documents – y compris confidentiels –, le suivi des
négociations internationales, etc., dans les mêmes conditions que le
Conseil des ministres.
Celui-ci s'en est inquiété dans une déclaration où il constate
« que plusieurs dispositions [...] tendent à modifier
l'équilibre institutionnel [...], à reconnaître au Parlement européen
des prérogatives qui ne sont pas prévues par les traités ». Il
prévient qu'il « saisira la Cour de justice de tout acte ou
action du Parlement européen ou de la Commission pris en application
des dispositions dudit accord-cadre qui porterait atteinte aux intérêts
du Conseil ou aux prérogatives que les traités lui
confèrent ».
Loin de se laisser intimider, les eurodéputés continuent de
jouer les maîtres-chanteurs, menaçant de bloquer l'adoption du prochain
budget européen s'ils n'obtiennent pas l'assurance qu'un débat sera
bientôt ouvert sur l'affectation à l'Union de nouvelles ressources
propres.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
7 octobre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Le dialogue se poursuit désormais entre Paris et Bruxelles avec une
moindre théâtralité. D'autant que la Commission européenne renonce,
pour le moment, à poursuivre la France pour
« discrimination ».

Paris et Bruxelles seraient-ils décidés à calmer le jeu dans
l'affaire les opposant sur l'expulsion des Roms ? La polémique
avait atteint son comble à la mi-septembre, après que Viviane Reding se
fut décidée à jouer la vierge effarouchée. « J'ai été
personnellement choquée par des circonstances qui donnent l'impression
que des personnes sont renvoyées d'un État membre uniquement parce
qu'elles appartiennent à une certaine minorité ethnique »,
avait-elle déclaré le 14 septembre. « Je pensais que l'Europe
ne serait plus le témoin de ce genre de situation après la Seconde
Guerre mondiale. » Regrettant « que les assurances politiques
données par deux ministres français [soient] contredites par une
circulaire administrative », elle avait dénoncé « un affront
», avant de conclure : « Après onze ans d'expérience à la
Commission, je dirais même plus, c'est une honte. »
Sarko fait son show
Confronté à une telle suffisance, le président de la République a
profité du Conseil européen du 16 septembre pour élever la voix.
Au risque de froisser ses homologues, vraisemblablement exaspérés par
sa volonté d'instrumentaliser un sommet international à des fins de
propagande intérieure. « La France a agi et continuera d'agir dans
le strict respect du droit européen », avait-il martelé lors d'une
conférence de presse, avant d'entrouvrir une porte de sortie :
« En vérité, je pense que la Commission et nous, nous sommes sur
la même position. Les choses vont revenir dans la normale et s'il n'y
avait pas eu ces propos outranciers, ceci aurait été géré tout à fait
normalement. La Commission est dans son rôle en posant des questions,
en regardant si l'esprit et la lettre des traités sont respectés. [...]
S'il s'avérait que dans la transposition [de la directive encadrant
droit de libre circulation et de séjour], les gouvernements qui nous
ont précédé, comme le nôtre, aient commis des erreurs [...], mais
naturellement qu'on les corrigerait. »
Mise en demeure
Or, le mercredi 29 septembre, Bruxelles a confirmé qu'il
enverrait « une lettre de mise en demeure à la France en demandant
la transposition complète de la directive, à moins qu'un projet de
mesure de transposition ainsi qu'un calendrier précis pour son adoption
ne soit transmis avant le 15 octobre 2010 ». Aussitôt, Paris
a réagi avec satisfaction, soulignant que d'autres États membres (sinon
la majorité) étaient passibles d'une telle procédure, au demeurant
banale, sinon anecdotique, puisque la Commission cessait de
pointer (pour le moment) une application discriminatoire du droit de
l'Union.
La mécanique européenne peut souffrir des rivalités au sein du
triangle institutionnel (Conseil des ministres où sont représentés les
gouvernements, Commission, Parlement), mais non des hostilités
ouvertes, dont les sommets les plus fédéraux seraient d'ailleurs les
premiers à pâtir. Aussi cette crise semble-t-elle évoluer selon le
scénario le plus vraisemblable. Mme Reding pourra s'enorgueillir
d'avoir engagé quelques poursuites, poussée par un tropisme fédéraliste
inhérent à sa nationalité luxembourgeoise, auquel s'ajoute la prégnance
des rivalités institutionnelles. En effet, comment expliquer sa
participation au bal des hypocrites, sinon par la volonté de flatter
les parlementaires, rendus incontournables par l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, après avoir été cantonnés, des années durant, à
l'adoption de résolutions ?
Astérix tient bon
Quant à Nicolas Sarkozy, il aura démontré, une fois de plus, la
force de sa détermination, bravant, seul contre tous, le monstre
bruxellois, selon un refrain bien connu... Pierre Lellouche, le
secrétaire d'État en charge des Affaires européennes, se serait même
risqué à justifier ce numéro d'esbroufe : il conviendrait de
« rassurer les Français inquiets de l'ingérence de l'exécutif
européen dans les affaires intérieures françaises », aurait-il
confié, en substance, à notre confrère Jean Quatremer, scandalisé par
ce « coming out souverainiste » !
Cela dit, « l'affaire n'est pas classée », a prévenu
Mme Reding, en réponse au mécontentement exprimé par certains
parlementaires. « Je trouve que la communication de la Commission
est ridicule » a déclaré, par exemple, l'eurodéputé italien Sonia
Alfano (ADLE). Le Berlaymont a adressé des demandes d'informations
complémentaires aux autorités françaises. « J'ai fait part de ma
profonde déception concernant la circulaire du 5 août », a
rappelé le vice-président de la Commission. « Elle a été modifiée
le 13 septembre. Que s'est-il passé entre, et que se passe-t-il à
l'heure actuelle ? [...] Il nous faut examiner les copies des
ordres d'expulsion afin de comprendre clairement ce qui est arrivé. Il
nous faut les chiffres, tous les chiffres, afin de pouvoir continuer
notre analyse. » La maîtresse d'école a du pain sur la planche.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
23 septembre 2010
Une communication officielle confirme la prégnance du gender
sur les étires européennes. Aperçu.

La Commission européenne a présenté mardi dernier,
21 septembre 2010, sa
« stratégie pour l'égalité entre les femmes et les
hommes ». On y retrouve les poncifs du féminisme
bruxellois, auquel des considérations économiques servent toujours
d'alibi : « Pour réaliser les objectifs de la
stratégie Europe 2020, à savoir une croissance intelligente,
durable et inclusive, il est impératif de faire appel plus largement et
plus efficacement au potentiel des femmes et à leur réservoir de
talents. » Cela permettrait de « contrebalancer les
effets de l'amenuisement de la population en âge de
travailler », d'autant que « les mesures de
conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée »
auraient « des effets positifs sur la fécondité ».
Mais bien qu'elle prétende stimuler l'activité, la Commission entend
supprimer « les disparités encore présentes dans les droits
aux congés pour raisons familiales, notamment les congés de paternité
et les congés des personnes aidantes ».
« La rigidité des rôles attribués aux femmes et aux
hommes » est fustigée au motif qu'elle « peut
entraver leurs choix et restreindre le potentiel de chacun ».
Or, il serait paraît-il « dans l'intérêt de tous d'offrir aux
femmes aussi bien qu'aux hommes de véritables choix à chaque étape de
leur vie ». D'où la nécessité, selon Bruxelles, de mettre les
hommes aux fourneaux – avant d'offrir des poupées aux petits garçons et
de couper les cheveux de leurs sœurs : « Favoriser
une redéfinition des rôles non discriminatoire dans tous les domaines
de la vie, comme l'éducation, les choix de carrière, l'emploi ou le
sport, est essentiel pour parvenir à l'égalité entre les
sexes. »
On tremble en découvrant combien l'idéologie du genre imprègne
les élites européennes, qui revendiquent à demi-mot la volonté de faire
le bonheur des individus : « beaucoup de
citoyens européens ont vu leur vie prendre un tour meilleur grâce aux
actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes menées
par l'Union européenne », affirme-t-on très sérieusement à
Bruxelles.
Les ressortissants des États membres ne sont pas les seuls
concernés : les mêmes préoccupations sont censées influencer
les négociations d'adhésion et la politique de voisinage. « En
outre, l'Union européenne coopérera activement avec les organisations
internationales travaillant à l'égalité comme l'OIT, l'OCDE, l'ONU et
l'Union africaine, pour produire des synergies et favoriser
l'émancipation des femmes, ainsi qu'avec la nouvelle entité "Genre" des
Nations Unies, ONU Femmes, et soutiendra la participation de la société
civile, le renforcement des capacités et la promotion de l'égalité
entre les sexes et de l'émancipation des femmes. » La passion
égalitaire des enceintes multilatérales s'expliquerait-elle par leur
manque de légitimité politique ? Quoi qu'il en soit, nous
sommes prévenus : « La Commission fera de
l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes un
rouage à part entière de l'élaboration de ses politiques. »
NB – Forte de sa nouvelle notoriété, Viviane Reding n'a pas
exclu de promouvoir l'instauration de quotas censés
« améliorer la représentation des femmes aux postes à
responsabilité » : « Vu l'absence de progrès
dans ce domaine, nous pourrions à l'avenir envisager de prendre des
initiatives au niveau européen », a-t-elle déclaré.
« J'ai l'intention de rencontrer durant le printemps 2011 les
directeurs de grandes entreprises européennes cotées en bourse, pour
examiner la situation et envisager les possibilités d'une
autorégulation énergique. En fonction des résultats de ce dialogue avec
les entreprises, j'évaluerai la nécessité de lancer d'autres
initiatives en 2012. »
Publié dans Europe, Féminisme & Genre | Pas de commentaires
22 septembre 2010
L'"affaire" des Roms provoque un vacarme assourdissant. Lundi
dernier, 20 septembre 2010, Toute l'Europe
a évoqué « l'une des plus graves crises ayant opposé la France
et la Commission européenne ». Ne serait-elle pas surtout
l'une des plus théâtralisées ?

Jouant la vierge effarouchée, Viviane Reding a quelque peu
tardé à endosser son rôle. Intervenant
le 7 septembre devant le Parlement européen réuni à
Strasbourg, elle avait ménagé le gouvernement français, après avoir
souligné la responsabilité des États membres – « en charge de
l'ordre public et de la sécurité de leurs citoyens » – et fixé
des limites au principe de libre circulation. Ce faisant, le
commissaire luxembourgeois s'était attiré les foudres des eurodéputés.
Viviane hausse le ton
De retour à Bruxelles, Mme Reding a changé de
ton : « J'ai été personnellement choquée par des
circonstances qui donnent l'impression que des personnes sont renvoyées
d'un État membre uniquement parce qu'elles appartiennent à une certaine
minorité ethnique », a-t-elle
déclaré le 14 septembre. « Je pensais que
l'Europe ne serait plus le témoin de ce genre de situation après la
Seconde Guerre mondiale. [...] Je regrette profondément que les
assurances politiques données par deux ministres français [soient]
maintenant ouvertement contredites par une circulaire administrative de
ce même gouvernement. Le rôle de la Commission en tant que gardienne
des Traités est rendu extrêmement difficile si nous ne pouvons plus
avoir confiance dans les assurances données par deux ministres lors
d'une réunion formelle avec deux commissaires et en présence de quinze
fonctionnaires de haut niveau de part et d'autre de la table. Vu
l'importance de la situation, il ne s'agit pas d'un affront mineur.
Après onze ans d'expérience à la Commission, je dirais même plus, c'est
une honte. »
Comment expliquer cette participation soudaine au bal des
hypocrites, sinon par la prégnance des rivalités institutionnelles et
la volonté de flatter les parlementaires, rendus incontournables par
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, après avoir été cantonnés,
des années durant, à l'adoption de résolutions ? Qu'importe la
mention des Roms dans la circulaire diffusée place Beauvau, nul n'étant
dupe de la situation résumée
par Xavier Laborde : « Les Roms
franchissent les frontières pour des raisons de discrimination en tant
que communauté, s'installent dans des camps où ils vivent entre eux, se
trouvent donc tous ensemble dans la même situation au regard du droit
au séjour, mais l'État devrait traiter leur cas individuellement, comme
s'ils étaient venus un par un ? » En vérité, comme
l'a rappelé Jean Quatremer, « la plupart des pays
européens mènent la même politique que la France à l'égard des Roms qui
ne sont les bienvenus nulle part [...] mais en évitant la rhétorique un
tantinet xénophobe employée par la droite française. L'Allemagne vient
ainsi de signer un accord avec le Kosovo prévoyant le rapatriement de
douze mille Roms – dont cinq mille enfants – réfugiés chez elle souvent
depuis plus de dix ans. Autrement dit, Paris n'est somme toute coupable
que d'avoir dit – brutalement - tout haut ce que les autres font tout
bas. »
Cela relativise l'isolement de la France, à laquelle seul
Silvio Berlusconi a apporté son soutien lors du Conseil européen du
16 septembre. Le président de la République est accusé d'avoir
vivement interpellé José Manuel Barroso ce jour-là – ce dont il
s'est défendu avec un certain humour :
« S'il y a bien quelqu'un qui a gardé son calme et qui s'est
abstenu de commentaire excessif, c'est bien moi », a-t-il
assuré lors
d'une conférence de presse. « Je ne souhaite pas
polémiquer », a-t-il annoncé à nos confrères, avec une
mauvaise foi à peine dissimulée. Affirmant que son « devoir de
chef de l'État, c'est de défendre la France », il a fustigé à
moult reprises les « raccourcis historiques » que
Mme Reding avait entretemps regrettés. Sans doute ses
homologues auront-ils été contrariés, sinon exaspérés, par
l'instrumentalisation d'un sommet européen à des fins de propagande
intérieure. Ces gesticulations ne sont pas de nature à asseoir la
crédibilité internationale de la France : « au
final », résume
Nicolas Gros-Verheyde, celle-ci « a beaucoup parlé,
mais peu convaincu et beaucoup irrité ».
Une posture gaullienne ?
Christian Lequesne a esquissé une analogie avec la "crise de
la chaise vide" survenue en 1965 : « Le général
De Gaulle fustigeait à l'époque les "technocrates apatrides"
de Bruxelles, a-t-il
expliqué à Clémentine Forissier. Selon cette vision, seuls
les responsables gouvernementaux sont au fait des politiques publiques.
C'est un peu le message actuel de l'UMP. D'une certaine manière, il ne
reste rien de l'héritage gaulliste à l'UMP, sauf le discours sur
l'Europe. » La production n'a plus la même envergure, mais
dans chacun des cas, effectivement, la France fait son cinéma. Pierre
Lellouche se serait même risqué à justifier ce numéro
d'esbroufe : « son coming out souverainiste
était nécessaire pour rassurer les Français inquiets de l'ingérence de
l'exécutif européen dans les affaires intérieures
françaises », aurait-il
confié en substance à notre confrère Jean Quatremer.
Au-delà, « cette attitude de la France témoigne,
selon l'analyse de Christian Lequesne, d'une conception
strictement intergouvernementale de ce que doit être l'Europe. En
d'autres termes, il ne faut surtout pas d'intervention de la part de la
Commission et du Parlement. [...] Les Français ont interprété la
présidence française de l'UE au deuxième semestre 2008 comme un grand
succès. Mais à Bruxelles, la vision n'est pas tout à fait la même.
Certes le leadership français a été reconnu, mais
la France a aussi été très critiquée pour être passée systématiquement
en force sur les procédures. »
Le débat opposant les méthodes communautaire et
intergouvernementale est inscrit dans les gènes de l'Union européenne,
mais peut-être a-t-il été relancé à la faveur de la Crise, voire de
l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne – deux facteurs ayant
visiblement conforté la primauté du Conseil européen réunissant les
chefs d'État ou de gouvernement. En dépit du tropisme fédéraliste
inhérent à sa nationalité, et bien qu'il use d'une pirouette
sémantique, son président dorénavant "permanent", Herman Van Rompuy,
semble loin de s'en offusquer : « L'Europe ne s'est
jamais faite contre les nations, a-t-il
observé lundi, lors d'une visite à Paris. Si les politiques
nationales assument une grande place dans notre Union, pourquoi cela ne
la renforcerait pas ? En un mot : non pas
renationalisation de la politique européenne, mais européisation de la
politique nationale ! [...] Souvent le choix n'est pas entre
la méthode communautaire et l'intergouvernemental, mais entre une
position européenne coordonnée ou rien du tout. »
Perspectives
Dans ces contions, les menaces brandies par
Mme Reding seront-elles mises à exécution ?
« Je suis personnellement convaincue que la Commission n'aura
pas d'autre choix que celui d'ouvrir une procédure d'infraction à
l'encontre de la France, sur la base de deux motifs, a-t-elle averti.
Le premier : application discriminatoire de la directive sur
la libre circulation. Le second : défaut de transposition des
garanties procédurales et matérielles prévues par la directive sur la
libre circulation. » La mécanique européenne peut souffrir des
rivalités au sein du triangle institutionnel, mais non des hostilités
ouvertes, dont les institutions les plus fédérales seraient d'ailleurs
les premières à pâtir.
« Paris veut calmer le jeu », annonce
d'ores et déjà Euractiv.
« La France a agi et continuera d'agir dans le strict respect
du droit européen », avait encore répété, jeudi dernier, le
président de la République, avant d'entrouvrir une porte de
sortie : « En vérité, je pense que la Commission et
nous, nous sommes sur la même position. Les choses vont revenir dans la
normale et s'il n'y avait pas eu ces propos outranciers, ceci aurait
été géré tout à fait normalement. La Commission est dans son rôle en
posant des questions, en regardant si l'esprit et la lettre des traités
sont respectés. [...] S'il s'avérait que dans la transposition, les
gouvernements qui nous ont précédé, comme le nôtre, aient commis des
erreurs [...], mais naturellement qu'on les corrigerait. »
Peut-être Bruxelles va-t-il accélérer la procédure entamée de
longue date à ce sujet. Il nous paraîtrait raisonnable qu'il s'en
contente : ainsi Mme Reding pourrait-elle
s'enorgueillir d'avoir engagé ses poursuites, tandis que Nicolas
Sarkozy soulignerait, à
la suite du représentant permanent de la France auprès de l'UE,
que « Bruxelles avait dans son collimateur la quasi-totalité
des États membres en ce qui concerne la directive de 2004 »...
Les paris sont ouverts !
Publié dans Europe | Pas de commentaires
16 septembre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Paris s'abrite derrière Bruxelles pour accroitre la TVA sur le
"triple play".
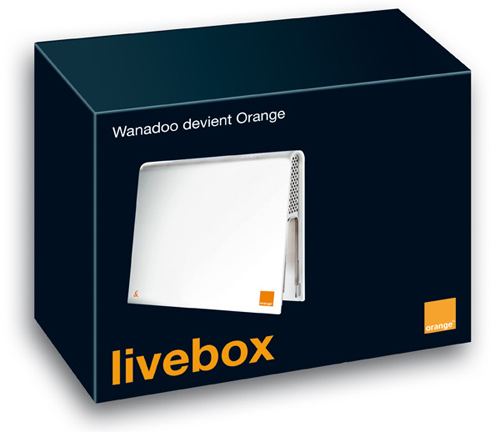
Les offres "triple play", combinant accès à Internet,
téléphone et télévision, bénéficient en France d'un taux de TVA réduit
(5,5 %) sur la moitié de la facture – un taux par ailleurs
appliqué intégralement sur les bouquets de télévision proposés,
indépendamment de tout autre service, sur le câble ou le satellite.
Bruxelles s'en était inquiété au printemps dernier, adressant
à Paris une lettre de mise en demeure dont La Tribune
s'était fait l'écho le 23 avril : « La Commission
européenne, qui agit suite à la plainte d'un particulier, estime que ce
régime viole pas moins de sept articles de la directive sur la
TVA », rapportait alors Jamal Henni. « Premier
problème : les FAI [fournisseurs d'accès à Internet]
appliquent la TVA réduite à quasiment tous leurs abonnés ADSL, "y
compris dans les cas où les FAI savent pertinemment que la télévision
n'est pas susceptible d'être utilisée par l'abonné". [...] Dans ces
cas-là, la TVA réduite s'applique à l'internet et au téléphone, ce qui
viole la directive européenne qui octroie la TVA réduite uniquement à
la TV. En outre, [...] la TVA réduite est appliquée de manière
forfaitaire, alors que la directive stipule que deux taux différents ne
peuvent être appliqués que lorsqu'il y a deux prestations bien
"distinctes". »
Interrogée par l'AFP le vendredi 10 septembre, la
Commission européenne s'est défendue d'avoir demandé à la France
d'appliquer un taux standard (19,6 %) à l'intégralité du
forfait. Peut-être sa mise en demeure était-elle censée identifier de
façon exhaustives les infractions potentielles, sans préjuger des
conclusions du dialogue qu'il lui appartenait d'engager avec Paris.
Opportunisme
D'abord « plongé dans un profond embarras »,
selon notre confrère de La Tribune, le
gouvernement français semble avoir saisi l'opportunité qui lui était
offerte de raboter une "niche fiscale" tout en imputant à Bruxelles
l'impopularité d'une telle responsabilité. Dans cette affaire, en
effet, il témoigne d'un zèle inhabituel. « La pression
européenne qui est mise en avant constitue un faux prétexte pour une
fausse urgence » aux yeux de Philippe Bailly, qui observe sur
son blog que « si l'expression "mise en demeure" peut
apparaître impressionnante, elle ne désigne en fait en langage
bruxellois que le premier stade de la procédure entre la Commission et
un État membre ; pas plus à ce stade qu'une simple demande
d'information. Les fonctionnaires de Bercy le savent mieux que
quiconque, puisqu'il se sera écoulé plus de quatre ans entre la
première "mise en demeure" de la Commission sur l'ouverture du secteur
des paris en ligne, et le vote de la loi qui y pourvoyait au printemps
dernier... »
Cela n'est pas le moindre intérêt de l'UE pour les
politiques : elle leur fournit régulièrement un alibi.
Publié dans Europe, France | Pas de commentaires
16 septembre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Le Parlement européen n'a pas manqué d'invectiver Paris pour
sa politique à l'égard des Roms. Aperçu des débats ayant précédé
l'adoption d'une résolution présentée par les gauches européennes.

Déjà confrontée aux remontrances du Comité des Nations Unies
pour l'élimination de la discrimination raciale, aux outrances du
commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, aux
interrogations de la Commission de Bruxelles, la France a été
mise en cause par le Parlement européen le jeudi 9 septembre.
Dans une résolution adoptée par 337 voix contre 245, avec
51 abstentions, celui-ci prie « instamment »
Paris « de suspendre immédiatement toutes les expulsions de
Roms », et « s'inquiète vivement [...] de la
rhétorique provocatrice et ouvertement discriminatoire qui a marqué le
discours politique au cours des opérations de renvoi ».
Schizophrénie
L'assemblée fustige également « la réaction tardive
et réservée de la Commission », dont Hélène Flautre a
interpellé le représentant, la Luxembourgeoise Viviane
Reding : « Il est totalement sidérant, a-t-elle
déclaré au nom du groupe Verts-ALE, qu'après les différents entretiens
que vous avez pu avoir [...] vous en soyez à ce niveau de constat,
c'est-à-dire de non-constat des violations objectives qui ont été
commises par le gouvernement français. » D'autres députés
français ont encouragé l'hémicycle à condamner leur pays, telles
Catherine Grèze (Verts-ALE) et Sylvie Guillaume (Socialistes &
Démocrates). À l'opposé, Jean-Pierre Audy (PPE) s'est fait l'apôtre de
la sécurité, affirmant qu'« il ne peut pas y avoir de liberté
sans ordre ».
Raillant l'"europhilie" traditionnelle de la France, le
Britannique Gerard Batten a soutenu que les Roms y avaient été
« invités », puisque « chaque citoyen
européen a le droit de vivre dans un autre État membre ».
Qu'en est-il exactement ? Certains rappels ne seront pas
superflus si l'on en croit Bruno Gollnisch, « stupéfait [...]
de la méconnaissance juridique de [ses] collègues qui ont oublié que
les citoyens de l'Union européenne d'Europe centrale et orientale n'ont
pas encore le droit définitif d'établissement sur notre
territoire ».
Le point sur le droit
Jusqu'au 1er janvier 2014, en effet, Paris pourra
continuer d'exiger des migrants bulgares et roumains qu'ils
détiennent un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle
en France, voire une autorisation de travail, dont la demande, à la
charge de l'employeur, est instruite par la Direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
« notamment après vérification de la situation de l'emploi
dans la profession pour laquelle la demande est formulée »,
selon la Direction de l'information légale et administrative. D'une
façon générale, pour un séjour de trois mois au plus, les citoyens de
l'Union européenne ont pour seule obligation d'être en possession d'un
document d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Au-delà,
ils sont tenus d'exercer une activité économique en qualité de
travailleur, salarié ou non, ou bien de disposer de ressources
suffisantes et d'une assurance maladie. L'ordre, la sécurité et la
santé publics peuvent être invoqués pour limiter le droit d'entrée et
de séjour. En outre, selon la législation européenne en vigueur,
« les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires
pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente
directive en cas d'abus de droit ou de fraude ».
Que chacun balaie devant sa porte
Voilà qui devrait alimenter les polémiques où interviendront
juristes et politiciens... Pour clore ce débat parlementaire, signalons
l'intervention relativement mesurée de Marielle De Sarnez (ALDE), pour
qui « chacun doit balayer devant sa porte, à commencer par les
pays d'origine, où doit être menée une politique d'intégration plus
efficace, les Roms y étant trop souvent laissés pour compte,
marginalisés. Cela doit changer. Les pays d'accueil, également, où les
responsables politiques – je pense à l'Italie, hier, ou à la France,
mon pays, aujourd'hui – ont trop souvent donné le sentiment de montrer
du doigt, de stigmatiser une communauté tout entière et d'en faire le
bouc émissaire facile de toutes les craintes et de toutes les peurs.
Cela n'est pas acceptable. L'Union ne peut tolérer aucune politique
discriminatoire. L'Union européenne, enfin, qui n'a pas pris la
véritable mesure de cette question au moment de l'élargissement. Les
milliards dépensés n'ont en rien amélioré la situation quotidienne des
Roms. Il faut rattraper le temps perdu, mettre en place un plan
d'intégration de grande ampleur impliquant la Commission, les États
membres et les collectivités locales qui, trop souvent, se substituent
à l'État pour l'accueil des Roms. » Vaste programme.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
8 septembre 2010
Bien qu'elle tolère la réglementation des jeux de hasard et
autres paris aux Pays-Bas ou en Suède, la
Cour de Justice de l'Union européenne fustige les pratiques
ayant cours outre-Rhin.

« La Cour rappelle que les États membres disposent
d'une large marge d'appréciation pour fixer le niveau de protection
contre les dangers émanant des jeux de hasard. Ainsi, et en l'absence
de toute harmonisation communautaire en la matière, ceux-ci ne sont pas
tenus de reconnaître les autorisations délivrées par d'autres États
membres dans ce domaine. Pour les mêmes raisons et eu égard aux risques
que présentent les jeux de hasard sur Internet par rapport aux jeux de
hasard traditionnels, les États membres peuvent également interdire
l'offre des jeux de hasard sur Internet. »
À ses yeux, cependant, « la réglementation allemande
ne limite pas d'une manière cohérente et systématique les jeux de
hasard. En effet, d'une part, les titulaires des monopoles publics se
livrent à des campagnes publicitaires intensives en vue de maximaliser
les profits résultant des loteries en s'éloignant ainsi des objectifs
justifiant l'existence de ces monopoles. D'autre part, s'agissant des
jeux de hasard, tels que les jeux de casino et les jeux automatisés,
qui ne relèvent pas du monopole public mais présentent un potentiel de
risque d'assuétude supérieur aux jeux soumis à ce monopole, les
autorités allemandes mènent ou tolèrent des politiques visant à
encourager la participation à ces jeux. Or, dans de telles
circonstances, l'objectif préventif de ce monopole ne peut plus être
efficacement poursuivi si bien que celui-ci cesse de pouvoir être
justifié. »
Autrement dit, l'Allemagne manque de pudeur tandis qu'elle
exploite sa vache à lait...
Publié dans Europe | Pas de commentaires
2 septembre 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
En plein été, alors que la "rigueur" venait de s'immiscer
timidement à Bercy, un commissaire européen a relancé le projet d'un
"impôt européen". Les contribuables seront-ils trahis par
Paris ?

Un serpent de mer a ressurgi, au cours de l'été, sous
l'impulsion du commissaire européen en charge de la Programmation
financière et du Budget, le Polonais Janusz Lewandowski. Selon les
révélations du Financial Times Deutschland
(09/08/2010), il va proposer aux États membres de l'Union la création
d'un "impôt européen" – peut-être une taxe sur les voyages aériens ou
les transactions financières, rapporte l'agence Reuters.
Un pavé dans la marre
« Cette nouvelle ne constitue pas une
surprise » au yeux d'Alain Bournazel. Sans doute le secrétaire
général du Rassemblement pour l'Indépendance de la France (RIF)
s'est-il rappelé qu'en novembre dernier, Herman Van Rompuy avait plaidé
en faveur d'une taxe environnementale alimentant les caisses de l'UE.
De quoi satisfaire le Parlement européen, qui avait regretté, dans une
résolution adoptée en 2007, que le financement du budget communautaire
« ne contribue pas à la visibilité de l'engagement en faveur
de l'intégration européenne ». Quant à Nicolas Sarkozy,
présenté comme un « grand briseur de tabous » par
Alain Lamassoure, il « avait finalement renoncé à s'attaquer à
celui-là, après avoir évoqué l'idée d'un impôt affecté à l'Union
européenne durant sa pré-campagne présidentielle » (Questions
d'Europe, 29/03/2010).
« En dotant l'Union européenne de la personnalité
juridique », on lui aurait donné « les moyens de
créer un nouvel impôt », prévient Alain Bournazel. Peut-être
l'opinion publique y a-t-elle été préparée, tandis qu'on tentait de lui
vendre un traité sous l'appellation symbolique de
« constitution européenne ». Les "ressources propres"
de l'Union n'en demeurent pas moins fixées par le Conseil des
ministres, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement
européen. En outre, la décision des gouvernements « n'entre en
vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives » (article 311-3
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Dans ces
conditions, « l'impôt européen n'a pas la moindre chance
d'aboutir », estime Nicolas-Jean Brehon (Le Monde,
16/08/2010). D'autant que Paris, Berlin et Londres l'ont d'ores et déjà
condamné. « Nous jugeons cette idée [...] parfaitement
inopportune », a déclaré à l'AFP Pierre Lellouche, le
secrétaire d'État en charge des Affaires européennes. La Commission
aura vraisemblablement jeté un pavé dans la marre dans l'espoir
d'arracher aux États une petite rallonge budgétaire, susceptible
désormais d'apparaître comme un "moindre mal" devant les électeurs.
Trois ressources
Les recettes de l'UE devraient s'élever cette année à quelque
122,9 milliards d'euros. Elles proviennent, principalement,
des droits de douane perçus sur les importations en provenance des pays
tiers, d'une "ressource TVA", et d'un prélèvement sur le revenu
national brut (RNB) de chaque État membre. « Bien qu'il
s'agisse d'un élément d'équilibrage, cette ressource constitue
aujourd'hui la source de revenu la plus importante et représente 76 %
des recettes totales », souligne la Commission européenne.
Contre 11 % en 1988. « Tout se passe comme si l'Union
était financée, non par ses cinq cents millions de citoyens, mais par
vingt-sept contribuables - les vingt-sept ministres du
Budget », constate Alain Lamassoure. En effet, « les
deux principales ressources [...] ne diffèrent en rien des
contributions nationales classiques qui financent les organisations
internationales », confirme Nicolas-Jean Brehon (Dictionnaire
critique de l'Union européenne, Armand Colin).
Nostalgie européiste
« Ce n'était pas l'intention des pères
fondateurs », déplore Janusz Lewandowski. Le Parlement
européen l'avait rappelé : « La première Communauté
européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée le
23 juillet 1952, était financée par un véritable système de
ressources propres, fondé sur un prélèvement opéré sur chaque tonne
d'acier produite, payable directement par les sociétés fabriquant du
charbon et de l'acier au budget de la CECA. » Preuve que la
"marche forcée" vers le fédéralisme ne va pas sans quelque accrocs.
Le Parlement européen voudrait « redonner vie à la
lettre et à l'esprit des traités fondateurs ». Mais sans révolution
juridique, puisqu'il « estime que, comme le prévoient les traités
[...], la souveraineté fiscale doit demeurer du ressort des États
membres qui pourraient toutefois autoriser l'Union, pour une période
limitée et révocable à tout instant, à bénéficier directement d'une
certaine proportion des prélèvements fiscaux, comme c'est le cas dans
la plupart des États membres à l'égard de leurs collectivités
régionales ou locales ». Autrement dit, si un impôt "européen"
devait être institué à court ou moyen terme, ce serait en marge du
contrôle de Bruxelles. N'en déplaise aux idéologues, les États n'ont
pas dit leur dernier mot.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
15 juillet 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
En affichant sa préférence pour un service diplomatique placé
sous le contrôle des gouvernements, la France s'est attiré de vives
critiques au sein du Parlement européen, formulées plus
particulièrement par un eurodéputé belge.

Réuni en session plénière, le Parlement européen a entériné le
7 juillet l'accord dessinant les contours du Service européen
pour l'Action extérieure (SEAE). À l'approche de l'événement, notre
confrère Jean Quatremer, chantre d'une Europe fédérale, avait regretté
que « la diplomatie européenne échappe à la Commission et au
Parlement » (Coulisses de Bruxelles,
28/06/2010).
Un chantage payant
Pourtant, la fronde des députés n'a pas été sans résultats.
Par exemple : le contrôle des instruments financiers
extérieurs de l'UE (politiques de développement et de voisinage)
restera de la compétence de la Commission ; le personnel du
SEAE sera composé d'au moins 60 % de fonctionnaires
européens ; son budget opérationnel sera géré par la
Commission ; le Parlement recevra de la Commission un document
comptable retraçant l'ensemble de ses dépenses "action
extérieure" ; avant de prendre leurs fonctions, les
représentants spéciaux de l'UE et les chefs de délégation pourront se
présenter pour une audition informelle devant la commission des
Affaires étrangères du Parlement ; le Haut Représentant pour les
Affaires étrangères et la Politique de sécurité (Mme Catherine
Ashton) consultera les députés sur ses principales options ;
certains parlementaires auront accès à des documents
confidentiels ; une structure sera en charge des "droits de
l'homme" au niveau central ainsi que localement, dans les délégations.
Nationaliste français !
Ce sont autant de motifs de satisfaction pour Guy Verhofstadt,
le chef de file de la rébellion parlementaire. Dans le collimateur de
l'ancien Premier ministre belge, aujourd'hui député au Parlement
européen, figurait la France et son secrétaire d'État en charge des
Affaires européennes : « Certains nostalgiques de
l'Europe du congrès de Vienne, à l'instar de Pierre Lellouche, auraient
voulu que le SEAE devienne le docile serviteur des intérêts nationaux.
[...] Malgré leurs manœuvres pitoyables, le SEAE ne sera pas un lobby
intergouvernemental [...] avec le Foreign Office et le Quai d'Orsay
comme grands ordonnateurs », a-t-il écrit à Jean Quatremer,
auquel il reprochait de « relayer sans distance un point de
vue si vieille France » (Coulisses de Bruxelles,
01/07/2010). Et de railler « la frustration d'un nationaliste
comme Pierre Lellouche » ! Cela dit, les origines de
M. Verhofstadt le prédisposaient quelque peu à ses velléités
fédéralistes. Serait-il nationaliste lui aussi ?
S'exprimant le 23 juin devant la commission des
Affaires étrangères du Sénat, Pierre Lellouche avait annoncé qu'il ne
transigerait pas « sur le respect de nos intérêts et de nos
lignes rouges [...], qu'il s'agisse [...] de l'objectif d'une présence
des agents issus des diplomaties nationales à hauteur au moins d'un
tiers des effectifs ou de l'autonomie du Service et du principe
d'équidistance, y compris en termes budgétaires ».
« La clef de la légitimité de l'action diplomatique, c'est le
Conseil européen », autrement dit les chefs d'État ou de
gouvernement, avait-il encore martelé devant les journalistes le
28 juin (Euractiv, 29/06/2010).
Diplomatie et bananes
L'inénarrable Verhofstadt s'en est indigné :
« Je ne comprends pas comment certains peuvent affirmer que ce
sont les États-nations qui doivent être exclusivement compétents en
matière de politique étrangère », a-t-il avoué dans
l'hémicycle de Strasbourg. « J'ai parfois l'impression que pas
mal de collègues qui sont un peu sceptiques concernant ce service
vivent encore au XIXe siècle », a-t-il poursuivi.
Selon lui, « ce n'est que là où la méthode communautaire est
d'application que nous avons réussi, comme dans le domaine du marché
intérieur ». L'opération navale Atalanta, luttant
contre la piraterie au large de la Somalie, est pourtant saluée comme
un succès, bien qu'elle soit orchestrée, comme il se doit en matière de
défense, suivant la stricte méthode intergouvernemetnale. N'en déplaise
à M. Verhofstadt, on ne met pas en œuvre une politique
étrangère de la même façon qu'on règlemente la courbure des bananes.
Publié dans Europe | Pas de commentaires