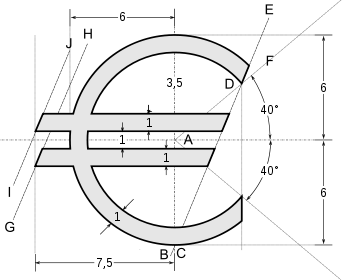1 juillet 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Débat à l'Assemblée sur la force de gendarmerie européenne.

La commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale
a examiné le 23 juin le projet de loi autorisant la
ratification d'un traité entre la France, l'Espagne, l'Italie, les
Pays-Bas et le Portugal, portant création de la force de gendarmerie
européenne Eurogendfor. Laquelle s'est choisi l'anglais comme langue de
travail, au risque de froisser Jacques Myard... D'autant que
« ce n'est la langue d'aucun des États
signataires ! » « Nos forces doivent
employer le français », a proclamé le député des Yvelines, qui
a prétendu « déposer un amendement en ce sens »,
fût-il irrecevable.
Tandis que Mme Élisabeth Guigou regrettait que cette force se
mette en place en marge des institutions de l'Union européenne, le
rapporteur Alain Néri a souligné que « le format restreint de
la coopération peut aussi être un gage de réactivité et
d'efficacité ».
Patrick Labaune s'est interrogé : « Avec le
rapprochement entre police et gendarmerie sous l'autorité unique du
ministère de l'Intérieur, faut-il comprendre que ce ministère devient
compétent pour des opérations extérieures ? » « J'ai
l'impression que le mieux serait encore de rattacher cette force au
ministère du tourisme ! », a même lancé Patrick
Balkany, sceptique. « Il est vrai qu'il ne s'agit que d'un
petit pas », a reconnu Axel Poniatowski, le président de la
commission des Affaires étrangères. « Néanmoins, lorsque cette
force de gendarmerie européenne est intervenue à Haïti après le
tremblement de terre, son action dans la lutte contre les pillards a
été très utile et appréciée. »
Publié dans Défense, Europe, Francophonie | Pas de commentaires
1 juillet 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Sur fond de rivalité avec leurs homologues européens, les
députés français accueillent sans grand enthousiasme la création d'un
Service européen pour l'Action extérieure (SEAE). Aperçu des
discussions en commission.

Réunis le 17 juin, les représentants du "triangle
institutionnel" européen (Conseil des ministres, Commission et
Parlement) sont convenus d'un accord ouvrant la voie à la création du
Service européen pour l'Action extérieure (SEAE).
Satisfecit fédéraliste
L'eurodéputé belge Guy Verhofstadt, chantre d'une Europe plus
fédérale, a exprimé sa satisfaction : « Il y avait
initialement, avant l'intervention du Parlement européen, un petit
service de type intergouvernemental. Mais nous avons réussi à changer
la philosophie du service », a-t-il proclamé (Toute l'Europe,
23/06/10). Mme Catherine Ashton, Haut Représentant de l'UE
pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, a assuré aux
parlementaires qu'ils bénéficieraient, sur le budget propre du service,
d'un droit de regard équivalent à celui dont ils disposent à l'égard de
la Commission. Les députés devront « être informés à l'avance
des décisions stratégiques et politiques », nous apprend
Euractiv (23/06/2010).
Quelques jours plus tôt, emboîtant le pas au Sénat, la
commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale avait
dénoncé le chantage exercé par le Parlement européen. Hervé de Charette
fut le seul à fustiger « l'hostilité traditionnelle »
de la France à son encontre, tandis que ses collègues examinaient un
rapport présenté par Nicole Ameline et Gaëtan Gorce. Lesquels n'ont pas
mâché leurs mots : « À aucun moment il n'a été
question, ni dans la lettre ni dans l'esprit du Traité [de Lisbonne],
de modifier dès aujourd'hui, dans le champ de l'action extérieure, les
pouvoirs du Parlement européen, ni de permettre à ce dernier de
s'immiscer dans le dialogue entre la Commission et les États membres
quant à la décision fixant l'organisation et le fonctionnement du SEAE.
Or les députés européens ont, sitôt consultés conformément au Traité,
entendu peser sur la configuration même du SEAE en "prenant en otage" –
osons l'expression – la décision du Conseil » – autrement dit,
les gouvernements. Et d'ajouter « qu'il serait fallacieux de
prétendre que l'on crée, avec le SEAE, une situation dans laquelle le
Parlement européen serait seul en mesure d'exercer un contrôle
démocratique que les parlements nationaux n'exerceraient plus à leur
échelle : nous ne sommes pas dans un cas de transfert de compétences
des États membres vers l'Union européenne ».
En effet, comme l'a relevé Élisabeth Guigou, l'innovation
tient à « la capacité d'unifier la direction de l'action
extérieure de l'Union », jusqu'alors scindée entre deux
piliers, communautaire (Commission) et intergouvernemental (Conseil des
ministres). Ainsi est-il possible, selon les rapporteurs,
« d'imaginer une nouvelle opération [navale] en Somalie et au
Yémen, qui mêlerait contrôle de la piraterie avec déploiement de
troupes, reconstruction de l'État somalien, assorti d'une aide au
développement et d'assistance sous forme d'ingénierie administrative...
soit toute la palette des instruments placés sous la responsabilité
politique de Mme Catherine Ashton – les modalités de mise en
œuvre concrète, budgétaire en particulier, différant
toutefois. »
Euroscepticisme
Les parlementaires français n'en ont pas moins exprimé un
certain scepticisme quant aux perspectives ouvertes par l'institution
du "service diplomatique européen". Hervé de Charette s'est dit
« très surpris par les chiffres avancés » :
« Doter ce nouveau service de 8 000 personnels alors
que tous nos ministères rencontrent des difficultés pour conserver
leurs effectifs me paraît étonnant. Le ministère français des Affaires
étrangères compte entre 12 et 13 000 personnels tout
compris : avons-nous besoin d'en créer un second sans
compétence bien définie ? » « Ce processus
ne doit pas conduire à l'affaiblissement de la diplomatie
française », a prévenu Robert Lecou. D'autant qu'« il
n'y a pas de diplomatie européenne » – ce qu'a confirmé
Jean-Claude Guibal : « Les représentants de l'Union
européenne que j'ai rencontrés à l'étranger se contentaient de
distribuer des crédits et de faire un peu de coordination. Le nouveau
service ne change rien à cela. » De toute façon, a conclu
Jean-Michel Boucheron, « personne ne souhaite réellement que
ce projet aboutisse. Aucun État n'est prêt à se dessaisir de sa
politique étrangère et c'est heureux. »
Deux thèses en présence
Les rapporteurs sont-ils du même avis ?
« Les capitales des États membres, et en particulier des
grands États, continueront probablement à jouer un rôle
incontournable », ont-ils écrit. « Symétriquement,
l'Union risque fort de parvenir pendant encore un certain temps à "se
taire d'une seule voix" – comme, hélas, encore tout récemment à propos
de l'arraisonnement en haute mer d'une flottille qui voguait vers la
bande de Gaza. » De fait, « l'Union européenne n'a
jamais été aussi visible sur la scène internationale que dans sa
réaction aux crises survenues au cours de la présidence française du
deuxième semestre de 2008... sous le régime du traité de
Nice ! » Preuve, selon eux, que « la clef du
succès de la future diplomatie européenne sera la capacité des grandes
capitales à faire converger leurs approches ».
Se distinguant par un relatif optimisme, Marie-Louise Fort
s'est demandé « si le nouveau service européen ne renforcera
pas, finalement, la voix des États européens dans le monde ».
« Deux lectures sont possibles en effet », selon Gaëtan
Gorce : « On peut certes voir dans l'avènement de ce
nouveau service un risque d'affaiblissement de notre
diplomatie ; on peut aussi le considérer comme un renforcement
de la capacité de faire prendre en compte nos préoccupations au sein de
l'Union européenne. » Quoi qu'il en soit, les députés
participant au débat ont témoigné d'un relatif réalisme dont on les
imaginait peu coutumiers. Sans doute y ont-ils été poussés par leurs
homologues "européens" convoitant leurs prérogatives institutionnelles.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
17 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Le Parlement européen poursuit sa montée en puissance, par
l'entremise du chantage et d'une communication douteuse.

L'immixtion du Parlement européen dans la constitution du
Service européen pour l'Action extérieure (SEAE) suscite l'inquiétude
de Pierre Lellouche, le secrétaire d'État en charge des Affaires
européennes. « Soyons sérieux ! », a-t-il
lancé à notre confrère Nicolas Gros-Verheyde (Bruxelles 2,
06/06/2010). « La politique étrangère, ce sont les nations,
avant tout. Ce ne sont pas les commissaires européens ni le Parlement
européen qui vont décider d'aller faire tuer des soldats. Si le Service
extérieur doit être pris en otage par des gens comme çà, cela pose
problème. »
Loin d'en démordre, l'assemblée européenne prétend agir avec
la bénédiction des parlements nationaux. Selon un communiqué diffusé le
31 mai, leurs représentants, venus débattre à Bruxelles,
auraient « dans leur grande majorité soutenu la vision des
rapporteurs du Parlement européen, Elmar Brok (PPE, DE) et Guy
Verhofstadt (ADLE, BE) [qui] prônent [...] le rattachement du service à
la Commission européenne en terme budgétaire ». Or, dix jours
plus tôt, le Sénat français avait adopté une résolution réclamant, au
contraire, que le SEAE soit « un organe sui generis de l'Union
européenne, équidistant de la Commission européenne et du Conseil et
disposant d'une complète autonomie en matière budgétaire et en termes
de gestion des ressources humaines ». Voilà qui jette un
certain discrédit sur la communication du Parlement européen...
Fort des pouvoirs budgétaires que lui confère le traité de
Lisbonne, celui-ci multiplie les chantages afin de renforcer la
dimension fédérale de l'Union. Fustigeant le caractère
intergouvernemental de la nouvelle stratégie européenne pour la
croissance et l'emploi, le Belge Guy Verhofstadt – encore lui – a ainsi
menacé d'en bloquer le financement (Euractiv,
06/06/2010). Enfin, en juillet prochain, les eurodéputés seront appelés
à approuver un accord sur le transfert de données bancaires vers les
États-Unis, dont ils avaient rejeté la première mouture contre l'avis
des gouvernements. Un scénario qui pourrait bien se reproduire, au
risque de compromettre la crédibilité internationale de l'Union, déjà
fragilisée outre-Atlantique.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
17 juin 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
L'intégration européenne sera-t-elle relancée à la faveur de
la crise ? Le président de la BCE réclame une « fédération
budgétaire »... Mais les mots n'ont pas le même sens pour tout
le monde.

Lundi 7 juin, les ministres de l'Eurogroupe ont
entériné le mécanisme européen de stabilisation financière. Un gage
donné aux marchés, dont la confiance ne sera toutefois rétablie que par
un assainissent durable des finances publiques... Le lendemain, le
Conseil a donné son feu vert à l'adoption de la monnaie unique par
l'Estonie, qui deviendra vraisemblablement, le 1er janvier prochain, le
dix-septième pays de la zone euro.
La livre dans la tourmente
Tandis que Nicolas Dupont-Aignan appelle à sortir de l'euro
« avant qu'il ne soit trop tard », cette perspective
peut apparaître surréaliste. Mais si les écarts de compétitivité
menacent effectivement la monnaie unique, qui prive en outre les États
de l'instrument de dévaluation, celle-ci n'est pas responsable du
laisser-aller budgétaire expliquant la crise des dettes souveraines...
En témoigne la situation du Royaume-Uni, dont la livre sterling ne
saurait masquer un déficit public« gigantesque »,
ainsi que l'a qualifié Fitch. L'agence de notation a souligné le
8 juin « que l'augmentation du ratio de la dette dans
le pays depuis 2008 "est plus rapide que dans aucun des autres pays
notés AAA" (de 52 % en 2008 à 70 % en 2010 et
87 % attendu en 2011) à cause d'un déficit public
(11,1 % du PIB) qui est environ "deux fois plus élevé qu'au
cours des précédents épisodes de détérioration budgétaire dans les
années 1970 et début 1990". Autant dire que "l'ajustement souhaitable
(sera) parmi les plus élevés des pays avancés". » (Coulisses
de Bruxelles, 09/06/2010)
Interrogé par Stéphane Lauer, Frédéric Lemaître et Marie de
Vergès, Jean-Claude Trichet, le président de la Banque centrale
européenne, a pointé en premier lieu « les responsabilités
propres à chacun des pays concernés » (Le Monde,
01/06/2010) « Mais il y a aussi une vraie responsabilité
collégiale. La surveillance multilatérale, attentive, qui est
fondamentale dans la lettre et dans l'esprit du Pacte de stabilité et
de croissance, a été terriblement négligée. » Aussi
« la surveillance des politiques budgétaires, des évolutions
de la compétitivité des économies de la zone euro et des réformes
structurelles » devrait-elle « être radicalement
améliorée ». « Nous sommes une fédération
monétaire », a poursuivi M. Trichet. « Nous
avons maintenant besoin d'avoir l'équivalent d'une fédération
budgétaire en termes de contrôle et de surveillance de l'application
des politiques en matière de finance publique. »
Surveillance multilatérale ou solidarité ?
Alain Lamassoure, député français au Parlement européen, a
suggéré la mise en commun de certaines "lignes budgétaires",
« dans des domaines où des dépenses communes seraient plus
efficaces » selon le résumé d'Euractiv
(09/06/2010). « Sans s'ajouter au budget européen, ces fonds
seraient mutualisés dans une structure ad hoc. Selon Alain
Lamassoure, François Fillon a évoqué la possibilité d'appliquer un tel
système "à certaines technologies critiques en matière de défense et de
recherche". »
Ce projet relève, lui aussi, d'une approche fédéraliste. Mais
« les mots n'ont pas le même sens pour tout le
monde », a prévenu Alain Madelin (BFM radio,
08/06/2010). En effet, Jean-Claude Trichet prône une surveillance
mutuelle, mais non « un fédéralisme de solidarité »
qui supposerait, in fine, « que les Grecs dépensent et que
l'Allemagne paie ». Galvanisés par la création du Fonds
européen de stabilité financière, dont ils exagèrent la portée,
« quelques eurolâtres » veulent y croire. Selon le
député belge Guy Verhofstadt, président du groupe ADLE au Parlement
européen, « seule la méthode communautaire peut apporter des
solutions adaptées à l'actuelle crise économique, en créant une plus
forte intégration européenne », affirme Euractiv
(06/06/2010). Or, rétorque l'ancien ministre de l'Économie,
« l'hyper-intégration » apparait
« totalement inapplicable à l'Europe », où la
mobilité des hommes et des capitaux est sans commune mesure avec celle
pratiquée aux États-Unis.
De même, le « gouvernement économique »
défendu par la France n'est rien d'autre qu'un gadget sémantique.
Réunis à Berlin à quelques jours du sommet européen des 17 et 18 juin,
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ont appelé à renforcer le Pacte de
stabilité, esquissant déjà une nouvelle révision des traités... L'UE
pourra certes distribuer bons points et avertissements, mais il
appartient aux responsables nationaux d'assumer – enfin – leurs
responsabilités.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
10 mai 2010
La France offre une promotion à Herman Van Rompuy.

Les politiques ont-ils été contaminés par les
journalistes ? Encouragés par le mimétisme ou l'idéologie, nos
confrères ont souvent promu Herman Van Rompuy « président de
l'Union européenne » – alors qu'il préside seulement le
Conseil européen des chefs d'État ou de gouvernement, dont il convoque
les réunions et anime les débats.
Or, ce glissement sémantique vient d'apparaître dans un
document officiel, vraisemblablement à la faveur d'une erreur de
traduction. En effet, la
déclaration des chefs d'État ou de gouvernement de la zone
euro du 7 mai mentionne l'intervention « du président
européen ». Du moins dans sa version française, car, dans
la langue de Shakespeare, il est bien question, au même
paragraphe, du « président du Conseil européen ».
On s'étonne que ce détail ait échappé à la sagacité des
juristes et autres diplomates francophones. Gageons que leur négligence
ne sera pas du goût de MM. Barroso et Zapatero,
candidats eux aussi à la "présidence" de l'UE.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
10 mai 2010
La mise en place du Service européen pour l'Action extérieure
(SEAE) alimente les rivalités institutionnelles. La commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées de la chambre
haute n'y est pas insensible.

En son nom, Josselin de Rohan a présenté une
proposition de résolution enregistrée à la présidence du
Sénat le 5 mai 2010.
Le texte rappelle que la Politique étrangère et de sécurité
commune (PESC) « demeure une politique de nature
intergouvernementale ». Il stipule que « le Parlement
européen ne dispose d'aucune légitimité pour exercer un contrôle
d'opportunité sur l'action du Service européen pour l'action extérieure
et pour se prononcer sur la désignation des chefs de délégation ou des
représentants spéciaux de l'Union européenne ». En
conséquence, il affirme que le SEAE « doit être un organe sui generis
de l'Union européenne, équidistant de la Commission européenne et du
Conseil, et disposant d'une complète autonomie en matière budgétaire et
en termes de gestion des ressources humaines ».
Naturellement, la proposition de résolution juge
« indispensable que les parlements nationaux puissent
entretenir des relations étroites » avec le Service. Elle
affirme, en outre, que la place du français doit y être garantie.
Reste à soumettre ce texte à l'ensemble des sénateurs. En
espérant que ceux-ci remonteront les bretelles de leurs collègues
siégeant au Parlement européen, à défaut d'appeler à sa dissolution.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
6 mai 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Le création du Service européen pour l'Action extérieure
suscite des tensions au cœur du triangle institutionnel européen. Après
s'être accordés entre eux, les gouvernements doivent compter avec le
Parlement et la Commission...

Réunis en Conseil des ministres le 26 avril, les
Vingt-sept ont dégagé une « orientation politique »
sur un projet de décision instituant le Service européen pour l'Action
extérieure (SEAE) – une innovation majeure du traité de Lisbonne.
La "parité" pour les ambassadeurs
« Cela n'a pas été facile », selon le
témoignage du ministre espagnol des Affaires étrangères, Miguel Ángel
Moratinos, qui présidait la réunion. Celui-ci a confirmé la volonté des
gouvernements de prendre en compte les équilibres géographiques, mais
aussi l'égalité des sexes dans la nomination des chefs de délégation de
l'UE. Cela rendra les désignations d'autant plus complexes... Les
ministres sont également convenus d'un compromis, vraisemblablement
entre "grands" et "petits" États, « permettant aux délégations
communautaires d'offrir un service consulaire dans certaines limites et
dans la mesure où ces services ne supposent pas de frais budgétaires
supplémentaires ».
Cet accord informel ouvre la voie à la conclusion d'un
arrangement entre les principales institutions de l'UE. En effet,
l'organisation et le fonctionnement du SEAE sont fixées par le Conseil
des ministres, qui statue sur proposition du Haut Représentant après
consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.
Confrontée aux foudres des députés, Mme Catherine Ashton avait
révisé son projet d'organigramme, en substituant au secrétaire général
trois responsables placés, sous son autorité, sur un pied d'égalité.
Cela suffira-t-il à satisfaire les parlementaires, qui partagent
désormais avec le Conseil le pouvoir budgétaire ?
Les présidents des principaux groupes politiques ont confirmé
qu'ils conditionneraient l'approbation du budget du Service et de sa
dotation en personnel à celle des projets de composition définitifs.
Parmi les instigateurs de ce chantage figure l'UMP Joseph Daul. Preuve
que, dans le cas présent, le tropisme fédéraliste inhérent au statut de
parlementaire européen éclipse les allégeances partisanes.
« Le Parlement tient particulièrement à ce que le SEAE soit un
instrument entièrement européen et non un instrument
intergouvernemental », souligne un communiqué.
Utopie fédéraliste
Le député Alain Lamassoure, président de la commission des
budgets, ne veut pas d'un vingt-huitième service diplomatique
s'ajoutant aux services des États membres. « Notre objectif
doit être de remplacer les vingt-sept autres services pour, d'ici
vingt-trente ans, n'avoir qu'un seul service extérieur »,
a-t-il proclamé au cours d'un débat parlementaire.
Dans un entretien accordé à la fondation Robert Schuman
(03/05/2010), Philippe Étienne, représentant permanent de la France
auprès de l'Union européenne, dessine aux antipodes les contours du
SEAE : « Il ne se substituera pas aux diplomaties
nationales mais prendra en charge les tâches de la présidence tournante
au titre de la Politique étrangère et de sécurité commune et permettra
de développer une culture diplomatique commune en rassemblant en son
sein des personnels venus des institutions européennes et des
administrations nationales. » Michel Foucher, directeur de la
formation à l'IHEDN, critique ouvertement l'attitude des
parlementaires : « Ceci risque de retarder l'entrée
en fonction du Service, qui ne devrait sans doute pas arriver avant
l'automne », a-t-il confié à notre confrère Marek Kubista (Euractiv,
28/04/2010) « Le Parlement commet une erreur en estimant que
des politiques communes pourraient être bâties en court-circuitant les
États. C'est l'inverse : il faut faire converger des
politiques nationales pour édifier des lignes de force d'intérêt
collectif européen. [...] Je ne crois pas du tout qu'à Pékin,
Washington ou Moscou, la vieille diplomatie soit complètement obsolète,
bien au contraire. Les positions communes européennes ne peuvent
exister que si les États, et particulièrement les grands, l'élaborent à
partir de leurs positions nationales. »
Barroso en embuscade
Dans les coulisses, les gouvernements devront compter,
également, avec la Commission. C'est avec Catherine Day, son secrétaire
général, que les discussions auraient été les plus difficiles jusqu'à
maintenant, si l'on en croit un diplomate cité par Nicolas
Gros-Verheyde (Bruxelles 2, 30/04/2010).
José Manuel Barroso entendrait se réserver certaines
prérogatives. D'ailleurs, il manifesterait peu d'égards envers le Haut
Représentant, par ailleurs vice-président de la Commission, et placé en
tant que tel sous son autorité. « Ce sentiment se reflète dans
le partage des tâches au quotidien », révèle notre
confrère : « À la Haute Représentante [sic] de
recevoir les ministres des affaires étrangères, au président de la
Commission d'entretenir des relations avec les Premiers ministres ou
présidents. Une sorte de répartition naturelle qui n'avait pas cours
avec le premier Haut Représentant, Javier Solana ayant pris l'habitude
de recevoir qui il voulait... et, surtout, de téléphoner à qui il
voulait. » Dans ce contexte, le Daily Telegraph annonce la
démission prochaine de Mme Ashton. De fait, tiraillée entre
plusieurs institutions, elles se trouve dans une position délicate,
plongée au cœur de rivalités dont les différends idéologiques ne sont
visiblement qu'un paravent.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
6 mai 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Par-delà la sémantique...
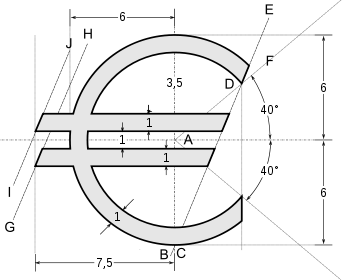
À l'issue d'une rencontre avec le président de la Commission
européenne, le chef de l'État a proclamé son accord avec Jose
Manuel Barroso sur « l'importance d'une stratégie économique
européenne ambitieuse basée sur un véritable gouvernement
économique ». L'expression se substitue peu à peu à celle de
« gouvernance économique » dans la bouche des élites
européennes – même en Allemagne ! Sans doute pour flatter des
opinions publiques appréciant sa connotation plus politique, tout
particulièrement en cette période de crise.
S'inspirant, plus ou moins, d'une proposition formulée par
Édouard Balladur en février dernier, le Finlandais Olli Rehn,
commissaire européen en charge des Affaires économiques et monétaires,
a envisagé de « soumettre les projets budgétaires nationaux à
un mécanisme de révision par les pairs », selon le résumé de
Madrid. Yves Daoudal, par exemple, a dénoncé « une nouvelle
trouvaille de la dictature européenne ». Après avoir présidé
les travaux menés avec ses homologues le 17 avril, le ministre
espagnol de l'Économie, Mme Elena Salgado, a assuré que Bruxelles ne se
substituerait pas aux autorités nationales : « Il est
hors de question [...] de voter (les budgets) dans des organes
différents des parlements nationaux », a-t-elle déclaré. Selon
M. Rehn, il s'agirait en fait de créer un « semestre
européen pour la conception de politiques économiques », entre
janvier et juillet. Ainsi Bruxelles serait-il informé dès le printemps,
pour l'année suivante, des grandes lignes des budgets de chaque État
membre.
Quoi qu'il en soit, en l'absence d'une convergence politique,
alors que Paris privilégie la consommation tandis que Berlin promeut
ses exportations, on voit mal comment pourrait émerger, à court terme,
un véritable "gouvernement" économique. Mais peut-être quelques
artifices européens aideront-ils les gouvernements (évidemment
nationaux, c'est presque un pléonasme...) à s'émanciper de la
pression des urnes : ainsi pourraient-ils imputer à Bruxelles la
responsabilité d'une rigueur budgétaire impopulaire qu'ils n'ont pas le
courage d'assumer.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
6 mai 2010
Article publié dans L'Action Française 2000
Les circonstances encouragent le renforcement de la
coopération franco-britannique en matière de défense. Outre-Manche, les
conservateurs y seraient même très favorables. En premier lieu dans le
domaine nucléaire.

Les Britanniques étaient appelés aux urnes le jeudi
6 mai. À quelques jours du scrutin, les conservateurs
semblaient toujours en passe de l'emporter. Une victoire de David
Cameron, eurosceptique notoire, affectera peut-être la marche de
l'UE... La défense est un autre terrain ouvert à la prospective. Le
21 avril, Malcolm Rifkind a exposé les conceptions des Tories
en la matière. Notre confrère Nicolas Gros-Verheyde a rapporté les
grandes lignes de son intervention dès le lendemain.
Avec la France
Aux yeux des conservateurs, le terrorisme serait, sans
surprise, la première menace pesant sur le Royaume-Uni. Mais garantir
la liberté du commerce serait une autre préoccupation essentielle. Sir
Rifkind exclut de réduire le budget de la défense britannique.
Toutefois, son parti entend s'attaquer « aux coûts
opérationnels du ministère », qui seraient supérieurs de
20 % environ à ceux observés dans les pays comparables, comme
la France et l'Allemagne.
Il juge les coopérations bilatérales importantes
« non seulement pour des raisons politiques mais pour résoudre
les coûts ». « Le mot coopération européenne peut
provoquer des réactions émotionnelles chez certains d'entre
nous », a-t-il reconnu. Les coopérations lui sembleraient
néanmoins utiles et nécessaires, « particulièrement avec la
France ». Outre la passation de marchés, la dissuasion
nucléaire pourrait faire l'objet d'une collaboration entre Londres et
Paris. En effet, souligne Malcolm Rifkind, « nous sommes les
seuls au niveau européen (avec la Russie) à avoir l'arme nucléaire.
Nous sommes proches. Et nous ne constituons pas une menace (envers
l'autre). »
Coopération nucléaire
En mars dernier, le Guardian avait prêté à la France la
volonté de partager les patrouilles sous-marines avec son allié.
Proposition a priori irréaliste, choquante à certains égards. Cela dit,
dès lors qu'on juge inexistantes les menaces nécessitant d'agiter à
moyen terme l'épouvantail atomique, on pourra donner la priorité au
maintien du savoir-faire, quitte à sacrifier la permanence à la mer...
Pour l'heure, en tout cas, « les marins français n'ont
toujours pas le droit de pénétrer dans la partie arrière des SNLE [sous
marins nucléaires lanceurs d'engins] de la Royal Navy, là où sont les
missiles Trident américains ». Comme le rappelait
Jean-Dominique Merchet le 26 avril, la relation "spéciale"
unissant Albion à Washington ne va pas sans une certaine exclusivité...
Néanmoins, poursuit notre confrère, « on se
parle » d'un côté et l'autre de la Manche. Cela afin de
dissiper le risque d'une nouvelle collision entre deux sous-marins. Et
sans doute, plus discrètement, pour préparer le renouvellement des SNLE
à l'horizon 2030. De façon plus confidentielle encore, une coopération
sur les têtes nucléaires ne serait pas exclue – « en
particulier grâce aux moyens français de simulation ». Sans
doute Paris a-t-il une carte à jouer.
Publié dans Défense, Europe | Pas de commentaires
29 avril 2010
Tandis que les Vingt-Sept prétendent s'être accordés sur les
fondations du Service européen pour l'Action extérieure, Michel Foucher
fustige la pression exercée par le Parlement européen afin de le
soustraire à l'influence des États.

« Ceci risque de retarder l'entrée en fonction du
Service, qui ne devrait sans doute pas arriver avant
l'automne », a-t-il
confié à notre confrère Marek Kubista. « Le
Parlement commet une erreur en estimant que des politiques communes
pourraient être bâties en court-circuitant les États. C'est
l'inverse : il faut faire converger des politiques nationales
pour édifier des lignes de force d'intérêt collectif européen. [...] Je
ne crois pas du tout qu'à Pékin, Washington ou Moscou, la vieille
diplomatie soit complètement obsolète, bien au contraire. Les positions
communes européennes ne peuvent exister que si les États, et
particulièrement les grands, l'élaborent à partir de leurs positions
nationales. »
Preuve que le bon sens n'est pas étranger à nos élites, dont
les souverainistes stigmatisent trop hâtivement l'européisme. Michel
Foucher, que nous découvrons à cette occasion, dirige notamment la
formation à l'IHEDN. Entre 1998 et 2002, si l'on en croit la
biographie que lui consacre Wikipedia,
il fut conseiller en charge des affaires politico-stratégiques au
cabinet d'Hubert Védrine – un chantre du "réalisme" alors ministre des
Affaires étrangères, parfois taxé d'euroscepticisme. Mais cela
n'empêche pas M. Foucher de codiriger par ailleurs le rapport
Schuman sur l'état de l'Union !
Publié dans Europe, Européisme | Pas de commentaires