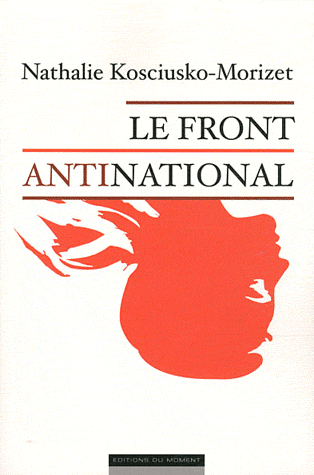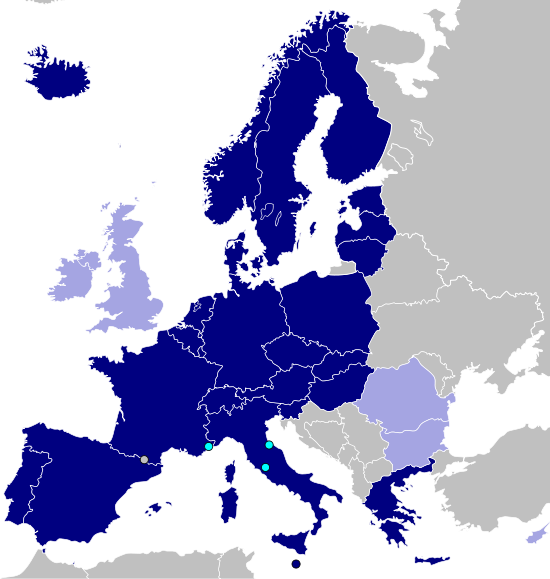6 juillet 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Le gouvernement entend « mettre l'égalité entre les
femmes et les hommes au cœur de l'action publique ».

À cet effet, a-t-il été annoncé le 27 juin,
« les ministres s'investiront
personnellement » : « Ils nommeront auprès
d'eux un haut-fonctionnaire à l'égalité des droits pour proposer et
suivre les mesures à mettre en œuvre dans leur ministère. La logique de
la parité sera étendue à l'ensemble de la sphère publique. De nouveaux
principes de nomination seront arrêtés pour une représentation
équilibrée dans les grandes instances de la République, en particulier
les autorités administratives indépendantes (Conseil supérieur de
l'audiovisuel par exemple) et les principaux organismes consultatifs de
l'État. »
Loin de tempérer cette frénésie féministe, l'UMP verse dans la
surenchère, à la faveur d'une autocritique légitimée par sa déroute
électorale. Faute de respecter la parité, le parti paie « cinq
millions d'euros d'amende par an », a déploré Rachida Dati, au
micro d'Europe 1. « Une femme à
la tête de l'UMP ou même de l'Assemblée ou de la France, cela aurait de
la gueule », a-t-elle poursuivi. Quant à Roselyne Bachelot, à
à l'antenne de Public Sénat, elle a proposé
« la division par deux des circonscriptions ainsi que
l'élection d'un ticket homme-femme qui pourrait assurer la parité
parfaite ». Un vrai concours Lépine !
Publié dans Féminisme & Genre, Politique, Société | Pas de commentaire | Lien permanent
21 juin 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
À l'issue d'un entretien avec Vladimir Poutine, le président
de la République s'est présenté devant la presse aux côtés de son
homologue russe, offrant aux journalistes un contraste saisissant...

Le président russe, Vladimir Poutine, a rencontré François
Hollande le 1er juin 2012. Devant la presse, tandis que son
homologue français nageait dans les vacuités, il s'est risqué à aborder
les questions les plus épineuses.
À commencer par celle du bouclier antimissile. À ce propos,
a-t-il déclaré, « la France est un des rares pays qui non
seulement nous écoute [mais] nous entend aussi ». Paris semble
d'autant mieux placé pour jouer les médiateurs avec Washington qu'il
est peut-être le seul, en Europe, à disposer des compétences
industrielles en jeu dans la défense antimissile, et donc de
l'expertise requise pour une discussion "d'égal à égal". « Il
nous faut [...] des garanties militaires et technologiques qui seraient
consacrées par des textes juridiquement contraignants », a
martelé Vladimir Poutine, qui ne se satisfera pas de quelques paroles
rassurantes. « On nous a promis de ne pas élargir l'Otan,
ensuite de ne pas déployer les bases militaires », a-t-il
rappelé, « mais l'Otan continue à s'élargir vers l'Est, et les
bases militaires poussent comme des champignons autour de nos
frontières ».
Évoquant la Syrie, le président russe s'est gardé d'apparaître
comme un thuriféraire insensible de la Realpolitik :
« Lorsque j'entends que la Russie a des intérêts spécifiques
dans ce pays, je peux vous dire que c'est une erreur totale »,
a-t-il déclaré. Les victimes civiles le préoccuperaient davantage. Or
a-t-il laissé entendre, les perspectives d'ingérence doivent être
abordées avec prudence : « Regardez ce qui se passe
en Irak, en Libye, dans d'autres pays de la région. Est-ce que ces pays
sont devenus plus sûrs, vers quoi évoluent-ils ? Nous
proposons, s'agissant de la Syrie, d'agir de façon très correcte, de
façon très pondérée. »
Enfin, alors qu'un journaliste lui demandait si Moscou
accepterait d'accueillir le président syrien et sa famille, Vladimir
Poutine a lancé cette pique contre la France : « S'agissant de
Monsieur Assad, je peux vous dire qu'il a visité beaucoup plus souvent
Paris que Moscou. » « Sur les visites du président
Assad père et fils, je n'ai aucune responsabilité » a répondu
François Hollande, manifestement décidé à incarner, courageusement, la
continuité de l'État.
Publié dans Monde, Politique | Pas de commentaire | Lien permanent
21 juin 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
La réforme de la Politique commune de la pêche (PCP) proposée
par la Commission européenne est mal accueillie au Sénat.

Que va-t-il advenir de la pêche française ? Cinq
sénateurs rattachés à divers groupes politiques s'en
inquiètent : Joël Guerriau (Union centriste), Odette Herviaux
(groupe socialiste), Gérard Le Cam (groupe communiste, républicain,
citoyen), Bruno Retailleau (UMP) et Charles Revet (UMP). Dans une
proposition de résolution enregistrée le 6 juin, ils rappellent
l'objectif de la Commission européenne : « lutter
plus efficacement contre la surpêche qu'elle considère comme
généralisée dans les eaux européennes et réduire la surcapacité des
flottes ». Or, le diagnostic de Bruxelles leur apparaît
d'autant plus « discutable » qu'il s'appuie sur des
données scientifiques jugées
« insuffisantes » : « à peine la
moitié des stocks sont aujourd'hui connus, avec des marges d'erreur
importantes », soutiennent les parlementaires. En tout cas,
préviennent-ils, si le "rendement maximal durable" était atteint dès
2015 pour toutes les espèces, conformément aux recommandations de la
Commission, la France devrait « fermer 50 % de ses
pêcheries, ce qui aurait des conséquences économiques et sociales
désastreuses pour le littoral français ». Le projet de
régulation de la flotte de pêche par l'attribution de quotas
revendables inspire la plus grande méfiance : les expériences
menées en ce sens par l'Islande, les pays baltes, ou encore le Danemark
et les Pays-Bas, l'auraient été au détriment de la pêche artisanale.
Vers l'interdiction des rejets
Quant à l'interdiction des rejets, ce serait « une
fausse bonne idée », coûteuse à mettre en œuvre en raison des
moyens de surveillance qu'elle nécessite. « Il est préférable
d'adopter une démarche d'amélioration de la sélectivité des engins de
pêche, pour prévenir les prises indésirables », clament les
auteurs de la résolution : "trier sur le fond plutôt que sur
le pont". D'autant que l'interdiction des rejets poserait
« des problèmes techniques immenses à la pêche française au
chalut qui est multi-spécifique ». Les navires, alors
surchargés, ne seraient pas adaptés pour ramener à terre l'ensemble des
prises.
Dans la nuit du 12 au 13 juin, les gouvernements
européens sont pourtant convenus d'interdire progressivement les
rejets. En revanche, ils excluent d'imposer l'instauration de quotas
transférables. De fait, comme le relèvent les sénateurs, « les
textes de la Commission [...] ont été accueillis de manière extrêmement
critique par la plupart des États membres de l'Union européenne
intéressés ainsi que par le Parlement européen ». Une
assemblée avec laquelle il faudra compter : en application du
traité de Lisbonne, celle-ci est désormais appelée à jouer un rôle
actif dans la définition de la Politique commune de la pêche (PCP).
Publié dans Agriculture, Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
21 juin 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
La première implantation hexagonale d'un restaurant McDonald's
remonte à quarante ans. Depuis, l'enseigne est devenue le symbole de la
mondialisation. Et de ses nuances.

Le 30 juin 1972, il y bientôt quarante ans, un
premier restaurant aux couleurs de McDonald's ouvrait ses portes dans
l'Hexagone. C'était à Créteil. Depuis, l'enseigne s'est disséminée dans
plus de neuf cents communes, où sont répartis près de mille deux cents
établissements, dont trois cents franchisés. La France est même devenue
le deuxième contributeur aux résultats du groupe américain. Un chiffre
d'affaires record est enregistré à Marne-la-Vallée (Disney Village),
ainsi que sur les Champs-Élysées. Symbole de la "malbouffe" importée
des États-Unis, la chaîne de restauration rapide s'est attiré les
foudres des pourfendeurs de la mondialisation, à l'image de
l'inénarrable José Bové : en 1999, on s'en souvient, il avait
"démonté" un McDo à Millau.
Défense bien huilée
Alors qu'il dirigeait l'entreprise, Jack Greenberg avait jugé
déplacées les attaques dont elle était victime :
« nous sommes d'abord un amalgame de petites
entreprises », avait-il clamé, fin 2002, dans un entretien
accordé à L'Express. La filiale hexagonale se
vante de « privilégier un approvisionnement
local » : « 100 % des produits
alimentaires servis dans les restaurants McDonald's de France en 2010
ont été fabriqués en Europe », martèle sa communication
officielle. « La France demeure le premier pays fournisseur
des achats alimentaires pour les hexagonaux avec près de 76 %
de volume. » Et de s'ériger en « partenaire majeur de
l'agriculture française ». Bel exemple de
philanthropie !
De fait, si McDonald's symbolise effectivement la
mondialisation, c'est avec ses nuances, dont témoigne la
"régionalisation" de l'offre entreprise depuis le milieu des années
quatre-vingt-dix. Jusqu'à l'immixtion, en avril dernier, de la
traditionnelle baguette dans les restaurants hexagonaux. Celle-ci
finira-t-elle par traverser l'Atlantique ? On n'en est pas
encore là, même si un McDo new yorkais serait, paraît-il, largement
inspiré de celui des Champs-Élysées.
Publié dans Mondialisation, Société | Pas de commentaire | Lien permanent
21 juin 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Une petite révolution s'annonce sur la Toile, où les domaines
de premier niveau vont se multiplier.

Dans les méandres de l'internet, les utilisateurs se repèrent
avec des adresses dont la variété des "terminaisons" était jusqu'à
présent limitée : on comptait une vingtaine d'extensions
génériques, dont la plus populaire demeure le ".com", et deux cent
cinquante extensions territoriales, environ, tels le ".fr" associé à la
France, mais aussi le ".tv", théoriquement réservé aux Tuvalu, un
archipel de l'océan Pacifique.
Le 13 juin 2012, l'Icann, l'organisme californien qui
contrôle les domaines, a annoncé avoir reçu près de deux mille dossiers
éligibles à de nouvelles extensions personnalisées. « Personne
n'a demandé ".facebook" ou ".twitter", même pas les deux entreprises
qui visiblement n'y voient aucun intérêt », rapporte Libération.
À l'inverse, Google pourrait saisir l'opportunité de colmater une
faille de sécurité, selon Stéphane Van Gelder, un
collaborateur de l'Icann. Aujourd'hui, explique-t-il, la société dépend
d'un tiers en charge du ".com". « Or, Google fait sûrement
davantage confiance à ses propres techniciens et ne dépendra plus de
personne s'il obtient le ".google". Une extension personnalisée peut
aussi avoir un intérêt majeur pour les banques. La Société générale
pourra dire à ses clients : "N'ouvrez aucune page qui ne
possède pas l'extension .sociétégénérale." »
Nos confrères ont recensé soixante-six dossiers déposés par
des organisations régionales, portant notamment sur les ".paris",
".corsica" et ".bzh". L'obtention par la Bretagne d'un domaine de
premier niveau « valorisera et donnera une visibilité nouvelle
aux activités économiques, sociales, culturelles », veut
croire le Conseil régional. C'est beaucoup espérer d'une simple
extension, même si, symboliquement, la décentralisation en France se
décide manifestement aux États-Unis. Rappelons toutefois que des
domaines étaient déjà dédiés à l'Outre-mer français : dix
extensions associées à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélémy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques
françaises, et à Wallis et Futuna.
Publié dans Internet | Pas de commentaire | Lien permanent
15 juin 2012
Lecture un tantinet polémique d'un pamphlet signé NKM.
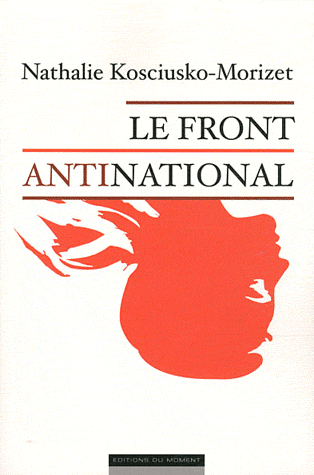
Parmi les personnalités figurant sur la "liste noire" du Front
national, dévoilée à l'approche du second tour des élections
législatives, Nathalie Kosciusko-Morizet constitue un « cas
spécifique » aux yeux de Marine Le Pen. L'année
dernière, en effet, à la veille des cantonales, elle avait jugé
l'élection d'un socialiste préférable à celle d'un frontiste.
« C'est une proposition à laquelle je tiens »,
a-t-elle répété quelques mois plus tard, dans un pamphlet s'attaquant
ouvertement au « front antinational ».
La critique s'avère convenue. « Le Front national
peut bien [...] prendre les traits avenants d'un sourire, d'une
blondeur, d'un prénom », il n'en reste pas moins associé à des
éléments radicaux, souligne l'auteur. « Ce n'est pas une leçon
de morale », prétend NKM, qui n'en verse pas moins dans les
bons sentiments. « C'est forts de nos différences que nous
devons trouver un chemin ensemble », clame-t-elle tout en
récusant « l'éloge des singularités ».
« Qu'il y ait en chacun de nous un fond d'aigreur, [...] une
petite haine de l'autre, c'est l'évidence. », affirme-t-elle.
Or, « cette part obscure de nous-mêmes » formerait,
selon elle, le « terreau » du FN.
Réduire le vote lepeniste à un défaut d'altruisme, voilà qui
nous semble assez léger. Depuis quand la charité se mesure-t-elle à
l'aune des sympathies politiques ? La moralité des individus
est une chose ; les représentations façonnant l'opinion en
sont une autre. Nathalie Kosciusko-Morizet s'y attaque en partie.
S'agissant du "protectionnisme", par exemple, elle soutient que
« le FN fait comme si de telles mesures n'existaient pas. Or
elles existent. [...] L'appartenance à l'Union européenne ne les
interdit nullement. Au contraire, nous disposons de normes qui sont
destinées à assurer la qualité de produits. » Par ailleurs,
écrit-elle, « il faut être clair là-dessus : les
immigrés sont des actifs, ils contribuent de manière nécessaire et
profitable à l'économie de notre pays ». Se défendant de tout
angélisme, elle martèle qu'« il faut être tout aussi clair sur
les difficultés. Car il y en a. Il y a des biais et des fraudes. Il
existe une immigration de complaisance, qui fait un usage abusif des
allocations chômage et familiales. La lutte contre ces abus est
prioritaire. »
Qu'importent les faits : de toute façon, observe
l'auteur, « le "programme" du FN n'a pas du tout vocation à
être réalisé. [...] Il est là pour frapper, par le caractère radical de
ses propositions. [...] La meilleure illustration en est donnée par le
chapitre économique. » De fait, l'incriiniation grotesque de
la "loi de 1973", ainsi que le fantasme d'un recours indolore à la
création monétaire, en disent long sur le sérieux du FN. Celui-ci
préconise, également, « la suppression de la binationalité,
sans jamais rappeler que certains binationaux ne peuvent pas répudier
leur nationalité d'origine, quand bien même ils le
voudraient ».
Enfin, « un pays comme le nôtre a le droit souverain,
aujourd'hui, de choisir qui s'installe ou non sur son territoire. Mais
dès lors qu'une personne y est installée légalement, il n'est plus
possible de la discriminer », estime l'ancien ministre de
l'Écologie. « Ce que la France choisit de faire aujourd'hui,
c'est de mener une politique ferme de lutte contre l'immigration
illégale. Et cette politique rend évidement inutile toute forme de
"préférence nationale". » D'autant que « parmi tant
d'autres effets dévastateurs, cette préférence favoriserait
l'immigration clandestine et elle rendrait impossible l'intégration des
étrangers. Stigmatisés, ces derniers n'auraient d'autre choix que de se
replier au sein de mouvements communautaristes ou
fondamentalistes. » Un risque à méditer.
« Être français, cela se conquiert, se construit, se
partage. C'est un perpétuel projet, pas une rente », proclame
encore NKM. « La tentation de la rente. Voilà qui fait
consensus entre le FN et la gauche », poursuit-elle. Même si
« dans le cortège des désespérances, le Front national, lui,
joue le rôle des pleureuses. » Enfonçons le clou : en
vérité, le populisme n'est rien d'autre que la déclinaison plus ou
moins "nationaliste" du néo-malthusianisme abreuvant le discours
socialiste. La hantise du plombier polonais découle de la même croyance
que la mise en œuvre des trente-cinq heures ; quant aux
immigrés, ils sont vilipendés au même titre que ces salauds de riches.
« La confusion sert toujours les mêmes », déplore
Nathalie Kosciusko-Morizet. « Le FN parle d'"UMPS". Mais
l'alliance électorale, objective, celle dont l'histoire politique
témoigne, elle est entre le PS et le FN. Même si Lionel Jospin, en
2002, a été le dindon de la farce. » Elle ne croyait pas si
bien dire... Pour la faire battre dans l'Essonne, Marine Le Pen
n'a-t-elle pas appelé à voter pour son rival socialiste ? PS,
FN, même combat !
Publié dans Politique | 1 commentaire | Lien permanent
7 juin 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Annoncée bruyamment sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la
réforme de l'espace Schengen est discutée ces jours-ci, sous la
houlette d'une Commission européenne avide de nouveaux pouvoirs.
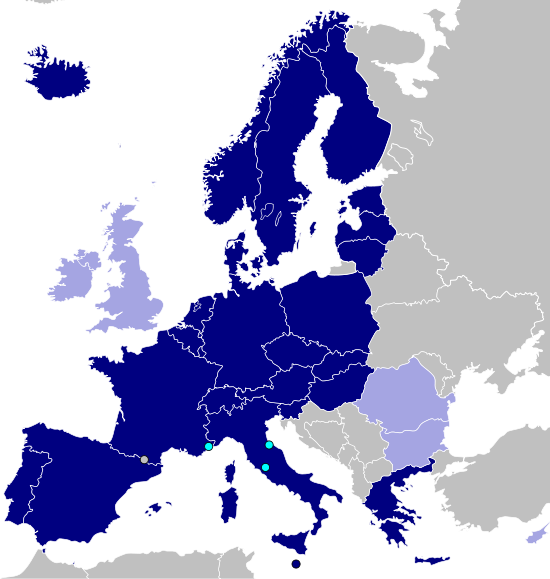
Draguant dans les eaux du Front national, Nicolas Sarkozy
l'avait martelé durant sa campagne électorale : « Il
n'est pas question que nous acceptions de subir les insuffisances de
contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. » Depuis,
l'agitation médiatique s'est assagie, mais la réforme de l'espace
Schengen demeure en discussion. La question figurait à l'ordre du jour
des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, appelés à se réunir
à Luxembourg le jeudi 7 juin 2012.
Dysfonctionnements criants
Mises sur la table en septembre dernier, les propositions de
la Commission européenne portent, d'une part, sur les conditions
d'évaluation de Schengen et, d'autre part, sur les modalités de
rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de l'UE. Deux
domaines dans lesquels Bruxelles entend accroître son influence, aux
dépens des gouvernements qui rechignent à lui céder leurs
responsabilités. « En cas d'urgence nécessitant une réaction
immédiate (une attaque terroriste, par exemple), les États membres
pourraient certes toujours prendre des décisions unilatérales pour
réintroduire les contrôles », résume un rapport du Sénat,
« mais seulement pour une période ne dépassant pas cinq jours,
après quoi une décision au niveau de l'UE serait prise, sur proposition
de la Commission, afin d'autoriser une éventuelle
prorogation ». Dans une lettre adressée le 19 avril à
la présidence danoise de l'UE, Paris et Berlin réclamaient, entre
autres, que ce délai soit porté à trente jours. Quant aux flux
migratoires, ils ne constitueraient pas en eux-mêmes « une
menace pour la sécurité », selon la Suédoise Cecilia
Malmström, commissaire européen aux Affaires intérieures. « Il
en résulte un certain paradoxe » relevé par la Chambre
haute : « Le phénomène à l'origine de la réforme se
retrouve à la marge de la proposition de la Commission, dans un simple
considérant. »
Par conséquent, s'il était franchi, ce pas supplémentaire en
direction du fédéralisme ne répondrait pas, nous semble-t-il, aux
dysfonctionnements les plus criants de l'espace Schengen.
« Lorsqu'un migrant ne réunit pas les conditions pour voyager
dans l'espace Schengen, l'État membre qui délivre un titre de séjour
(temporaire) devrait opter pour la délivrance d'un titre de séjour
(provisoire) qui ne soit pas équivalent à un visa Schengen de court
séjour », souligne timidement la Commission. Sans trop se
mouiller, celle-ci considère que « les États membres devraient
informer les titulaires de ces documents, d'une façon appropriée et
efficace, des conditions auxquelles ils peuvent (ou ne peuvent pas)
voyager dans l'espace Schengen ». L'année dernière, alors que
des migrants affluaient en provenance de Tunisie ou de Libye sur l'île
de Lampedusa, l'Italie leur aurait accordé des visas avec une certaine
légèreté, les autorisant à traverser les Alpes en toute légalité...
La Grèce inquiète
Aux frontières extérieures de l'espace Schengen, la pression
« se concentre sur un nombre limité de points sensibles, en
particulier l'axe de la Méditerranée orientale qui passe par la Turquie
et la Grèce », souligne la Commission. Au cours du dernier
trimestre de 2011, près de 30 000 franchissements irréguliers
ont été repérés aux frontières extérieures, dont environ 75 %
sur cet axe. « À la suite des graves insuffisances identifiées
en Grèce, la Commission considère que les efforts fournis, notamment en
ce qui concerne le contrôle des frontières terrestres et maritimes
extérieures, doivent rester une priorité. » En janvier
dernier, le Sénat s'était alarmé de la situation, déplorant que
l'accord de réadmission entre la Turquie et la Grèce ne soit pas mis en
œuvre en raison de la persistance du conflit chypriote. « Or,
si la plupart de ces migrants sont appréhendés, les conditions de
rétention en Grèce sont tellement mauvaises, les procédures de
traitement des demandes d'asile et de refoulement si insatisfaisantes,
que ces personnes doivent être relâchées. » Elles
seraient souvent appréhendées à nouveau dans le cadre d'une
opération organisée par Frontex à un stade ultérieur de leur parcours,
généralement dans les Balkans.
Les déboires politico-financiers rencontrés par Athènes
n'invitent guère à l'optimisme. « Plusieurs pays prépareraient
la réintroduction des contrôles aux frontières dans le cas d'une
situation d'urgence en Grèce », rapporte le site Internet
Presseurop, citant un quotidien autrichien. « Rappelant le
cadre juridique des accords de Schengen, le Standard
précise que "contrairement à la très débattue sortie de la zone euro
[...], la fermeture des frontières avec la Grèce par ses partenaires ne
poserait pas de problèmes". » Qu'importe la légalité de telles
mesures au regard du droit européen : nécessité fait loi.
Publié dans Europe | Pas de commentaire | Lien permanent
7 juin 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Aveugle aux spécificités de l'Outre-mer, l'Union européenne
freinerait le développement de la pêche locale, en dépit de ressources
halieutiques souvent abondantes.

Tandis que l'Union européenne planche sur la réforme de la
Politique commune de la pêche (PCP), trois parlementaires l'appellent à
prendre en compte les spécificités des régions ultrapériphériques
françaises. Maurice Antiste et Serge Larcher, sénateurs de Martinique
apparentés socialistes, et Charles Revet, sénateur UMP de
Seine-et-Marne, ont déposé en ce sens une proposition de résolution
enregistrée le 31 mai à la présidence de la Chambre haute.
« La pêche ultramarine représente une part très importante de
la pêche française », soulignent-ils dans l'exposé des motifs.
« On comptait ainsi en 2009 près de 2 500 navires de
pêche dans les quatre DOM, contre moins de 5 000 en France
hexagonale. [...] Les DOM représentent près de 35 % de la
flotte artisanale française et 20 % des effectifs de
marins-pêcheurs au niveau national. » Hélas, Bruxelles se
montrerait « aveugle aux réalités de la pêche ultramarine
française ». Les règles de gestion de la ressource, qui
constituent le cœur de la PCP, seraient « pensées par et pour
l'Europe continentale », déplorent les sénateurs.
L'application aux DOM de l'interdiction des aides à la construction de
navires constituerait « l'illustration la plus
préoccupante » du phénomène. La situation apparaît d'autant
plus regrettable que la flotte ultramarine serait « artisanale
et vétuste », alors que l'Outre-mer disposerait
« d'atouts indéniables, au premier rang desquels des
ressources halieutiques relativement abondantes et bien souvent
sous-exploitées ».
Faire entendre sa voix
En cause, également, les politiques commerciale et de
développement, en vertu desquelles l'UE conclut des accords de
libre-échange avec certains pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP). « Il est incompréhensible que l'UE encourage
le développement de la pêche dans des pays potentiellement concurrents,
tout en privant la pêche des RUP [régions ultrapériphériques] d'un
soutien équivalent », dénoncent MM. Antiste, Larcher
et Revet. Par rapport à leurs concurrents régionaux, les pêcheurs
réunionnais devraient supporter des coûts de production et de
commercialisation quatre à cinq fois supérieurs. Dans ces conditions,
il apparaît « nécessaire que la voix de l'Outre-mer puisse se
faire entendre au niveau européen en matière de pêche ». Or,
« aucune instance de dialogue ne permet [...] aux DOM de
s'exprimer au sein de l'UE sur le sujet ». À la différence des
autres régions ultrapériphériques de l'Union européenne, situées dans
les eaux occidentales, les départements français d'outre-mer ne
seraient représentés dans aucun comité consultatif régional (CCR).
« Comme le demandent les professionnels et le gouvernement
français, il est donc important qu'un CCR spécifique aux RUP soit mis
en place », martèlent les sénateurs. Affaire à suivre.
Publié dans Europe, Outre-mer | Pas de commentaire | Lien permanent
7 juin 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Petite pique en direction de François Hollande, thuriféraire
des eurobonds.

D'une pauvreté affligeante, les premières conférences de
presse du président Hollande lassent davantage que celles de son
prédécesseur, qui ne ménageait pas nos confrères, mais savait ponctuer
ses interventions de quelques touches d'humour.
Le 23 mai, le nouvel hôte de l'Élysée s'est fendu
d'une question qui se voulait rhétorique : « Est-il
acceptable que certaines dettes souveraines pour être financées soient
obligées de consentir des taux d'intérêts à plus de 6 % et que
d'autres pays [puissent] accéder à des financements à des taux
d'intérêts voisins de zéro dans la même Union monétaire,
budgétaire ? » Or, si l'Union monétaire constitue une
réalité, certes chaotique, l'union budgétaire demeure un fantasme.
Lequel se réaliserait à la faveur d'une mutualisation des emprunts
obligataires promue par François Hollande. En Europe comme en France,
sans doute s'agit-il de faire payer les riches – comprenez l'Allemagne.
On imagine avec quelle facilité celle-ci va se laisser
convaincre : la fourmi n'est pas prêteuse... Autant parasiter
ouvertement les sommets internationaux !
Dans un accès de magnanimité, Berlin semble enclin à inscrire
aux calendes grecques l'introduction des "eurobonds". On attend avec
impatience les conclusions du prochain Conseil européen, dont le chef
de l'État se gargarisera vraisemblablement comme il fit de celles du
G8, après y avoir glissé une coquille vide – en l'occurrence, le mot
"croissance". « Je considère que le mandat que j'avais reçu du
peuple français a été, dans un premier temps, déjà honoré »,
a-t-il déclaré, fort de son succès diplomatique. Rien de plus
"normal" !
Publié dans Europe, Politique | Pas de commentaire | Lien permanent
21 mai 2012
Article publié dans L'Action Française 2000
Au milieu du village global, un pays résiste, encore et
toujours, aux canons de la mondialisation promus par les artisans de la
gouvernance planétaire...

À la faveur de l'élection présidentielle, la France aurait
« réaffirmé sa profonde vocation républicaine, qui fait primer
la volonté politique sur la fatalité des marchés, la sensibilité
sociale sur les recettes financières, et la justice et la solidarité
sur l'exclusion », selon Hugo Chavez. S'agit-il d'un soutien
de poids pour François Hollande ? Affaibli par la maladie,
bientôt sur le départ, le président du Vénézuela s'est fait voler la
vedette, sur la scène latino-américaine, par son homologue argentin,
Cristina Kirchner.
Repsol exproprié
Celle-ci s'attire les éloges des pourfendeurs de la
mondialisation, tel Aymeric Chauprade : « l'Argentine
[...] apporte au monde une preuve supplémentaire que la voie du
redressement et de la liberté des peuples passe par l'indépendance
nationale et la rupture » avec le FMI, la Banque mondiale,
l'Union européenne, etc., a-t-il écrit sur son
blog. Il y a dix ans, déjà, Buenos Aires s'était distingué en cessant
de rembourser quelque 100 milliards de dollars de dette
extérieure. Aujourd'hui, il pratique « un protectionnisme
décomplexé », comme le relevaient, début mars, nos confrères
de La Tribune. De fait, « pour exporter en Argentine,
on doit s'engager à importer des produits argentins ou à investir dans
le pays pour ne pas risquer de voir ses produits bloqués aux douanes.
Parmi les cas les plus connus, le constructeur automobile allemand
Porsche a dû en 2011 s'engager à acheter du vin et de l'huile d'olive
argentins pour faire entrer une centaine de véhicules. Le fabricant
canadien Blackberry a dû, lui, annoncer l'ouverture d'une unité de
production en Terre de Feu (sud) pour continuer à vendre ses
portables. » Cependant, « en janvier, lassée des
retards provoqués par les nouveaux contrôles, le constructeur
automobile Fiat a arrêté son usine de Ferreyra (Cordoba, centre)
pendant 48 heures. Un avertissement pour le
gouvernement. »
Celui-ci ne semble pas se laisser démonter, comme en témoigne
la nationalisation de la société pétrolière YPF, aux dépens du groupe
espagnol Repsol... et dont pourrait profiter Total, qui en était déjà
un partenaire habituel. Scandalisés, le Washington Post
et le Wall Street Journal ont appelé à exclure
l'Argentine du G20, où son voisin chilien mériterait de lui succéder.
En réaction, le gouvernement espagnol a annoncé une limitation des
importations de biodiesel argentin. Mais selon l'analyse du Fauteuil de
Colbert, publiée par l'Alliance géostratégique (AGS), « il va
sans dire que Madrid est quelque peu démunie dans cette crise. La
Commission européenne a beau dire que... la Commission européenne ne
peut rassembler ni coalition, ni moyens de coercitions pour soutenir
l'Espagne. Cerise sur le gâteau, le nouveau gouvernement de Mario Rajoy
prend à peine ses marques dans une Espagne exsangue, et la contestation
sociale gronde. »
Les Malouines
Cela étant, poursuit l'auteur, « il y a [...],
forcément, quelques probabilités que la crise argentino-espagnole ne
vienne heurter le conflit anglo-argentin ». Voilà tout juste
trente ans se déroulait la guerre des Malouines. Depuis, le différend
opposant Londres et Buenos Aires ne s'est jamais dissipé. Les tensions
se sont même ravivées à l'approche de cet anniversaire, puisque les
navires battant le pavillon de l'archipel ne sont plus autorisés à
accoster dans les ports argentins... Dans cette affaire,
Mme Kirchner bénéficie d'ailleurs du soutien de la Bolivie, du
Brésil, du Chili et de l'Uruguay.
Ces deux crises, avec l'Espagne d'une part, le Royaume-Uni
d'autre part, « gravitent autour de la question des richesses
pétrolières qui gisent au large des côtes du Brésil et de l'Argentine -
et en Guyane », explique le Fauteuil de Colbert.
« Sous cet angle, il est moins certain que l'action argentine
actuelle ne vise qu'à détendre les cours actuels de l'or noir sur le
marché argentin. Cette action n'a-t-elle pas quelques visées à plus
long terme ? » L'auteur relève encore « des
enjeux de puissance car les richesses pétrolières brésiliennes
permettrait à Brasilia de produire plus d'or noir que BP ou
Exxon ». Quoi qu'il en soit, conclut-il, « il est
possible de se demander si Buenos Aires peut faire face à deux crises
sérieuses avec deux pays ayant des intérêts voisins dans les deux
conflits ».
Publié dans Économie et Industrie, Monde, Mondialisation | Pas de commentaire | Lien permanent