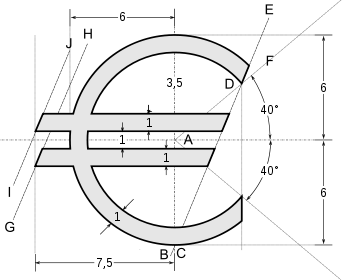4 février 2011
Article publié dans L'Action Française 2000
Actualité de la défense européenne.

Alain Juppé s'est rendu à Bruxelles le 27 janvier. Ce
faisant, conformément aux priorités qu'il avait exposées en présentant
ses vœux au personnel de la Défense, le ministre entendait
« redonner des couleurs à l'Europe de la Défense ».
Laquelle, dans son acception la plus stricte (autrement dit, dans le
cadre de l'Union européenne), semblait boudée par Paris, en pleine
idylle avec Londres.
Reprenant le refrain des gaullistes plus ou moins reconvertis
dans la quête d'une Europe puissance, Alain Juppé a martelé que le
Vieux Continent « ne [pouvait] prétendre à un rôle au niveau
international [s'il n'était] pas en capacité d'assurer sa sécurité de
manière autonome ». Incantation somme toute gratuite, que
seule la crise finira, peut-être, par enraciner dans quelque timide
réalité.
À la faveur des restrictions budgétaires, en effet, la
"mutualisation" est dans toutes les bouches, sinon dans tous les
esprits. Mais l'Allemagne vient de renoncer à treize des
cinquante-trois Airbus A400M qu'elle avait commandés. Quant aux
Suédois, « ils achètent US et font la nique à l'hélicoptère
européen » selon le constat de notre confrère Nicolas
Gros-Verheyde, visiblement désabusé.
Réunis à Bruxelles le 31 janvier, les ministres de la
Défense de l'Union européenne ont adopté des conclusions sur la
Politique de sécurité et de défense commune (PSDC), réduites à trois
paragraphes – ce qui nous épargnera, pour une fois, le verbiage inutile
propre à ces documents. Ils invitent Mme Catherine Ashton,
Haut Représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de
sécurité, à plancher sur les axes de travail que lui avaient soumis la
France, l'Allemagne et la Pologne (le triangle de Weimar) en décembre
dernier : renforcement des capacités industrielles ;
amélioration de la coopération UE-Otan, plombée par le différend
opposant Chypre et la Turquie ; mise en place de capacités
permanentes de planification et de conduite des opérations, à défaut
d'un véritable état-major, récusé par les Britanniques ;
élargissement des missions potentielles des groupements tactiques, qui
pourraient intervenir pour des opérations humanitaires – ce qui leur
donnerait, certes, un semblant d'utilité.
En définitive, l'adoption d'un accord-cadre avec le Monténégro
apparaît comme le seule avancée tangible réalisée par la PSDC en ce
début d'année.
Publié dans Défense, Europe | 1 Commentaire
4 février 2011
Article publié dans L'Action Française 2000
L'Outre-mer s'inquiète des accords commerciaux négociés par
l'Union européenne.

Dans une proposition de résolution, les sénateurs Serge
Larcher (apparenté au groupe socialiste) et Éric Doligé (UMP) réclament
des compensations censées « préserver la fragile production
agricole » des régions ultra-périphériques (RUP). En
cause : un accord avec les pays andins et l'Amérique centrale,
qui devrait être ratifié cette année.
Selon les parlementaires, l'Union aurait obtenu « des
avancées majeures, à savoir la fin des barrières douanières pour ses
industries, surtout l'automobile, et un meilleur accès aux marchés
péruvien et colombien des vins et spiritueux et des produits
laitiers ». En contrepartie, expliquent-ils, « les
deux États andins ont obtenu pour leur part une amélioration du
potentiel d'exportation de bananes, de sucre, de rhum et d'autres
produits agricoles ». Or, « l'économie agricole des
RUP françaises est extrêmement dépendante de ces productions ».
D'ores et déjà, le Parlement européen annonce la fin de la
"guerre des bananes" : « L'Union européenne mettra
progressivement un terme au traitement préférentiel dont bénéficient
les exportateurs de bananes des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP) », explique-t-il dans un communiqué.
« En échange, les pays d'Amérique latine ont accepté de mettre
fin aux litiges en suspens introduits à l'encontre de l'UE auprès de
l'OMC et ne tenteront pas d'obtenir des réductions tarifaires
supplémentaires sur les bananes dans le cadre du cycle de
Doha. »
Reste à préciser les dispositions qui viendront en aide aux
producteurs des régions ultra-périphériques. En la matière, le
rapporteur désigné par l'assemblée, l'Italienne Francesca Balzani, juge
insuffisantes les propositions de la Commission. Laquelle est appelée,
par une commission parlementaire, « à présenter, dans les
meilleurs délais, une étude d'impact sur les effets de l'accord pour
les producteurs de bananes des pays en développement et des régions
ultra-périphériques ». Mieux vaut tard que jamais.
Publié dans Europe, Outre-mer | Pas de commentaires
4 février 2011
Article publié dans L'Action Française 2000
Le mois dernier, la France a fait l'objet de deux remontrances
publiques émanant de la Commission européenne.

En cause : d'une part, le projet d'aide fiscale aux
assureurs gérant des contrats "solidaires et responsables", où l'état
de santé ne devait pas interférer avec le montant de la
prime ; d'autre part, le régime de TVA proposé aux agences de
voyages, autorisées à s'échanger des forfaits où le même taux pouvait
s'appliquer à tous les services inclus, quelle que soit la nationalité
du prestataire.
Publié dans Europe | Pas de commentaires
4 février 2011
Article publié dans L'Action Française 2000
Le volontarisme présidentiel pointe la spéculation.

S'il a ajouté l'« humilité » à
l'« ambition », lors de sa conférence de presse du
24 janvier, le président de la République n'en continue pas
moins de cultiver son "volontarisme". Dans son collimateur apparaît
désormais la spéculation sur les matières premières. Un nouveau bouc
émissaire aux yeux de moult observateurs, pour qui les prix sont
déterminés, en premier lieu, par l'équilibre de l'offre et de la
demande.
C'est l'occasion d'une nouvelle polémique entre Paris et
Bruxelles. Dans un rapport dont la publication a été différée, la
Commission européenne ne relevait « aucun élément
probant » attestant « d'un lien de
causalité entre les marchés des dérivés et la volatilité excessive et
la hausse des prix sur les marchés physiques » (La Tribune,
26/01/2011). Un constat balayé avec ironie par Nicolas Sarkozy, dont la
quête de transparence – gage de prévisibilité –
s'avère plus consensuelle.
Quant au secrétaire général de l'OCDE, le Mexicain Angel
Gurría, s'il a salué « la décision du gouvernement français de
faire de l'instabilité des prix [un] des axes prioritaires de sa
présidence du G20 », il annonce également que « dans
l'avenir, les échanges revêtiront une importance croissante pour la
sécurité alimentaire », les marchés les plus actifs étant
jugés moins volatiles. « Pour toutes ces raisons, poursuit-il,
il est essentiel que les négociations de Doha menées dans le cadre de
l'OMC aboutissent. » Les pourfendeurs du libre-échangisme sont
prévenus.
Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaires
20 janvier 2011
Article publié dans L'Action Française 2000
Malmenée par la crise des dettes souveraines, la monnaie
unique suscite des prises de positions ambiguës, où s'entremêlent
parfois les arguments chers à chacun des "camps" souverainiste et
européiste.
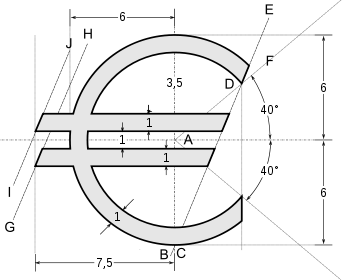
28 % des Français souhaiteraient en finir avec
l'euro, selon un sondage Ifop réalisé pour France Soir
les 5 et 6 janvier. Bien que cette proportion soit en recul
par rapport à novembre, un tabou a manifestement été brisé. Emmanuel
Todd s'en félicite : « L'acquis du dernier trimestre
de 2010, c'est qu'on est arrivé au bout de la croyance en l'euro comme
horizon spécifique pour l'Europe », a-t-il déclaré, pariant
sur la disparition de la monnaie unique sous sa forme actuelle d'ici la
fin de l'année (Le Soir, 04/01/2010).
Deux opposants résignés
Sur la rive droite du souverainisme, Nicolas Dupont-Aignan
s'en donne à cœur joie ; à gauche, en revanche, Jean-Pierre
Chevènement se montre timoré : « Je ne propose pas de
sauter par le hublot », a-t-il expliqué (France Inter,
06/01/2010). Rendant hommage à Philippe Séguin, Henri Guaino a tenu un
discours similaire, soutenant que ce dernier « avait tout
anticipé, tout prévu, et notamment qu'une fois que ce serait fait, il
serait impossible de revenir en arrière » (Les Échos,
06/01/2011). Selon le "conseiller spécial" de Nicolas Sarkozy, en
effet, « sortir de l'euro aurait un coût colossal ».
Allusion, peut-être, au renchérissement de la dette – libellée en euros
– qui résulterait de l'adoption d'une monnaie dévaluée.
Quoi qu'il en soit, selon la "vulgate médiatique" dont le
président de la République se fait ici l'apôtre, « on ne peut
avoir une même monnaie et partager des stratégies économiques
différentes », ni « parler convergence économique
sans convergence des systèmes fiscaux » (Euractiv,
13/01/2010). Outre les souverainistes, des libéraux contestent cette
"surenchère européiste", tel Alain Madelin, pour qui « de
telles propositions, si elles étaient suivies, conduiraient assurément
à l'explosion et de l'euro et de l'Europe ». « Il est
chimérique d'imaginer un budget fédéral européen organisant des
transferts financiers massifs pour compenser les différences de
compétitivité », proclame l'ancien ministre de l'Économie.
« Tout comme il est chimérique de vouloir forcer la solidarité
par l'émission d'obligations européennes communes. » Quant au
projet d'harmoniser les politiques fiscales et sociales « au
travers d'un gouvernement économique », il se heurte, selon
lui, « tant à l'exigence de souplesse et de concurrence de la
zone euro qu'à la nécessité de faciliter les ajustements des
différences nationales par des variations relatives de prix et des
politiques budgétaires autonomes ».
Flatter l'opinion
De son côté, le Premier ministre cultive l'ambiguïté, arguant
de son passé eurosceptique pour légitimer son discours :
« N'ayant pas voté pour le traité de Maastricht, je crois
[...] ne pas pouvoir être suspecté de dogmatisme en la
matière », a-t-il déclaré en présentant ses vœux à la presse.
« Cette crise n'est pas la crise de l'euro », a-t-il
assuré, prenant le contre-pied d'Alain Bournazel (suivre ce
lien). « C'est avant tout la crise de pays qui ont
été affaiblis par la récession économique qui a révélé et qui a
amplifié les lacunes de leurs modèles de croissance. »
François Fillon en viendra-t-il à fustiger l'État-providence ?
Pour l'heure, cet écho à la campagne de Maastricht semble
participer d'un positionnement plus général de l'exécutif, soucieux,
sans doute, de flatter une opinion publique critique à l'égard du
"machin européen", mais soumis, également, à la pression des
circonstances, les périodes de crise soulignant, inévitablement, la
faiblesse des mécanismes communautaires. « Si la volonté
politique [...] est bien présente, "l'esprit européen" ne l'est
toujours pas », déplorait récemment notre confrère Éric Le
Boucher (Les Échos, 14/01/11). Sont-ils
seulement compatibles ?
Publié dans Économie et Industrie, Europe | 1 Commentaire
14 janvier 2011
Comment les obligations d'État sont-elles placées sur les
marchés financiers ? Isabelle Couet lève le voile
sur des procédures méconnues. Extraits d'un
article publié par Les Échos le
13 janvier 2010.

Les États ne sont pas des émetteurs comme les autres. [...]
Ils ont donc instauré une procédure spécifique pour placer leurs titres
auprès des investisseurs du monde entier : l'"adjudication".
C'est « une enchère auprès des banques partenaires »,
résume l'Agence France Trésor (AFT), en charge des émissions pour le
gouvernement français. Les agences de la dette ou Trésors nationaux se
constituent un réseau d'intermédiaires, aussi appelés spécialistes en
valeurs du Trésor (SVT), qui participent aux enchères de titres d'État
pour eux-mêmes et leurs clients. Ils sont les seuls habilités à le
faire.
L'AFT compte vingt banques partenaires. « Pour
garantir la sécurité des adjudications, les SVT sont contraints
d'acquérir un montant minimal de 2 % sur chaque souche
obligataire et sur chaque adjudication », expliquait Philippe
Mills, le patron de l'agence, lors d'une audition à l'Assemblée, en
septembre. En d'autres termes, il y a toujours des acheteurs aux
enchères. [...] Si ce système garantit une demande, il n'empêche pas
les taux de grimper pour l'État émetteur si la situation devient plus
tendue. Les banques partenaires exigent des rendements plus élevés pour
acheter les titres.
Les États ont aussi parfois recours à la syndication, comme
les entreprises. Un petit groupe de banques (le syndicat) est mandaté
pour organiser une vente aux investisseurs via un
carnet d'ordres (dans lequel chacun inscrit la quantité voulue et les
prix qu'il offre). Ce système est beaucoup moins utilisé et n'est pas
annoncé publiquement à l'avance, contrairement aux adjudications, qui
ont lieu selon un calendrier prédéterminé.
Les syndications sont privilégiées pour le lancement de
nouveaux titres, par exemple ceux de la Commission européenne pour le
sauvetage de l'Irlande, de nouvelles maturités, etc. Elles sont aussi
nécessaires quand les tensions atteignent des niveaux insoutenables sur
les marchés et que chaque levée de dette doit se préparer avec l'appui
de tous les investisseurs, et pas seulement les banques partenaires. Ce
système est jugé plus révélateur de l'appétit réel des investisseurs,
car le carnet d'ordres est dévoilé. C'est pourquoi, la prochaine
syndication d'un État de la zone euro sera surveillée de très près.
Publié dans Économie et Industrie | Pas de commentaires
12 janvier 2011
Intervenant dans la "bataille de l'euro", Alain Madelin se distingue en
fustigeant les velléités fédéralistes dont s'honorent moult défenseurs
de la monnaie unique.
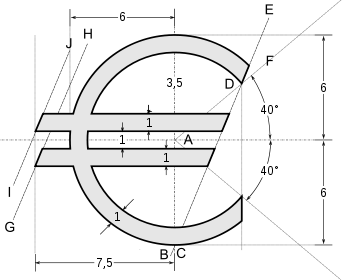
« L'euro a-t-il besoin de plus de
fédéralisme budgétaire et fiscal pour survivre à la
crise ? » Certainement pas aux yeux d'Alain Madelin.
Dans une
tribune publiée le mois dernier (en décembre 2010), l'ancien
ministre de l'Économie conteste vigoureusement les poncifs
européistes : « Plutôt qu'à des surenchères
ultra-irréalistes voire dangereuses, nous ferions mieux de revenir aux
fondamentaux », affirme-t-il : « une stricte
discipline budgétaire et une plus grande flexibilité économique,
assorties d'une police indépendante ».
« Le problème originel de l'euro, c'est
l'hétérogénéité des pays qui l'ont adopté », explique Alain
Madelin. De fait, « nos vieux pays européens ne peuvent guère
être comparés aux États américains de par leurs langues, leurs
cultures, leurs modèles sociaux et familiaux, leurs structures
économiques et démographiques, leurs choix collectifs, leurs niveaux de
dépenses publiques... » Cependant, poursuit-il, « une
telle diversité ne fait pas obstacle à l'adoption d'une même monnaie en
l'absence de véritable État fédéral. L'étalon or hier, le franc CFA ou
le dollar de Hong Kong aujourd'hui montrent que des liens monétaires
fixes peuvent unir des pays fort différents sans besoin d'un
gouvernement commun. » Mais « la solidarité au sein
de l'Europe n'a rien de comparable avec celle qui permet la coexistence
dans une même nation de l'ile-de-France et la Guadeloupe, de l'Italie
du Nord et du Mezzogiorno ou celle qui unit les États américains. Une
solidarité d'ailleurs complétée par la mobilité interne de la
population facilitée par l'usage d'une même langue. »
En conséquence, affirme Alain Madelin, « il est
chimérique d'imaginer un budget fédéral européen organisant des
transferts financiers massifs pour compenser les différences de
compétitivité. Tout comme il est chimérique de vouloir forcer la
solidarité par l'émission d'obligations européennes communes. [...]
Quant à l'idée d'harmoniser [...] les politiques fiscales et sociales
au travers d'un gouvernement économique, il est clair qu'elle se heurte
tant à l'exigence de souplesse et de concurrence de la zone euro qu'à
la nécessité de faciliter les ajustements des différences nationales
par des variations relatives de prix et des politiques budgétaires
autonomes. »
Et Madelin de conclure que « de telles propositions,
si elles étaient suivies, conduiraient assurément à l'explosion et de
l'euro et de l'Europe ».
Publié dans Économie et Industrie, Europe | Pas de commentaires
9 janvier 2011
Commentaire du rapport sur la gouvernance économique
européenne remis au président de la République jeudi dernier,
6 janvier 2011.

À la demande du président de la République, « un
chemin pour un "pilotage économique européen" » a été tracé
par Constance Le Grip et Henri Plagnol, respectivement député
au Parlement européen et député du Val-de-Marne. Leur
rapport reprend moult propositions ouvertement soutenues par
Paris, sinon d'ores et déjà mises en œuvre par l'Union ou ses États
membres. En marge des banalités, on relève un appel à développer les
capacités d'emprunt de Bruxelles, un plaidoyer en faveur d'une gestion
commune des dettes souveraines, et la volonté de réviser en profondeur
le budget communautaire.
Tétanisés par « une montée inquiétante [...] des
mouvements populistes et nationalistes dans l'ensemble de
l'Union », les rapporteurs préviennent « que le
gouvernement économique européen n'est pas le cheval de Troie du
fédéralisme ». « Au cœur de notre
problématique », expliquent-ils, « il y a la défiance
des peuples et des États vis-à-vis de l'Union ». Arguant de
« la complexité institutionnelle de l'Union » (qui
s'avère davantage affectée par son originalité en réalité), ils
martèlent que « seul le Conseil européen constitué des chefs
d'État et de gouvernement peut impulser une dynamique
efficace ». Considérant que « l'Union n'a de raison
d'être que si les États membres ont des intérêts communs à défendre
dans la nouvelle donne mondiale », ils proclament que
« c'est évidemment le Conseil européen qui est la seule
instance légitime pour définir ces intérêts et décider de la meilleure
stratégie pour les promouvoir » - cela en dépit des traités
selon lesquels « la Commission promeut l'intérêt général de
l'Union et prend les initiatives appropriés à cette fin ».
L'implication de la Commission est contestée jusque dans ses missions
les plus traditionnelles : ainsi les rapporteurs
préféreraient-ils confier à un "Conseil des sages", créé à cet effet,
la surveillance des écarts de compétitivité et la responsabilité
d'identifier « des seuils de divergence acceptables ou non en
matière salariale ou sociale ».
S'agit-il d'un tournant ? Pas vraiment. Comme le
rappellent Constance Le Grip et Henri Plagnol, « sous la
pression de la crise, la répartition des rôles a [...]
changé ». Sans doute la personnalité des dirigeants européens
et l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne ont-ils également
contribué à renforcer le poids du Conseil européen. En pleine
controverse autour des Roms, alors qu'il était encore secrétaire d'État
en charge des Affaires européennes, Pierre Lellouche aurait tenté de
justifier, auprès
de notre confrère Jean Quatremer, la défiance de Paris à
l'égard de l'Europe communautaire. L'Élysée ayant commandité ce
rapport, celle-ci se trouverait-elle délibérément confirmée ?
Publié dans Europe | Pas de commentaires
7 janvier 2011
Bruxelles affiche de timides velléités protectionnistes.

« Il convient [...] de protéger notre propriété
intellectuelle et nos marchés des biens non conformes à nos règles en
matière de protection des consommateurs », a affirmé l'Italien
Antonio Tajani commissaire européen en charge de l'Industrie et de
l'Entreprenariat, dans un
discours diffusé, cette fois-ci, par le service de presse de
Bruxelles.
« Je suis également en train d'envisager
l'opportunité de prendre des initiatives pour protéger nos actifs
stratégiques », a-t-il déclaré, évoquant l'autonomie spatiale,
les terres rares (dont
la Chine a décidé de réduire les exportations), et la
conservation des savoir-faire technologiques.
« Il nous faut prendre acte du fait que les marchés
sont devenus mondiaux, avec des chaînes de valeur disséminées autour du
globe », a-t-il encore observé. Arguant de ce constat
inévitable, il s'est dit « convaincu qu'il n'est plus possible
de réfléchir en termes de marchés nationaux et de politiques
économiques nationales ». Sur ce point au moins, sans doute y
a-t-il matière à discussion !
Publié dans Europe | Pas de commentaires
6 janvier 2011
Timide immixtion dans le domaine financier.

Dans une tribune publiée par L'Action
Française 2000, Jean-Claude Martinez appelle au
non-remboursement des dettes publiques « Les États ont [...]
le choix », affirme-t-il : « ou faire payer
des millions de femmes et d'hommes, en leur enlevant le nécessaire
vital, ou faire payer quelques milliers de traders,
de banquiers, de financiers, en diminuant les moyens de leur luxe
outrancier ».
Vision manichéenne, sinon simpliste, que l'auteur semble
lui-même démentir quand il observe que « les
créanciers prêteurs des États ne sont plus des banquiers
lombards ou des Templiers bien identifiés ». Les acteurs
intervenant sur les marchés financiers n'étant pas des
individus mais des personnes morales, cela rend peu opérantes les
accusations de cupidité, et pour le moins légère la mise en cause d'une
caste de privilégiés.
« Banques, fonds de pension, compagnies d'assurance,
institutions financières ne sont pas de simples prêteurs, mais des
concurrents, voire des adversaires des États, qui règnent déjà en
maîtres sur les marchés mondialisés, en n'obéissant à aucun
droit », écrit encore le professeur Martinez, que nous
soupçonnons de forcer le trait. Quid des règles prudentielles, en vertu
desquelles les banques fuient les obligations d'État les moins bien
notées, alimentant de facto la crise des
dettes souveraines ? Les marchés ont bon dos ! Plutôt
que de désigner un bouc émissaire, nous voudrions décrypter leur
fonctionnement. Peut-être quelques lecteurs pourront-il nous y
aider ! 😉
Publié dans Économie et Industrie | 2 Commentaires